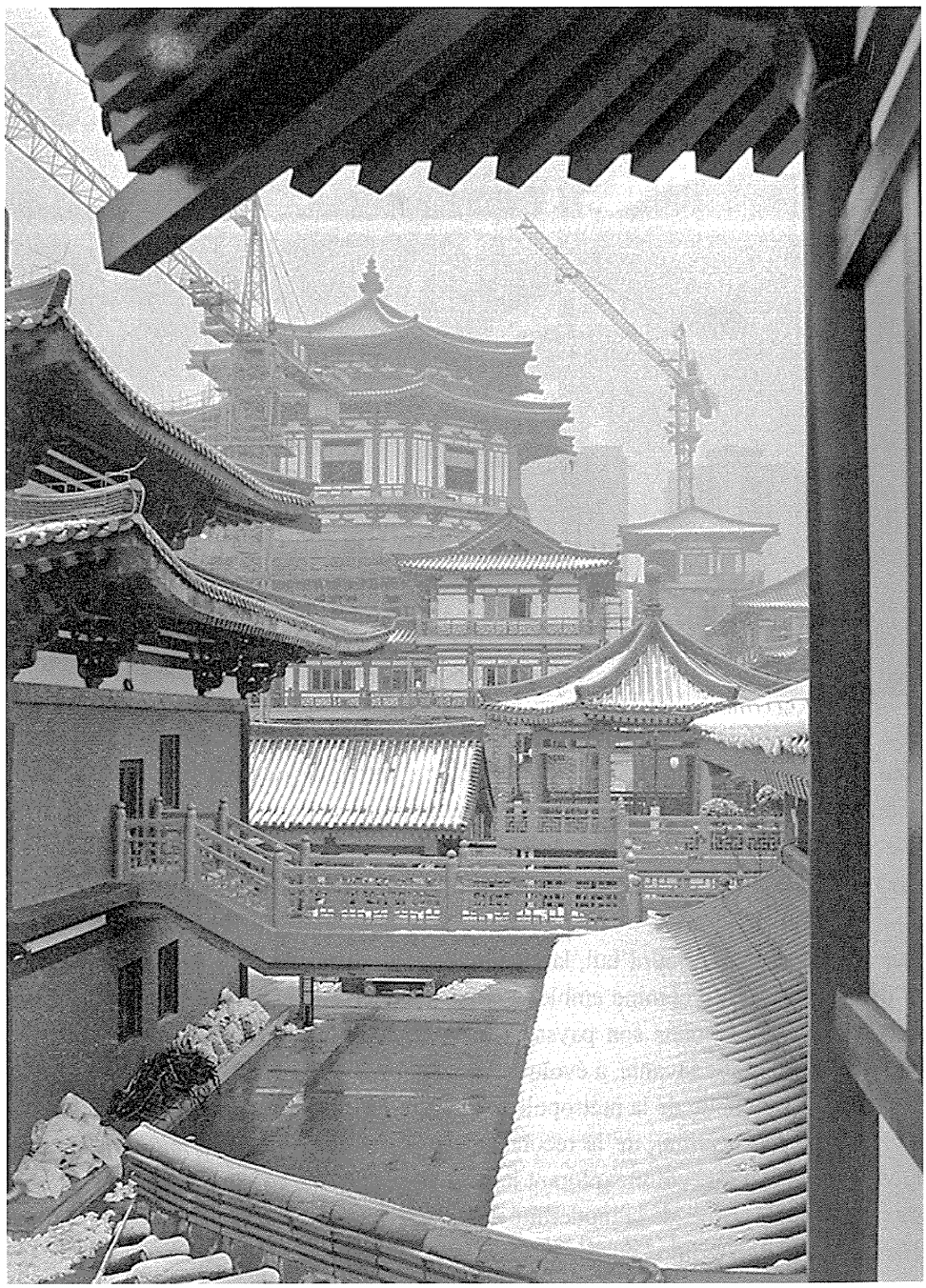#2 / L’architecture havanaise depuis le début de la Période spéciale : symbole d’un processus et d’une quête identitaires
Janice Argaillot
–
–
L’article de Janice Argaillot au format PDF
Depuis 1959, les projets architecturaux menés à bien à La Havane reflètent une certaine idée de la culture cubaine et parfois de ses tensions avec son environnement géographique immédiat. En effet, la capitale cubaine peut se faire le miroir des relations cubano-caribéennes, et permet dans une certaine mesure de comprendre la destinée caribéenne que l’on souhaite donner à tout le pays. Ceci apparut plus clairement encore au début de la Période spéciale, décrétée en 1991 par le gouvernement cubain suite à l’effondrement du camp socialiste. Cette période spéciale, dont l’Île n’est toujours pas officiellement sortie aujourd’hui, s’est caractérisée au début des années 1990 par une série de mesures parfois drastiques (incluant par exemple le rationnement du carburant ou des coupures de courant allant jusqu’à vingt heures par jour) destinées à sauver l’économie du pays, et par un flux massif d’immigration interne vers la capitale. Nous nous attacherons à analyser dans quelle mesure La Havane fut le symbole d’un processus de construction, déconstruction ou reconstruction identitaire de ses habitants, particulièrement depuis le début des années de crise et de pénuries que furent les années 1990.
Devant le foisonnement de styles architecturaux que propose La Havane, nous avons fait le choix d’étudier plus spécifiquement l’architecture civile et étatique depuis le début de la Période spéciale. Ainsi découvre-t-on que les constructions et reconstructions n’eurent pas pour seul et unique but de rendre La Havane plus attractive ou plus fonctionnelle, mais qu’elles s’inscrivirent au contraire dans un processus plus large de recherche identitaire.
–
1990 : quelles répercussions pour l’architecture havanaise ?
L’architecture havanaise en crise ?
Le début de la Période spéciale coïncida avec le décès de nombreux architectes Cubains expérimentés (tels que Fernando Salinas en 1992, ou Antonio Quintana en 1993), interrompant un grand nombre de projets mis en place par ces derniers dans les années 1980. Les décennies précédant la Période spéciale virent disparaître un grand nombre de monuments et d’édifices, faute d’entretien. Le domaine de l’architecture était déjà en partie à l’abandon avant le délitement de l’URSS, et l’écroulement du bloc soviétique ne fit ainsi qu’accentuer un état préexistant, la crise ayant entraîné l’arrêt de la construction de nombreux ouvrages commandés par le gouvernement de l’Île (Segre, 2003). En effet, les projets de construction de grands ensembles habitables ne sont à nouveau envisagés qu’à partir de 2005 (Gómez, 2006). « Le nouvel urbanisme » cubain subit donc de plein fouet les répercussions de la crise économique vécue par l’Ile, et la « Villa Panamericana », au nom évocateur puisque reflétant les désirs historiques d’union latino-américaine, devint l’exemple d’une créativité stoppée en pleine course. Les projets avant-gardistes, ou motivés par la création pure n’étaient plus réalisables financièrement (Coyula, 2007). L’architecture des dernières décennies, en se voulant prioritairement fonctionnelle, n’était plus la concrétisation d’une culture, mais plutôt l’expression de la crise. En effet, les édifices étaient construits à l’aide de matériaux de faibles coûts, et donc bien souvent de qualité moindre. En outre, l’usage extrême qui en était fait, conduisant à une détérioration très rapide voire à leur disparition, ne laissait pas le temps de juger de leur « valeur culturelle » (Rodríguez, 1998), et empêchait en tous les cas leur inscription au patrimoine culturel tangible cubain. D’autre part, la construction d’habitations se centrait sur le collectif dans les années 1990 (Kapcia, 2005), mais à travers des projets de petite envergure.
Paradoxalement, ces mêmes années furent marquées par l’édification d’hôtels à La Havane, tels que le Melía Cohíba (El Vedado) ou le Melía Habana (Playa, 1998, par Abel García). Certains immeubles désaffectés, déjà destinés à l’hôtellerie sous l’ère Batista, furent réquisitionnés et rénovés. La nécessité de trouver rapidement des devises entraîna une ouverture rapide au tourisme, et priorité fut donc donnée à ce secteur d’activité. Tandis que des complexes hôteliers luxueux étaient érigés, nombre de cubains arrivant des campagnes s’entassaient dans des quartiers « informels » en plein cœur de la capitale (tels que celui de « La Timba », sur la Place de la Révolution), ou dans des « barbacoas » (mezzanines construites avec des moyens de fortune dans les bâtiments coloniaux, subdivisant ainsi des appartements hauts de plafond).
Cette époque fut également celle de la construction du Miramar Trade Center, gigantesque centre commercial, ainsi que de l’agrandissement de l’aéroport international José Martí – en1997 (Segre, 2003). Des dizaines de restaurants et de discothèques furent construits ou ouverts depuis le début des années 1990. D’autres immeubles furent convertis en lieux d’habitation alors que ce n’était pas leur usage d’origine – principalement d’anciennes ambassades, résidences diplomatiques, mais également des musées (Rodríguez, 1998). Le danger aurait pu être l’effacement d’une part de la culture, si l’on considère que la conversion ou reconversion d’édifices contribue à gommer des morceaux d’Histoire ; mais d’un autre côté, on peut voir dans ce procédé la mise en valeur des qualités architectoniques des œuvres converties (Rodríguez, 1998). En outre, la réouverture de bâtiments favorisa la sauvegarde d’un patrimoine témoin d’une histoire que le gouvernement révolutionnaire présente comme un trait d’union entre les Cubains. D’ailleurs, certains observateurs ont remarqué que l’agrandissement, en 2000, de l’immeuble abritant el Banco Financiero Internacional (dans le quartier de Miramar), fut une réussite, puisque l’on réussit à y mélanger le « contemporain » et le « classique », et à en faire un tout homogène (Coyula, 2007).
Par ailleurs, les coupures de courant fréquentes au début de la Période spéciale poussèrent les Havanais, privés d’air climatisé et de télévision, à réinvestir le Malecón – promenade qui longe la mer sur plusieurs kilomètres au nord de La Havane – qui redevint un lieu de rencontre et de vie sociale (Kapcia, 2005). Ce lieu d’ « identification collective » devint alors un « poumon social et culturel » (Kapcia, 2005). Pour le dire autrement, la Période spéciale entraîna une recodification des relations sociales, et un réaménagement des lieux de vie des Cubains.

Vue de La Havane depuis le fort d’El Morro, juillet 2011 (photographie personnelle). Au premier plan, le Malecón.
–
La Vieille Havane : une exception dans l’exception ?
L’inscription de la Vieille Havane au Patrimoine de l’Humanité en 1982 par l’UNESCO, quelques années avant le début de la Période spéciale, permit au monde de porter un intérêt nouveau à la ville, et d’y voir renaître une conception culturelle et historique (Gómez, 2006). Les années 1990 furent ainsi celles de l’impulsion donnée aux programmes de sauvegarde et réhabilitation d’édifices historiques à La Havane. En effet, il ne suffisait plus de construire de quoi loger ou divertir les touristes, il fallait provoquer chez ces derniers l’envie de découvrir l’Île et sa culture. Pour ce faire, on remit au goût du jour des styles architecturaux typiques de l’époque précolombienne. Ces styles, communs à de nombreux pays de la Caraïbe, peuvent tout à la fois rapprocher Cuba de sa zone géographique, et contribuer à gommer une partie de son identité culturelle propre.
En 1993, année où la crise atteignait son paroxysme, débuta « la phase la plus ambitieuse » (Kapcia, 2005) du projet de rénovation de la Vieille Havane. En effet, le Decreto Ley 143 donnait l’autorisation à la Oficina del Historiador de la Ciudad (Bureau de l’Historien de la Ville), dirigée par Eusebio Leal Spengler, de réinvestir l’argent apporté par les touristes dans la reconstruction, la restauration et la préservation de la Vieille Havane –contre l’engagement d’œuvrer à des projets sociaux (Kapcia, 2005). Préserver la Vieille Havane, c’est-à-dire l’héritage architectural colonial, n’induit-il pas un rapprochement avec la Caraïbe, elle aussi victime de la colonisation ? On note ici que l’effondrement de l’URSS conduisit Cuba à chercher de nouveaux partenaires économiques et politiques, et que la culture sous toutes ses formes fut un moyen pour l’Île de se réinsérer dans un espace caribéen qu’elle avait délaissé au profit des pays du camp socialiste.
Cependant, Eusebio Leal a mené depuis le début une politique visant à « reconstruire la Habana Vieja comme patrimoine culturel cubain » (Gómez, 2006) –l’orientation donnée se tourne ici bel et bien vers Cuba, pas vers la Caraïbe– et la ligne tracée par la Oficina « ne [s’est pas contentée] de redéfinir la ‘signification’ du patrimoine culturel, elle réimplante également la ville coloniale comme modèle : la ville –patrimoine culturel– devient un musée et le musée devient une marchandise » (Gómez, 2006). En somme, en tentant de « réimplanter » un modèle urbanistique et architectural, on efface les spécificités et particularismes découlant du lien entre habitants et habitations. La ville n’est d’ailleurs plus un lieu d’habitat, elle se veut avant tout l’expression d’une culture que l’on offre au visiteur. En se convertissant en « musée », elle se fige dans le passé et met de côté la population, puis en devenant une « marchandise » qui échappe aux habitants, elle perd son identité culturelle.
En 1994, « quelques mois seulement après la crise des Balseros1 » (Kapcia, 2005), naquit le Plan Maestro para la Revitalización Integral de La Habana Vieja (Plan directeur de revitalisation intégrale de la Vieille Havane). L’une des particularités de ce dernier fut de regrouper des spécialistes de différents domaines (depuis celui de la finance à celui de la gestion urbaine), dont le but était de rénover la vieille ville. Le Plan Maestro « établissait les opérations comme un vaste projet commercial, artistique, archéologique et historique » (Kapcia, 2005). Le mélange des genres apparaît ici clairement. A travers ce plan, on peut voir « de toute évidence une déclaration d’identité culturelle nationale à une échelle que peu auraient prédit dans les années 1980 » (Kapcia, 2005). La Havane est ainsi devenue le creuset d’une « identité culturelle nationale » qui permettrait de contrecarrer les critiques adressées au système cubain, identité que l’on voulait partagée, reconnue, mais pas forcément unique et qui n’empêche pas de se sentir attaché à une région telle que la Caraïbe. Il s’est alors agi, à travers l’entremêlement de la culture et du politico-financier, de mettre en avant une certaine idée de la culture cubaine. Pour certains, cette logique privilégiant l’économie à la culture induit une ségrégation, les touristes étant privilégiés et les habitants de la Vieille Havane oubliés. En effet, la Vieille Havane a été coupée du reste de la ville ; tous les efforts se sont centrés sur elle, et on pourrait parler ici de « ghettoïsation » ou de « ségrégation urbanistico-architecturale », dans la mesure où, en contrepoint à la rénovation du centre historique, des bâtiments s’effondrent régulièrement, faute d’entretien, dans les quartiers périphériques de la capitale.
–
Introduction de capitaux étrangers : quelles conséquences ?
L’ouverture de Cuba aux capitaux étrangers –principalement canadiens, espagnols et mexicains– eut très rapidement un impact sur l’architecture : « […] les architectes cubains ont dû affronter […] les exigences de l’investissement étranger et s’adapter aux standards de construction et de design en vigueur dans le monde actuel » (Segre, 2003). Les investisseurs étrangers étant les véritables décideurs en matière de style, la réalisation des projets des architectes cubains est en quelque sorte bridée, et n’est plus l’expression d’une culture cubaine, mais le fruit de fantasmes culturels exogènes. Le fait de mettre en avant un « folklore » apprécié des touristes peut être particulièrement dangereux pour les cultures locales. En effet, en offrant la ville aux touristes, Cuba assure son économie, mais déforme l’image de La Havane (Gómez, 2006), c’est-à-dire d’un versant de son patrimoine culturel, et compromet l’élaboration d’une identité culturelle collective déjà difficile à définir.
Il faut encore se demander si le fait d’autoriser l’entrée de capitaux étrangers, procédé que l’on appelle « socio capitalisme », n’est pas une remise en cause de la culture politique développée à Cuba depuis 1959. En effet, aux conséquences de la crise sur la population, s’ajoute un sentiment d’injustice quant aux conditions d’accueil des touristes, ce qui amène les Cubains à voir les investissements dans le secteur touristique comme une trahison des principes de la Révolution.
Néanmoins, depuis 2005, la réorientation de l’économie cubaine vers la Chine et le Venezuela a induit une perte d’importance du secteur touristique ainsi que du plan de revitalisation de la Vieille Havane, ce qui modifiera peut-être les paramètres liés à la préservation de la ville.
–
Derrière la façade : une recherche d’identité ?
(Re)construction identitaire ou politique ?
Depuis le début des années 2000, beaucoup de constructions havanaises ont été « calquées » sur des modèles existant à Miami ou Cancun (Coyula, 2007), comme si les ressemblances architecturales pouvaient témoigner d’une union, d’un lien culturel entre régions et pays caribéens. Mais on sent poindre à nouveau le désir d’attirer le touriste et l’investisseur étranger en présentant un visage « exotique » de la ville. D’aucuns ont même relevé l’aspect « tropical » des constructions entamées à partir du début des années 1990 (Segre, 2003), caractérisées par des murs fins, de grandes ouvertures sur l’extérieur, et l’utilisation de bois tropical. Le danger est le lissage culturel –donner à la ville un rôle non plus d’unité, mais d’unification– dans le seul but de réaffirmer une identité collective permettant de surmonter une crise économique.
En pleine Période spéciale, le logement et la construction à La Havane furent la preuve tangible de l’effort collectif. Effort de reconstruction d’une ville, mais également d’une vie en communauté, et peut-être même d’une identité, qui ne repose pas uniquement sur la cubanía2. Ainsi l’architecture évolue avec les recompositions identitaires qu’elle traduit. Durant les années 1970, Cuba « a maintenu une position hégémonique sur les études [architecturales] réalisées, sans aucun lien avec les autres îles de la Caraïbe » (Segre, 2003), une tendance poursuivie dans les années 1980, durant lesquelles Cuba a mis en avant une certaine « cubanité » des ouvrages architecturaux de l’Île. A partir de 1990, ces mêmes études s’appliquèrent à souligner que l’architecture cubaine était la preuve d’une culture partagée avec la Caraïbe (Segre, 2003).
De nos jours, le combat ne se centre plus sur la sauvegarde de l’héritage colonial, qui avait pourtant été au centre des attentions durant les années 1990 ; il est au contraire aussi tourné vers la conservation du patrimoine du XXe siècle (Rodríguez, 1998). On ne cherche donc plus aujourd’hui à partager un legs colonial commun, mais bien à construire ou reconstruire l’histoire de la Caraïbe depuis son indépendance. Le fait de chercher à mettre en avant une culture supposément cubaine et/ou caribéenne n’est pas anodin. En effet, si l’un des buts du gouvernement était d’attirer les touristes, le deuxième était de maintenir une cohésion populaire. L’héritage était devenu, depuis le début de la Période spéciale, le principal instrument du modelage des représentations locales de l’espace, exploité dans un but de promotion extérieure tout autant que pour fortifier l’identification des habitants à leur environnement (Kapcia, 2005). En somme, si le Mur de Berlin est tombé, si l’URSS s’est écroulée, La Havane doit rester debout : c’est là la condition sine qua non à la survivance de la Révolution.
L’architecture havanaise semble avoir eu un but constant depuis le début de la Révolution : la recherche d’une identité culturelle nationale. Il n’y a peut-être qu’un pas entre le fait de forger et celui de falsifier, mais on ne peut nier les efforts conséquents du gouvernement cubain pour unir et rassembler la population. A travers l’architecture et la construction, il semble que l’on souhaite faire de cette population un peuple, conscient de ses particularités et particularismes, mais également de ses liens avec ses voisins. La colonisation a bien évidemment constitué la principale entrave à la consolidation de l’identité régionale caribéenne, mais la Révolution a signifié l’affermissement d’une identité cubaine ouverte à de multiples apports, que la crise des années 1990 menaçait d’affaiblir et qu’il était donc nécessaire de réactiver.
–
La Havane : l’autre ville caribéenne ?
L’une des conséquences évidentes de la reconstruction de La Havane est la « redéfinition de l’espace dans une ville qui en manquait auparavant » (Kapcia, 2005) ; en parallèle, on peut parler de « recréation » et même de reconstruction culturelle. La Havane semble toujours avoir été une priorité pour le gouvernement révolutionnaire, et la cubanité de la capitale fut exaltée par le gouvernement dès 1959, tandis que Santiago de Cuba fut bien souvent décrite comme la ville caribéenne de Cuba. Les sites historiques havanais furent présentés comme un héritage, et valorisés comme étant intrinsèquement « cubains » jusqu’à la fin des années 1980. Cependant, les années 1990 furent propices à la mise en avant de la caribéanité de La Havane. La capitale cubaine tendit effectivement à s’imposer comme un nouveau « centre » de l’émulation culturelle caribéenne, et non plus uniquement comme la charnière des relations entre l’Île et le sous-continent latino-américain. Santiago de Cuba n’était plus la seule ville « caribéenne » de l’Île, et il faut souligner la charge symbolique supposée par une telle mutation. En effet, en faisant de sa capitale le moteur de la culture et des manifestations culturelles caribéennes, Cuba tout entière se convertit en promoteur actif des liens culturels caribéens.
Malgré tout, les habitants de La Havane disent se sentir tout d’abord cubains, et en second lieu latino-américains, au motif qu’ils n’ont pas l’impression que les échanges avec la Caraïbe aient un impact direct, d’une façon ou d’une autre, sur leur quotidien. Mais ce que l’on fait à La Havane a des répercussions dans tout le pays (Kapcia, 2005). La volonté politique de reconstruire l’histoire nationale est clairement visible à La Havane, qui devint une sorte de laboratoire d’expérimentation ; effectivement, ce qui a été entrepris à La Havane fait « clairement partie d’un projet national de reconstruction du récit de la nation » (Kapcia, 2005).
–
–
En conclusion, nous pouvons tout d’abord dire que l’histoire architectonique de La Havane est à la fois spécifique et riche, puisqu’elle n’est pas seulement un héritage du passé ou le fruit de différents métissages. Elle est également le miroir de la vie politique et économique de l’Île, et reflète dans le même temps la place problématique de Cuba dans la Caraïbe.
La décennie 1990 fut synonyme de bouleversements profonds pour la capitale cubaine. De la crise matérielle, induisant la mise en avant de La Habana Vieja au détriment du reste de la ville mais également l’introduction de capitaux étrangers et donc de nouveaux modes de faire, La Havane est arrivée à une crise peut-être plus spirituelle. La construction ou reconstruction matérielle s’inscrit donc en parallèle d’une construction ou reconstruction identitaire, visant notamment à préserver l’héritage de la Révolution. Cette quête d’identité amène à modifier l’ordre établi, et à défendre les valeurs d’une communauté caribéenne dont Cuba a sans doute plus que jamais besoin.
Janice Argaillot
Janice Argaillot est Docteur en études hispanophones (spécialité civilisation latino-américaine), Maître de Conférences en langue et cultures hispaniques, Université Stendhal – Grenoble 3. Elle est rattachée à l’Université Stendhal – Grenoble 3, laboratoire ILCEA (Institut des Langues et des Cultures d’Europe et d’Amérique) – CERHIUS (Centre d’Études et de Recherches Hispaniques de l’Université Stendhal), ainsi qu’au GRIAHAL (Groupe de recherche interdisciplinaire sur les Antilles hispaniques et l’Amérique Latine).
–
Bibliographie
Coyula M., 2007, « El trinquenio amargo y la ciudad distópica: autopsia de una utopia », in Scarano F. (dir.), Cuba: contrapuntos de cultura, historia y sociedad, San Juan, Callejón, 361-382.
Gómez L., 2006, « Cinco notas al margen de un debate ausente sobre la ciudad histórica o ¿La Habana soñando con el traumhaus? », in Gualteros Trujillo N. (dir.), Itinerarios urbanos : París, La Habana, Bogotá: narraciones, identidades y cartografías, Bogota, Pontificia Universidad Javeriana, 47-76.
Kapcia A., 2005, Havana, the making of cuban culture, New York, Berg, 236 p.
Rodríguez E. L., 1998, « Arquitectura cubana: salvar el legado del siglo XX », in Rodríguez E. L., La Habana: arquitectura del siglo XX, Barcelone, Blume, 323-335.
Segre R., 2003, Arquitectura antillana del siglo XX, La Havane, Editorial Arte y Literatura, 432 p.
- Durant laquelle des milliers de Cubains ont fui l’Île et la crise économique qu’elle subissait sur des radeaux (balsas). [↩]
- Cubanía et cubanité : concepts liés à l’identité cubaine (si la cubanité est liée à l’origine ou à la nationalité, la cubanía est une cubanité pleinement vécue ; en d’autres termes, la cubanité est une identité « de fait », alors que la cubanía fait référence au ressenti de la cubanité, à un état d’esprit qui fait que l’on se « sent cubain ») ; voir par exemple les études de l’ethnologue et anthropologue cubain Fernando Ortiz. [↩]