Afrique du Sud / L’art, un outil de normalisation de la ville ? Le cas de Johannesburg
Pauline Guinard
–
–
–
Ville du capital à défaut d’être l’une des capitales de l’Afrique du Sud, Johannesburg est réputée (notamment du fait des héritages de l’apartheid) pour être une ville exceptionnelle, hors du commun, si ce n’est hors norme. Pourtant, Johannesburg comme toutes les autres villes du monde est traversée par un ensemble de représentations quant à ce qu’est et doit être une ville, par un ensemble de normes, qui non seulement la parcourent mais contribuent aussi à la façonner.
Depuis la fin de l’apartheid (1994), l’art – et plus particulièrement l’art qui se déploie dans les espaces publics – est précisément utilisé par les différents acteurs de la métropole (autorités publiques, acteurs privés, artistes ou habitants) pour promouvoir, imposer ou bien encore contester les normes qui régissaient hier ou régissent aujourd’hui le fonctionnement des espaces publics, et avec lui celui de la métropole de Johannesburg dans son ensemble. La mise en art des espaces publics, qu’il s’agisse de l’installation d’œuvres d’art pérennes ou de l’organisation d’interventions artistiques éphémères, vise alors à redéfinir ces espaces, en proposant de nouvelles manières de les imaginer et de les pratiquer. En ce sens, l’art peut effectivement être vu comme un moyen de réinventer, mais aussi de révéler les normes qui régissent ces espaces, c’est-à-dire l’« ensemble de règles et de prescriptions sociales, plus ou moins formalisées » (Lévy et Lussault, 2003, p.667), qui organisent leur fonctionnement, influencent les pratiques de leurs usagers et ouvrent en eux la possibilité d’une vie en commun (Berdoulay et al., 2001 ; Capron et Haschar-Noé, 2007 ; Sabatier, 2007). Et c’est bien parce que les normes ne sont jamais définies une fois pour toutes, parce qu’elles se modifient au gré des évolutions sociales, politiques ou économiques qui affectent la société, que la fin de l’apartheid a initié un processus de redéfinition des normes d’organisation de la société sud-africaine en général, et des espaces publics en particulier. Un tel processus est d’autant plus crucial dans ces espaces que les lois mises en place par le précédent régime, et les normes qui en découlaient, ont contribué à nier leur caractère public (Houssay-Holzschuch, 2010), en restreignant notamment leur accès et leur usage à une minorité de la population définie sur des critères « raciaux », pour ne pas dire racistes. À partir du cas johannesburgeois, nous nous proposons donc d’étudier le rôle de l’art dans la production des normes qui façonnent les espaces publics, et avec eux, la ville contemporaine post-apartheid.
En portant une attention particulière aux acteurs de cet art qui a lieu dans les espaces publics, nous montrerons que diverses normes et processus de mise en normes, parfois complémentaires, parfois contradictoires, sont à l’œuvre à Johannesburg. Pour mieux comprendre ces différentes normalisations aujourd’hui en cours, la distinction établie par Michel Foucault dans Sécurité, Territoire, Population (2004 [1977-1978]) entre « normation » et « normalisation » est éclairante. La « normation » correspond en effet à un processus de mise en normes dans lequel la norme est première, et le normal second. La norme sert à définir ce qui est normal, et c’est en fonction de la capacité des gens, mais aussi pourrions-nous ajouter des espaces, à se conformer à cette norme, qu’ils seront considérés ou non comme normaux. La « normalisation » au sens strict renvoie quant à elle à un processus inverse : le normal est premier, et la norme seconde. La norme est, dans ce cas, définie à partir de ce qui est préalablement identifié comme normal. Or, à Johannesburg, deux processus principaux de mises en normes des espaces publics par l’art semblent en effet actuellement en cours avec : d’un côté, une tentative des producteurs dominants de la métropole de faire correspondre le présent comme le passé de la métropole à des normes urbaines préétablies, et donc à « normer » la ville selon la terminologie de Foucault ; et d’un autre côté, la volonté des usagers ainsi que de certains artistes non seulement de résister à ces normes imposées, mais aussi d’en proposer d’autres à partir des réalités quotidiennes, et donc de « normaliser » la ville au sens foucaldien. Entre « normation » et « normalisation », il s’agit finalement de se demander quelle ville est aujourd’hui à l’œuvre à Johannesburg.
« Normer » Johannesburg : l’art pour mettre en normes et rendre normale la ville
Afin de faire correspondre Johannesburg avec un certain nombre d’idées, de représentations ou de discours quant à ce que doit être une ville aujourd’hui, et particulièrement une ville qui prétend rayonner à l’échelle mondiale, les producteurs dominants de la ville – au premier rang desquels se trouvent les acteurs publics, et plus particulièrement l’autorité métropolitaine johannesburgeoise – utilisent l’art comme un outil de ce que Foucault appellerait la « normation » des espaces publics, et à travers eux, de la métropole. Il s’agit ainsi, par l’art, de mettre ces espaces en conformité avec un certain nombre de normes conçues a priori, en vue de les rendre normaux. Les espaces publics johannesburgeois se doivent alors d’être beaux, sûrs, propres, mais aussi patrimonialisés, la mise en normes à l’œuvre touchant donc à la fois le présent et le passé de la ville.
L’art pour mettre Johannesburg aux normes de la « ville africaine globale »
Tout d’abord, l’art promu par l’autorité métropolitaine semble correspondre à une tentative d’insérer la ville dans le jeu de la concurrence urbaine internationale. L’art est alors pensé comme un moyen d’incarner, et par là même de construire, l’image de « World-Class African City » (« ville africaine globale ») que Johannesburg – selon le slogan métropolitain de 2000 – aspire à être. Mais l’installation d’art dans les espaces publics ne se résume pas à un simple embellissement, à une simple mise en art de ces espaces. Elle s’accompagne aussi d’opérations de sécurisation, de redéfinition des publics qui y sont les bienvenus, et par là même des normes qui les régissent.
Le cas de l’Eland ((Un eland ou éland est une antilope d’Afrique australe.)) de Clive van der Berg, une des premières œuvres d’art installées dans les espaces publics de Johannesburg avec le soutien de la métropole, est symptomatique de cette tendance. La mise en place de cette œuvre, pensée par son auteur comme un symbole d’africanité, dans le quartier péricentral de Braamfontein en 2007 s’est effectivement inscrite dans une logique de mise en ordre et en normes des espaces environnants, comme en témoigne l’introduction autour de la statue de panneaux interdisant le commerce de rue (photographie 1).
L’art vise ici à construire une image urbaine répondant à certaines normes de la ville globale – du moins telle qu’elle est imaginée par ses promoteurs johannesburgeois –, c’est-à-dire une ville dans laquelle les espaces publics sont non seulement propres et sûrs, mais aussi débarrassés de ce qui peut être lu comme des signes de sous-développement, à l’instar du commerce de rue. L’art participe alors à redéfinir qui a le droit d’être dans les espaces publics johannesburgeois et pour y faire quoi.
Dans le même temps l’Eland est un cas emblématique de la volonté des autorités publiques de faire référence à un passé « africain » qui serait commun à tous les usagers de Johannesburg, quand bien même cela impliquerait d’aller chercher ce référent dans le passé pré-urbain de la ville. Ainsi, pour Clive van den Berg, cet animal est censé être une allusion au passé naturel de la métropole (entretien du 13 février 2009), à ce qu’était Johannesburg avant Johannesburg. Faudrait-il alors remonter à la période antérieure à l’apartheid, antérieure à la colonisation et antérieur même à la présence des hommes, pour trouver des éléments dans lesquels tous les publics de Johannesburg puissent se reconnaître ? Ou peut-il, au contraire, y avoir des symboles communs dans le passé conflictuel de la ville ?
L’art pour normaliser, si ce n’est banaliser, le passé de Johannesburg
L’art est également utilisé par les autorités publiques pour commémorer les mémoires parfois douloureuses associées à l’apartheid. Ce faisant, l’art participe à donner une visibilité à des récits qui avaient été jusque-là occultés, tout en contribuant à mettre à distance ce passé, à introduire une « rupture patrimoniale » (Rautenberg, 2003), nécessaire à sa mise en commun mais aussi à sa mise en tourisme.
Les projets mis en œuvre dans le township ((Le terme township désigne les espaces résidentiels construits pendant l’apartheid (1948-1994) pour les populations de couleur, généralement en périphérie éloignée de la ville-centre.)) d’Orlando West depuis la fin des années 1990 (Marschall, 2006) sont symptomatiques de ce processus de mise en patrimoine des mémoires occultées et de reconnaissance des populations précédemment opprimées. Orlando West est en effet un des plus vieux townships de Soweto (SOuth WEst TOwnships), et est particulièrement connu pour avoir été le théâtre des émeutes de 19761, ainsi que pour avoir été ou être encore le lieu de résidence de Nelson Mandela et Desmond Tutu. C’est au nom de ce passé qui a marqué l’histoire de Johannesburg et de l’Afrique du Sud qu’Orlando West fut l’un des premiers townships à voir son passé inscrit, notamment au moyen d’œuvres d’art, dans ses espaces publics. Cette patrimonialisation du quartier ne vise d’ailleurs pas exclusivement à permettre l’émergence de voix jusque-là inaudibles, mais elle est également – si ce n’est premièrement – conçue pour y attirer de nouveaux publics, et notamment des touristes. La question est alors de savoir si ces différentes stratégies de mise en patrimoine d’une part, et de mise en tourisme d’autre part, sont compatibles. Le conditionnement des mémoires du quartier en produit touristique ne conduit-il pas en effet dans une certaine mesure à simplifier le passé, à l’aseptiser, à le faire correspondre à des normes touristiques, voire à le faire coïncider avec les préconceptions des touristes, afin de le rendre immédiatement appropriable et consommable par ces derniers ?
En dépit d’une volonté affichée par les autorités métropolitaines de s’adresser à tous les usagers des espaces publics d’Orlando West, Sud-Africains comme étrangers, touristes comme habitants, il apparaît bien aujourd’hui que ces derniers ont du mal à se reconnaître, ou ne serait-ce qu’à comprendre les œuvres d’art pourtant créées pour célébrer leur propre histoire. Les réactions des habitants eu égard à la sculpture de Stone Mabunda – artiste sowetan – réalisée en 2010 dans le cadre du programme d’art public financé par l’agence de développement de la ville, le Johannesburg Development Agency (JDA), pour représenter les émeutes de 1976 (photographie 2) sont particulièrement parlantes.
Pour certains habitants, cette sculpture représentait une foule en liesse ; pour d’autres, une manifestation quelconque. Alors que je remontais Moema Street à pied un soir de février 2011, un homme du quartier d’une quarantaine d’années m’a même expliqué, à moitié sérieusement à moitié pour plaisanter, qu’il s’agissait des présidents de l’Afrique du Sud : Mandela, Zuma, etc. Au-delà de l’anecdote, il n’en reste pas moins que, pour la majorité des gens du quartier, cette œuvre est incompréhensible, à tel point que l’on peut se demander si ce ne sont pas les touristes internationaux, qui constituent le véritable public visé par l’œuvre. L’œuvre, certes faite au nom des populations locales et par un des leurs, ne s’adresserait finalement pas à eux.
L’essentiel des œuvres d’art qui ont été installées pour représenter visuellement l’histoire du township tendent ainsi à favoriser la construction d’un « grand récit » (Mabin, 2011), voire d’un « métarécit » (Lyotard, 1988), c’est-à-dire d’une vision englobante et totalisante de l’histoire de la lutte contre l’apartheid, qui prime sur les récits et la vision des habitants. Tout se passe finalement comme si l’art servait à construire un récit consensuel et univoque du passé conflictuel du quartier, en vue d’en faire un produit touristique. Par cette mise en normes touristique, l’art en vient en fin de compte à rendre normal, si ce n’est banal, ce passé de Johannesburg qui a pourtant été si souvent présenté comme hors normes.
L’art pour contester les normes dominantes : une autre normalisation de la ville à l’oeuvre ?
Toutefois, ces différentes tentatives de normalisations, qui sont autant de « normations » au sens foucaldien, de la ville ne se font pas sans conflit ni résistance. D’autres acteurs de la ville (artistes, militants ou usagers des espaces publics) entendent résister, notamment par l’art, à cette mise en normes des espaces qui se fait selon des normes urbaines globales, standardisées, et comme imposées de l’extérieur. Ces acteurs se proposent au contraire de partir des réalités existantes, même si ces dernières peuvent être perçues comme anormales au regard des normes dominantes, en vue de faire de ces réalités les nouvelles normes de la ville contemporaine. Plus qu’à un processus de « normation », on aurait donc ici à faire à un processus de « normalisation » au sens fort, tel que défini par Foucault. L’art est alors conçu comme un facteur de ré-enchantement de la ville, comme un vecteur de réinvention des rapports des différents publics aux différents espaces, et des publics entre eux.
Le projet “Trolleys Works” (« œuvres de caddies ») initié par Ismail Farouk en décembre 2008 dans le centre-ville de Johannesburg, en donne une claire illustration. Financé par deux organisations culturelles privées allemandes, ce projet consistait à créer des caddies pour les trolley pushers (« pousseurs de caddies ») du centre-ville, ces hommes, pour la plupart étrangers, qui transportent des marchandises, bagages ou tout autre objet lourd en échange de quelques rands2. Activité informelle, une telle pratique est aussi l’objet de poursuites policières régulières, car les trolley pushers utilisent le plus souvent des caddies volés dans les supermarchés des environs (photographies 3).

Trolley Works, un autre art pour d’autres normes ? (© Ismail Farouk, 2008, reproduites avec l’autorisation de l’auteur)
Fournir des caddies légaux aux trolley pushers est donc envisagé par l’artiste comme un moyen de légaliser cette activité, de lui donner une place à part entière dans le fonctionnement de la ville, de la normaliser en faisant de cette pratique ordinaire, normale pour nombre d’habitants de Johannesburg, une norme à part entière.
Ce projet d’art est conçu comme un projet à visée sociale et politique, destiné à former les trolley pushers et à informer les populations de Johannesburg à leur propos, en vue de mieux intégrer cette activité et ces populations à la métropole. Dans cette perspective, la vision, véhiculée notamment par la police, des trolley pushers comme des criminels, est contestée et rejetée au profit d’une approche qui envisage au contraire ces populations comme des acteurs clefs de la métropole, qui peuvent, du fait de leur bonne connaissance du centre-ville, être de potentielles sources d’informations pour les autres usagers de Johannesburg. L’art ambitionne donc ici de devenir un instrument pour faire reconnaître des citadins et des pratiques qui, bien que nécessaires à la survie de toute une partie des habitants de Johannesburg, tendent à être niées ou combattues par les autorités. Il vise à normaliser ce qui est conçu comme anormal selon les normes dominantes d’aujourd’hui.
Au-delà de la vision des espaces publics proposée, si ce n’est imposée, par les autorités publiques au moyen de l’art, un autre type d’art qui est fait pour, avec et par le public concerné et qui est porteur d’autres normes, permet ainsi de contester les logiques de « normations » des espaces johannesburgeois, en proposant une autre façon de faire ville, une autre façon de la normaliser, dans laquelle chaque membre du public pourrait être un acteur à part entière de cette construction. Reste à savoir si un tel art peut infléchir les processus de mise en normes aujourd’hui dominants à Johannesburg.
Par l’art, les principaux protagonistes de Johannesburg cherchent à mettre en conformité les espaces publics avec un certain nombre de normes qui tendent aujourd’hui à régir l’aménagement et le fonctionnement de ces espaces dans de nombreuses villes du monde (Capron et Haschar-Noé, 2007 ; Fleury, 2007). Ces derniers se doivent d’être sûrs, beaux et propres, de façon à inciter tous les usagers de la métropole à les parcourir. Dans cette perspective, l’art est conçu aussi bien comme un outil d’embellissement des espaces, que comme un facteur de leur sécurisation, notamment parce qu’il implique ou présuppose un renforcement des dispositifs de surveillance et d’entretien. Un tel art contribue à faire de Johannesburg la ville globale, ou du moins à lui en donner l’image et l’apparence. Il est partie prenante d’une stratégie urbaine qui cherche à faire de Johannesburg une des grandes villes du monde, à l’inscrire sur la scène de l’art mais aussi des villes internationales. Cet objectif est d’autant plus crucial que Johannesburg, du fait de l’apartheid, fut tenue à l’écart de cette scène.
Et c’est précisément pour s’affranchir en partie de cette filiation, pour mieux réintégrer Johannesburg à la communauté urbaine mondiale, que les pouvoirs publics font appel à l’art comme à un instrument permettant une certaine mise en normes, non seulement du présent mais aussi du passé de la métropole. En patrimonialisant le passé de Johannesburg, l’autorité métropolitaine entend tout d’abord reconnaître les souffrances antérieures des habitants, et ainsi contrebalancer le paysage mémoriel jusque-là partiel et partial de la métropole. Mais, en donnant une lecture qui se veut consensuelle et en quelque sorte définitive de ce passé, elle vise également à mettre à distance les différents héritages et mémoires « encombrants » pour la métropole contemporaine (Bridonneau et Guinard, à paraître), et finalement à mettre ce passé aux normes du tourisme international. Inscrire une version officielle et non-conflictuelle du passé de la métropole dans ses espaces publics revient alors à en faire un élément du paysage urbain, à le figer dans l’espace mais aussi dans le temps de la métropole, comme pour mieux s’en détacher. L’art patrimonial devient avant tout pour Johannesburg un moyen de se projeter à la fois dans un autre espace, celui de la métropole contemporaine et non plus celui de la ville d’apartheid, et dans un autre temps, son présent et son avenir, plus que son passé. Dans le même temps, en tant qu’attraction touristique, l’art patrimonial devient un facteur d’insertion de la métropole de Johannesburg sur la scène internationale.
Pour autant, si la « normation » du présent et du passé de Johannesburg semble bien en cours, la mise en normes de la métropole telle qu’elle est voulue par ses acteurs dominants et les normes ainsi produites n’en sont pas moins contestées, au sein même de la métropole, par d’autres acteurs, artistes ou simples citadins, qui entendent résister à cette forme de normalisation en proposant, notamment à travers l’art, une façon alternative de construire les espaces publics johannesburgeois et les normes qui les régissent. Or, selon les normes et les processus de mise en normes qui parviendront effectivement à s’imposer par l’art à Johannesburg, ce ne sont pas les mêmes espaces ni la même ville qui seront à l’œuvre.
Pauline Guinard
Actuellement agrégée préparatrice à l’Ecole normale supérieure de Paris, Pauline Guinard est docteure en géographie et membre de l’UMR Lavue et du Laboratoire Mosaïques. Ses recherches portent sur les relations entre art et ville.
–
Bibliographie
Berdoulay Vincent, Castro Ina et Da Costa Gomez Paulo, 2001, « L’espace public entre mythe, imaginaire et culture », Cahiers de géographie du Québec, vol. 45, no 126, p. 413‑428.
Bridonneau Marie et Guinard Pauline, à paraître, « Traces encombrantes, patrimoine encombré : Une mise en regard Lalibela (Éthiopie) – Johannesburg (Afrique du Sud) », La métropolisation de la culture et du patrimoine, Paris, Le Manuscrit.
Capron Guénola et Haschar-Noé Nadine, 2007, L’espace public urbain : De l’objet au processus de construction, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail.
Fleury Antoine, 2007, Les espaces publics dans les politiques métropolitaines. Réflexions au croisement de trois expériences : de Paris aux quartiers centraux de Berlin et Istanbul, Thèse de doctorat, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Foucault Michel, 2004, Sécurité, territoire, population: cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, Gallimard Seuil (Hautes études).
Houssay-Holzschuch Myriam, 2010, Crossing boundaries – tome 3 : Vivre ensemble dans l’Afrique du Sud post-apartheid, Habilitation à diriger des recherches, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Lévy Jacques et Lussault Michel, 2003, Dictionnaire de la géographie, Paris, Belin.
Lyotard Jean-François, 1988, La condition postmoderne: rapport sur le savoir, Paris, Éditions de Minuit.
Mabin Alan, 2011, « Mobilisation of history and city futures », Conference Memory and the city, 2011, Johannesburg.
Marschall Sabine, 2006, « Visualizing Memories: The Hector Pieterson Memorial in Soweto », Visual Anthropology, vol. 19, no 2, p. 145‑169.
Rautenberg Michel, 2003, La rupture patrimoniale, Bernin, Á la croisée.
Sabatier Bruno, 2007, « De l’impossible espace public à la publicisation des espaces privés », L’espace public urbain : de l’objet au processus de construction, Toulouse PU Mirail., G. Capron, N. Haschar-Noé, p. 175‑191.
- Les émeutes de 1976 désignent les manifestations de collégiens contre l’imposition de l’afrikaans comme langue unique d’instruction, qui ont conduit à des affrontements avec la police et à la mort d’Hector Pieterson, alors âgé de 12 ans. [↩]
- Le rand est la monnaie officielle de l’Afrique du Sud. [↩]




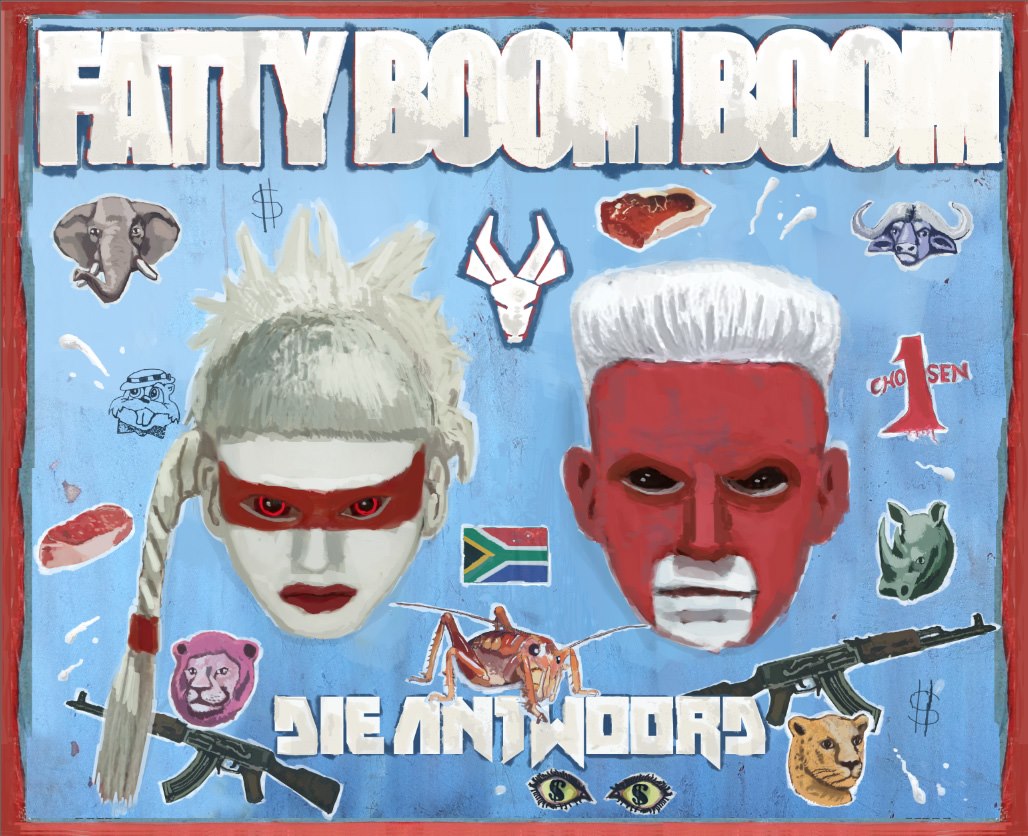








Comments
One Response to “Afrique du Sud / L’art, un outil de normalisation de la ville ? Le cas de Johannesburg”Trackbacks
Check out what others are saying...[…] Ville du capital à défaut d’être l’une des capitales de l’Afrique du Sud, Johannesburg est réputée (notamment du fait des héritages de l’apartheid) pour être une ville exceptionnelle, hors du commun, si ce n’est hors norme. Pourtant, Johannesburg comme toutes les autres villes du monde est traversée par un ensemble de représentations quant à ce qu’est et doit être une ville, par un ensemble de normes, qui non seulement la parcourent mais contribuent aussi à la façonner.Depuis la fin de l’apartheid (1994), l’art – et plus particulièrement l’art qui se déploie dans les espaces publics – est précisément utilisé par les différents acteurs de la métropole (autorités publiques, acteurs privés, artistes ou habitants) pour promouvoir, imposer ou bien encore contester les normes qui régissaient hier ou régissent aujourd’hui le fonctionnement des espaces publics, et avec lui celui de la métropole de Johannesburg dans son ensemble. La mise en art des espaces publics, qu’il s’agisse de l’installation d’œuvres d’art pérennes ou de l’organisation d’interventions artistiques éphémères, vise alors à redéfinir ces espaces, en proposant de nouvelles manières de les imaginer et de les pratiquer. En ce sens, l’art peut effectivement être vu comme un moyen de réinventer, mais aussi de révéler les normes qui régissent ces espaces, c’est-à-dire l’« ensemble de règles et de prescriptions sociales, plus ou moins formalisées » (Lévy et Lussault, 2003, p.667), qui organisent leur fonctionnement, influencent les pratiques de leurs usagers et ouvrent en eux la possibilité d’une vie en commun (Berdoulay et al., 2001 ; Capron et Haschar-Noé, 2007 ; Sabatier, 2007). Et c’est bien parce que les normes ne sont jamais définies une fois pour toutes, parce qu’elles se modifient au gré des évolutions sociales, politiques ou économiques qui affectent la société, que la fin de l’apartheid a initié un processus de redéfinition des normes d’organisation de la société sud-africaine en général, et des espaces publics en particulier. Un tel processus est d’autant plus crucial dans ces espaces que les lois mises en place par le précédent régime, et les normes qui en découlaient, ont contribué à nier leur caractère public (Houssay-Holzschuch, 2010), en restreignant notamment leur accès et leur usage à une minorité de la population définie sur des critères « raciaux », pour ne pas dire racistes. À partir du cas johannesburgeois, nous nous proposons donc d’étudier le rôle de l’art dans la production des normes qui façonnent les espaces publics, et avec eux, la ville contemporaine post-apartheid. (…) […]