Afrique du Sud / Entretien : Du Cap à Johannesburg
Entretien avec Myriam Houssay-Holzschuch, par Léo Kloeckner et Charlotte Ruggeri
–
–
–
Myriam Houssay-Holzschuch est professeure des universités en géographie à l’Université Grenoble Alpes et spécialiste de l’Afrique du Sud.
–
Vous avez fait votre thèse sur Le Cap au milieu des années 1990 et vous travaillez sur cette ville depuis, en y retournant très souvent. La ville a beaucoup changé durant toutes ces années, mais elle reste la Mother City ? Que veut dire cette expression par laquelle vous désignez Le Cap d’ailleurs ?
L’expression Mother City – la ville mère – renvoie à une entité historique. Le Cap est la ville à partir de laquelle la colonisation européenne du sous-continent d’Afrique australe a commencé. C’est donc une expression qui renvoie à cette identité de première ville blanche en Afrique australe. Si cette identité historique reste importante, on peut poser la question, comme le fait le géographe John Western : « Mère de qui ? Mère pour qui ? Et mère comment ? ». Cette expression canonique renvoie à l’histoire blanche de la colonisation, mais Le Cap est aussi la ville mère pour la communauté des Coloured, même si c’est une mère plus marâtre. Ils sont nés de cette histoire ancienne et de cette colonisation. C’est une expression employée par les habitants eux-mêmes, mais qui est propre au Cap pour désigner son ancienneté. Le Cap a un siècle ou deux de plus que Johannesburg et Durban. C’est une expression qui révèle une certaine fierté quant à l’ancienneté de la ville et ses héritages architecturaux, patrimoniaux et culturels.
La spécificité du Cap, c’est que la majorité de la population n’est pas africaine, elle est coloured1. Au départ, la majorité est blanche, mais ils sont très peu nombreux. Tout au long du vingtième siècle, la population coloured est majoritaire, les noirs étant moins nombreux que les blancs pendant l’essentiel du vingtième siècle, mais il y a eu une inversion récente. Il y a maintenant plus de noirs que de blancs au Cap.
–
Selon vous, Le Cap, par la précocité de sa ségrégation, donne naissance à une identité urbaine noire. Qu’entendez-vous exactement par cette expression ? Comment cette identité se constitue-t-elle ?
L’idée d’une identité urbaine noire va à l’encontre de la propagande de l’apartheid qui dit que les noirs sont ruraux (et doivent le rester). Cette propagande est complètement fausse. Il y a une présence noire en ville très importante depuis la moitié du dix-neuvième siècle au Cap. Les populations noires du Cap sont donc urbaines depuis plusieurs générations. Leurs racines ne sont donc plus rurales. En un siècle et demi de présence urbaine, on a le développement de toute une série de pratiques qui ne sont pas en rupture avec les cultures traditionnelles plutôt rurales mais qui ajoutent et sélectionnent des éléments. Il s’agit de productions artistiques musicales ; de réseaux sociaux très denses d’entraide ; de tontines ; d’associations de parents d’élèves ; d’associations cultuelles ; de clubs de sport, en particulier les clubs de rugby.
–
Cela signifie-t-il qu’il n’y a pas d’identité rurale noire, que la ségrégation et l’apartheid sont d’abord urbains ?
Il y a plusieurs identités noires et un des critères pour les différencier – mais ce n’est pas le seul – c’est qu’il y a des identités urbaines et des identités rurales. Il y a des identités rurales noires très fortes avec des bases politiques précoloniales et il y a aussi une ségrégation rurale.
La ségrégation puis l’apartheid sont aussi ruraux et cela fonctionne en même temps. L’une des bases du système ségrégatif sud-africain, c’est le Land Act de 1913 qui limite la possession foncière des Africains à des réserves individuelles sur de petites surfaces. Les deux ségrégations sont fonctionnellement liées. Le principe ségrégatif est d’organiser l’espace de manière fonctionnelle, complémentaire et autoritaire entre la ville et la campagne. Le rural, c’est la réserve de main-d’œuvre. L’occupation et la propriété foncière sont tolérées, voire promues sous l’apartheid avec le système des bantoustans. En opposition à cela, les villes sont des espaces blancs, les noirs sont uniquement tolérés comme main-d’œuvre, et ils sont gérés de manière directe par différents bureaux, le mode de gouvernement ayant changé au cours du vingtième siècle.
–

La ségrégation au Cap (Carte réalisée à partir du recensement de 2011 – Source : Adrian Frith)
–
Vous expliquez dans votre ouvrage sur Le Cap que les villes sud-africaines sont issues d’une histoire urbaine en 3 phases, démontrant que l’apartheid instauré en 1948 n’est que la suite logique des formes urbaines développées depuis le 17è siècle en Afrique du Sud. Aux différentes formes urbaines correspondent ainsi différents degrés d’exclusion ?
Les formes urbaines sont relativement continues entre la ville coloniale, la ville de la ségrégation et la ville d’apartheid. Le changement n’est pas de nature, mais de degré avec une ségrégation qui devient de plus en plus systématique. Pendant la colonisation, on peut échapper à la ségrégation si on rentre dans certaines catégories par exemple si on est noir, éduqué et/ou riche. La ségrégation, on peut y échapper relativement si on est coloured ou indien. Si on est Africain, on est censé habiter dans un quartier ségrégué, mais comme il n’y a souvent plus de logement disponible, on peut habiter dans un quartier spontané. Il y a encore des « trous » dans la ségrégation, elle n’est pas systématique. Par contre, sous l’apartheid tous ces espaces de liberté et de mixité – certes contrainte et relative – sont éradiqués les uns après les autres. La ségrégation devient systématique. Elle touche tous les lieux, tous les groupes de population et tous les domaines de la vie.
–
L’apartheid – aboli en 1994 – avait depuis 1948 marqué la planification et donc la forme urbaine des villes sud-africaines. Comment fonctionne le modèle urbain issu de l’apartheid ?
A partir de 1948, on a un renforcement du degré de ségrégation. Le modèle des lois a été fait pour les Africains, mais les autres groupes raciaux – que l’on définit également en 1948 par la loi – vont être ségrégués aussi. Il y aura donc à partir de 1948, les blancs dans les quartiers blancs, les noirs dans les quartiers noirs, les coloured dans les quartiers coloured alors qu’avant 1948, seuls les noirs ont une obligation législative d’habiter dans un quartier spécifique. À cela s’ajoute un apartheid économique c’est-à-dire définissant par exemple à quels emplois les personnes ont accès en fonction de leur race ; un apartheid électoral sur qui peut voter et/ou être élu en fonction de la race ; des lois mesquines sur les espaces publics avec par exemple les fameux bancs publics réservés aux blancs ; des mesures qui gouvernent la vie privée puisque les relations sexuelles et les mariages interraciaux sont interdits. Tout ceci est nouveau à partir de 1948. Sous l’apartheid, la ségrégation devient un système. L’ensemble de l’espace et de la société est régi par la ségrégation.
–
Y-a-t-il dans la ville de l’apartheid des lieux, des espaces de partage, de mixité ?
La coprésence entre les « races » existe, la différence c’est plutôt l’égalité. Les lieux de travail restent mixtes puisqu’on a besoin de la main-d’œuvre noire. Mais les noirs travaillent et les blancs dirigent. Dans l’espace domestique, il y a aussi de la mixité, le personnel étant noir. Mais la loi précise que la bonne noire qui habite sur place doit avoir un logement séparé et utiliser sa propre vaisselle. De fait les espaces mixtes égalitaires sont progressivement éradiqués. Il y a évidemment des résistances, mais cela ne suffit pas à endiguer cette éradication progressive de la mixité relativement égalitaire.
–
Pensez-vous que l’Afrique du Sud post apartheid soit entrée dans une quatrième phase urbaine, qui succéderait aux trois phases que vous identifiez dans votre ouvrage ?
Les villes sud-africaines sont entrées depuis 1994 dans une quatrième phase, mais elle est difficile à qualifier. La qualifier uniquement de phase post apartheid reviendrait à la définir par ce qui s’est passé avant 1994. La question qui permet de comprendre cette phase est plutôt : « A quel point l’apartheid régit encore ce qui se passe dans les villes aujourd’hui ? ».
–
Jacques Lévy parle de « crime contre l’urbanité » à propos de l’apartheid, soulignant lui aussi les racines urbaines de la ségrégation. Pourquoi parler de « crime contre l’urbanité » plutôt que de « crime contre l’humanité » ?
L’Organisation des Nations Unies a défini l’apartheid comme un crime contre l’humanité. Avec l’Afrique du Sud on est face à un cas impensable qui devient un exemple idéal et type de ce qu’est la ségrégation. Mais si on reprend Jacques Lévy, on peut aussi dire que c’est un crime contre l’urbanité – à condition au préalable de dire que c’est aussi un crime contre l’humanité – parce que le régime d’apartheid vise à détruire systématiquement ce qui fait que la ville est ville en particulier sa diversité. Cela inclut la diversité des populations, mais aussi les usages du sol puisque les villes d’apartheid sont extrêmement zonées entre le résidentiel et l’industriel notamment.
–

Habitat social en construction, marges du township africain de Gugulethu, Cape Town, mars 2013 (M. Houssay-Holzschuch, Photographies réalisées dans le cadre du programme de recherche PERISUD – ANR n°Suds-07-046)
–
Qu’est-ce qui change concrètement en ville à partir de 1994 et de la fin de l’apartheid ?
En 1994, les lois ségrégatives sont abolies. Tout ce qui contraignait la mobilité, les droits d’accès à la propriété ou qui obligeait les Sud Africains à vivre dans un quartier donné est aboli. En 1994, on rend les choses possibles. Tous les urbains deviennent alors des citoyens de plein droit ayant le droit d’élire le gouvernement national, puis dès 1996 des élus municipaux dans des municipalités qui sont réunifiées. Il y a donc de grands changements structuraux, mais on observe une forte inertie de l’espace.
La structure des villes ne change pas fondamentalement, tant l’espace est inerte. Les changements apparaissent de manière superficielle. Premièrement, on a l’apparition de la loi du marché pour tous les groupes raciaux alors qu’avant elle ne concernait que les blancs et une partie des coloured. La première conséquence, c’est la déségrégation des quartiers riches. Quand on est riche, quelle que soit sa race, on peut choisir d’aller vivre dans un beau quartier. Il en est de même avec les quartiers de classe moyenne. Par contre, les quartiers pauvres restent et pauvres et noirs.
Il y a d’autres évolutions urbaines importantes. C’est après l’apartheid qu’on voit le développement des communautés fermées à destination des classes moyennes et des classes supérieures. On vend un produit immobilier qui surfe sur la vague de la violence urbaine particulièrement importante dans la seconde moitié des années 1990. La communauté fermée et sécurisée devient une aménité immobilière que la population recherche.
Dans les townships les plus anciens, on observe un début de gentrification parce qu’ils sont proches du centre ville et parce qu’ils ont une identité urbaine ancienne intéressante. Toutefois, c’est une gentrification très particulière parce qu’elle est interne. Les habitants du township sont dans des processus d’ascension sociale, qui avaient pu commencer sous l’apartheid, mais qui ne peuvent se concrétiser en propriété foncière qu’à partir de la fin de l’apartheid. Avec la fin de l’apartheid, on peut devenir propriétaire foncier et par exemple acheter la parcelle à côté de sa maison pour l’agrandir. On observe également l’apparition de lieux de consommation dans les townships comme des restaurants ou des centres commerciaux à destination principalement des populations locales.
Les quartiers informels continuent de se développer, mais on a aussi une politique très importante de construction d’habitat social, plutôt en périphérie, pour abriter les populations sans logement ou qui logent dans les quartiers informels. Ces constructions représentent des millions de logement.
–
Roland Pourtier décrit les villes sud-africaines comme les villes les plus contrastées du continent africain, qu’en pensez-vous et pourquoi peut-on ou non affirmer cela à propos des villes sud-africaines ?
L’expression de Roland Pourtier s’applique aux villes sud-africaines si on prend le prisme des inégalités de revenus et de la polarisation sociale. L’Afrique du Sud est un des pays au monde, voire le pays au monde, où le coefficient de Gini – qui mesure les inégalités – est le plus fort. On a donc des villes extrêmement contrastées et cela s’exprime dans le paysage urbain avec les différents types de quartiers. De plus, puisque l’on a des villes planifiées, ces inégalités sont très visibles. Il n’y a pas vraiment de diffusion de la très grande pauvreté dans l’ensemble de la ville, mais il y a des quartiers bien identifiés et bien délimités qui sont très riches, d’autres quartiers pour les classes moyennes et enfin des quartiers pauvres. De plus l’Afrique du Sud est devenu un pays émergent où se côtoient une très grande richesse et des modes de vie très occidentalisés, des classes moyennes et des très pauvres. On n’observe pas ce phénomène sur le reste du continent. On est face à une situation plus comparable à l’Inde.
–
Vous avez comparé à plusieurs reprises le modèle urbain sud-africain au modèle urbain nord-américain. Pouvez-nous nous expliquer en quoi les villes sud-africaines peuvent à la fois correspondre à ce modèle nord-américain, mais aussi s’en éloigner ?
Claire Bénit dans un article de 19982 montre très bien qu’on a des formes urbaines similaires mais qui sont produites de manière diverse2. La ségrégation peut être produite soit par une ségrégation d’Etat comme dans le cas de l’apartheid, soit par la tyrannie des décisions individuelles, mais la forme finale est globalement la même. Les spécificités sud-africaines, hors du central business district (CBD) et des quartiers résidentiels à l’architecture basse qui sont devenus des modèles urbains courants, c’est la destruction des espaces mixtes sous l’apartheid. De plus, jusqu’à la fin de l’apartheid, le centre ville reste une zone favorisée. Il n’y a pas de ghettos péricentraux puisqu’ils ont été détruits. Le centre ville est blanc.
–

Gentrification interne – transformation ostentatoire d’une « matchbox » (maison boite d’allumettes), Gugulethu, Cape Town, mars 2013 (M. Houssay-Holzschuch, Photographies réalisées dans le cadre du programme de recherche PERISUD – ANR n°Suds-07-046)
–
Vous avez beaucoup réfléchi aux toponymes. En quoi la toponymie sud-africaine est en enjeu urbain, politique, idéologique et social particulièrement fort ?
On utilise la toponymie de manière politique, mais cela commence dès la colonisation. On donne des noms bibliques ou religieux aux nouveaux établissements : Bethléem, Calvinia. Avec la fin de l’apartheid, le changement de système politique implique une reconnaissance des langues, des cultures et des histoires qui ont été occultées ou effacées. Il y a donc un travail de restitution et on efface le pire. Dans la ville d’apartheid, certains toponymes, notamment des noms de rue, sont ridicules. Dans les quartiers coloured du Cap, notamment à Mitchell’s Plain, il y a des séries de toponymes thématiques par blocs. Il y a une série de rue qui porte des noms de planète, une autre des noms de grands crus de vin, une autre avec des noms de produits alimentaires dont une rue Robusta et une rue Arabica. On trouve aussi la rue Scrabble ou la rue Monopoly. C’est de la moquerie, on refuse à ces habitants la dignité d’habiter dans une véritable ville.
Aujourd’hui, lorsque l’on efface, ce ne sont pas ces noms qui sont effacés. La rue Robusta et la rue Arabica existent toujours, comme la rue Cocorico dans le quartier de Chantecler. On efface plutôt les noms de rues centrales et les noms d’aéroports qui portent les noms d’architectes ou de premiers ministres de l’apartheid, notamment ceux qui ont mis en place la législation des années 1950 et 1960. On commence par les aéroports parce que ce sont les portes d’entrée de l’Afrique du Sud démocratique. Un aéroport comme celui de Cape Town ne peut plus porter le nom de DF Malan, Premier ministre qui arrive au pouvoir en 1948 pour instaurer l’apartheid. On organise également des consultations pour remplacer le nom des rues des centres villes, et on donne des noms de personnalités importantes de la résistance antiapartheid, de l’histoire ou de la culture africaines. On va voir apparaître des rues portant les noms de Mandela, de Steve Biko, assassiné en 1977 par le régime d’apartheid ou de la chanteuse Miriam Makeba.
On ne supprime pas de noms de villes, mais on encastre. L’ancien nom de Pretoria va continuer de désigner le centre ville anciennement blanc. Par contre la grande municipalité réunifiée avec les townships va s’appeler Tshwane qui est le nom de langue africaine. De fait, cela pose les questions de qui commémore-t-on, qui décommémore-t-on, qui décide de quel nom ? On a ainsi reproché à l’ANC de ne commémorer que des personnalités politiques de l’ANC.
Récemment, il y a eu l’apparition de toponymes vendeurs, qui ont de la visibilité internationale. Des toponymes qui attirent les investisseurs étrangers, comme les centres commerciaux Century City ou Montecasino. C’est donc du marketing urbain qui passe par la toponymie.
–
Dans un article sur la violence sud-africaine vous expliquez que l’Afrique du Sud est marquée par une culture de la violence3. Philippe Guillaume, à propos de Johannesburg, rappelle qu’on parle de la ville comme une city of crime4. Comment s’exprime cette violence en ville ? La ville est-elle le lieu privilégié de la violence en Afrique du Sud ?
Au-delà de la violence structurelle du régime d’apartheid, ce qui demeure c’est la violence physique. Ce sont d’abord les hommes noirs qui en sont victimes. En ville, elle peut être très localisée, sur quelques commissariats. C’est le cas au Cap où le centre ville est extrêmement sécurisé pour les touristes depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000. Les banlieues blanches sont aussi très sûres avec une criminalité qui est plutôt du cambriolage. Par contre, les meurtres et tentatives de meurtre sont localisés autour de 4 ou 5 commissariats des Cape Flats.
De plus, il ne faut pas oublier que la première des violences sud-africaines est la violence domestique et la violence sexuelle. C’est une violence très diffuse sur l’ensemble du territoire.
–

Trois communautés fermées, Durbanville, Cape Town, juillet 2009 (M. Houssay-Holzschuch, Photographies réalisées dans le cadre du programme de recherche PERISUD – ANR n°Suds-07-046)
–
A quoi ressemble une ville sud africaine en 2013 ?
Le centre ville est en CBD (central business district), avec éventuellement plusieurs CBD. Autour du centre ville, il y a des quartiers péricentraux résidentiels qui se sont déségrégués tôt – dès la fin des années 1980 – et qui ont des destinées très variables. Ces quartiers étaient blancs avant 1994. Ils ont eu une phase d’appauvrissement avec des migrants, mais certains d’entre eux sont entrés dans des processus de rénovation urbaine et sont (re)devenus très cosmopolites. Au- delà, on observe des banlieues scindées en deux. D’un côté de la ville, il y a les banlieues/suburbs des classes moyenne et riche, majoritairement blanches, même si les quartiers les plus récents sont très mixtes. De l’autre côté de la ville, il y a les quartiers de banlieues pauvres, anciens townships, avec essentiellement des noirs et des coloured. Disséminés, comme par exemple au sein des banlieues favorisées, on observe des camps de squatteurs et des quartiers informels éventuellement progressivement remplacés par des petits quartiers d’habitat social. Autour des townships, on constate également le développement des quartiers informels et de l’habitat social.
–
En juin 2013, les villes brésiliennes ont été le théâtre d’une révolte urbaine sans précédent dénonçant le coût des infrastructures sportives de la Coupe du monde de football et des Jeux Olympiques. En 2010, l’Afrique du Sud organisait la Coupe du monde de football et est comme le Brésil un pays émergent aux inégalités socio-économiques fortes. Il n’y a pas eu de révolte similaire, pourquoi ?
Cela peut s’expliquer par plusieurs raisons. Tout d’abord, la Coupe du monde a servi d’accélérateur pour des projets urbains prévus de longue date et en particulier des projets de développement des transports en commun. Ces projets étaient nécessaires, prévus et faisaient même partie de l’argumentaire pour « vendre » la Coupe du monde. L’événement était l’occasion de réaliser des aménagements dont les villes sud africaines avaient besoin. La logique était de dire « on va faire une ville mondiale pour assurer le développement local ». C’est une logique encore très forte au Cap, mais qui n’est pas sans contradictions.
L’autre différence relève des stades. Les stades construits pour la Coupe du monde en 2010 sont des nouveaux stades. De fait, il ne s’agit pas d’une restructuration d’un quartier existant, d’autant plus que les stades ont été souvent construits dans des zones non bâties. Il n’y a donc pas forcément de conflits d’usage violents. Le stade du Cap a été construit en bord de mer dans un ancien quartier blanc péricentral, mais dans un immense parc destiné à des équipements sportifs. Puisqu’il y avait déjà des équipements sportifs, il n’y a pas eu de changements majeurs. A Johannesburg, le stade a été construit dans la zone tampon des terrils aurifères qui était vide, entre l’ancienne ville blanche et l’ancienne ville noire. Le stade revêtait donc une dimension symbolique importante en reliant ceux deux quartiers.
Enfin, il y a eu une vraie fierté nationale liée au fait que c’était la première fois qu’un événement de cette ampleur était organisé sur le continent africain. Les populations se sont identifiées dans cette fierté, même s’il y a eu des destructions de quartiers, notamment les quartiers informels sur la route des aéroports. Les autorités avaient tout de même prévu ces expulsions dans le cadre de politiques de relogement, même si les méthodes sont contestables et les résultats aussi. La Coupe du monde s’est donc inscrite dans une dynamique urbaine et un discours de développement local.
–

Blikkiesdorp, le « village en boites de conserve » – zone de relogement transitoire, Cape Town, mars 2013 (M. Houssay-Holzschuch, Photographies réalisées dans le cadre du programme de recherche PERISUD – ANR n°Suds-07-046)
–
Johannesburg est souvent considérée comme la capitale de l’Afrique australe, la ville mondialisée d’Afrique. Avec son paysage urbain et son CBD moderne, Johannesburg se démarque-t-elle des autres villes sud-africaines, voire africaines ?
Le paysage urbain de Johannesburg ne se démarque pas. Certes le CBD est plus grand et ostentatoire, mais c’est le même paysage qu’au Cap ou à Durban, voire Lagos, Nairobi, Accra ou Abidjan. Johannesburg est une capitale économique et une capitale migratoire. C’est une ville africaine cosmopolite avec une population importante qui vient du reste du continent, notamment des pays limitrophes comme le Mozambique dont la population vient travailler dans les mines depuis longtemps ; le Zimbabwe pour fuir la situation politique du pays. Les migrants viennent aussi de la République démocratique du Congo, du Gabon ou du Nigeria. Johannesburg est le pôle économique du continent. On constate une forte xénophobie comme avec les émeutes de 2008 qui causèrent la mort d’une soixantaine de personnes victimes de véritables pogroms anti Mozambicains, Congolais ou Ougandais.
–
Johannesburg s’impose-t-elle de fait comme la tête du réseau urbain sud-africain, laissant Le Cap ou Durban aux rangs de grandes villes secondaires ?
Durban et Bloemfontein sont des villes secondaires. Le Cap est un peu différente du fait de la distance par rapport à Johannesburg. On a presque un fonctionnement en parallèle de deuxième grande ville, un peu à l’image de Madrid-Barcelone. Le Cap dispose aussi d’atouts spécifiques, surtout l’atout du cadre. Le Cap a donc une économie de services, de loisirs et une économie
touristique dans un cadre de vie particulièrement agréable. Certaines grandes entreprises internationales choisissent Le Cap pour établir leur siège social sud-africain ou africain et pas Johannesburg. Le Cap n’est pas une ville strictement dépendante de Johannesburg, même si les liens sont très intenses entre les deux villes. La ligne aérienne Le Cap-Johannesburg est la dixième ligne la plus fréquentée au monde avec plus de 4 millions de voyageurs en 2012.
–
Quels sont les défis auxquels les villes sud-africaines doivent faire face en 2013 ?
Le premier défi est la démocratie. La démocratie ne doit pas être seulement électorale. Il faut qu’il y ait une vraie démocratisation économique pour faire face à la très grande pauvreté de la majorité de la population. Il faudrait aussi une réinvention du politique puisque vingt ans après la fin de l’apartheid, l’ANC est toujours au pouvoir avec des problèmes de corruption et d’enrichissement personnel plus ou moins frauduleux.
Entretien réalisé en août 2013 par Léo Kloeckner et Charlotte Ruggeri
–
- Une catégorie raciale légalement définie sous l’apartheid et encore influente sur les identités, elle regroupait toutes les personnes n’entrant pas dans les 3 autres catégories définies (Blancs, Indiens, Noirs), dont, en particulier, les descendants des premiers colons blancs, de leurs esclaves et des Khoisan autochtones. [↩]
- Bénit C., 1998, « Gouvernement urbain et production de la ségrégation : quelles leçons de la « ville d’apartheid » ? Une comparaison Johannesburg-Los Angeles », Revue européenne des migrations internationales, 14-1, 159-192. [↩]
- Houssay-Holzchuch M., 2002, « La violence sud-africaine. Essai d’interprétation. », Etudes, 2002/7, Tome 397, 43-52. [↩]
- Guillaume P., 2004, « La violence urbaine à Johannesburg. Entre réalité et prétexte. », Geographica Helvetica, 59, 188-198 [↩]



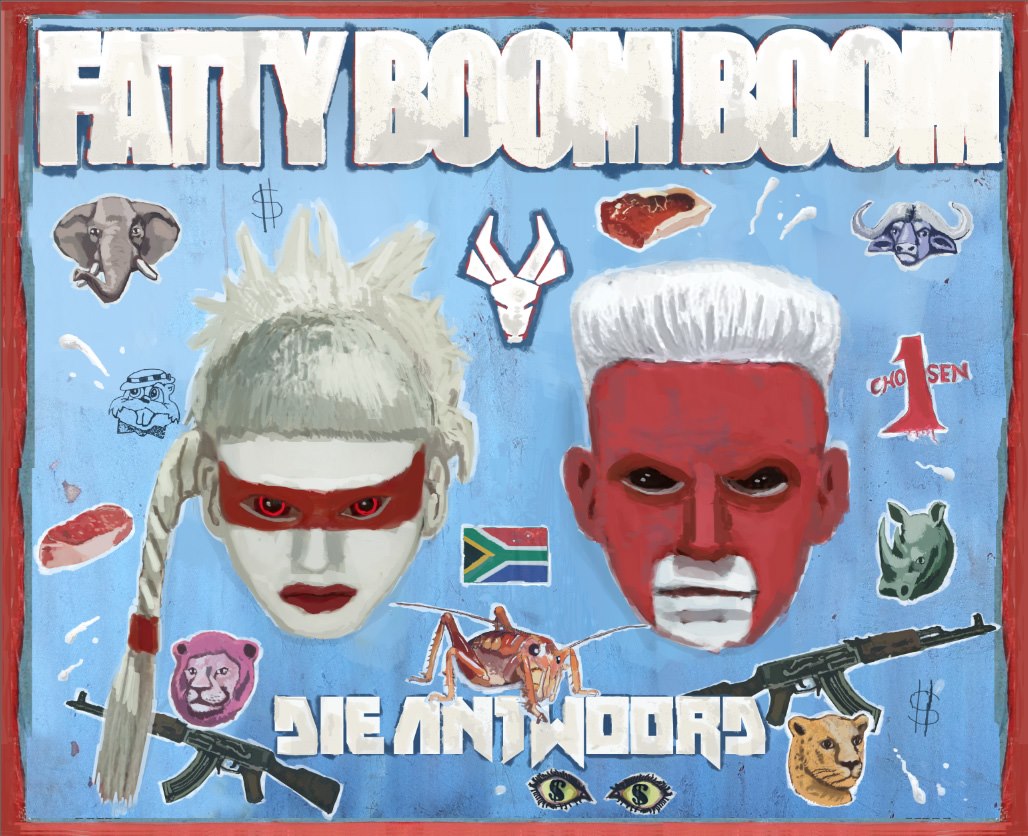







Comments
One Response to “Afrique du Sud / Entretien : Du Cap à Johannesburg”Trackbacks
Check out what others are saying...[…] Entretien / Du Cap à Johannesburg avec Myriam Houssay-Holzschuch : Urbanités […]