Lu / Discriminations dans la ville. Sexismes, racismes, LGBTphobies dans l’espace public, d’Arnaud Alessandrin et Johanna Dagorn
Axel Ravier
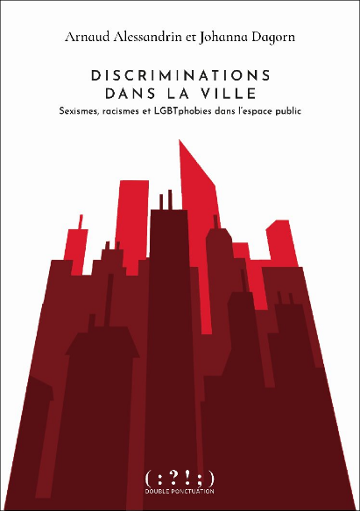 Dans les pas des premier·ères penseur·euses de la sociologie urbaine, Arnaud Alessandrin et Johanna Dagorn reprennent à leur compte l’idée de ville comme « laboratoire social » (Robert E. Park) pour s’interroger sur les effets sociaux de la grande ville sur les personnalités humaines, et examiner la place des minorités dans les espaces du quotidien.
Dans les pas des premier·ères penseur·euses de la sociologie urbaine, Arnaud Alessandrin et Johanna Dagorn reprennent à leur compte l’idée de ville comme « laboratoire social » (Robert E. Park) pour s’interroger sur les effets sociaux de la grande ville sur les personnalités humaines, et examiner la place des minorités dans les espaces du quotidien.
Tou·tes deux sociologues à l’Université de Bordeaux-Montaigne, iels nous livrent, avec Discriminations dans la ville, les résultats de plusieurs enquêtes consacrées à la spatialisation des inégalités. Après plusieurs numéros des Cahiers de la lutte contre les discriminations (LCD) consacrées à ces questions – qu’iels co-dirigent ensemble –, l’ouvrage voit dans la ville des moyens multiples d’être au monde, où « loin d’un émiettement infini, d’un hasard des rencontres, subsistent des régularités, des dominations, des privilèges » (p. 14).
Les auteur·ices résument les résultats d’enquêtes qu’iels ont menées entre 2014 et 2020 dans plusieurs agglomérations de France hexagonale, notamment Bordeaux et Rennes. Ces recherches reposent sur une méthodologie mixte, entre enquêtes de victimation quantitatives1, et entretiens semi-directifs. Cette combinaison de méthodes a pour objectif de porter une attention sensible, « un regard sur les effets, les subjectivités et les représentations [des discriminations] » (p. 19).
Ces travaux s’intéressent à trois types de discriminations : le sexisme, le racisme et les LGBTphobies, qui constituent les trois grandes parties de l’ouvrage. Les auteur·ices ont pour objectif d’identifier les mécanismes et les conséquences des actes discriminants relatifs à ces trois dimensions, encore trop souvent peu prises en compte conjointement par les politiques d’égalité (p. 21-24) (Torres, 2022).
Les chercheur·euses prennent comme point de départ les recherches déjà nombreuses en sociologie urbaine consacrées à la place des minorités dans la ville, avec l’ambition d’en combler les points aveugles, notamment relatifs à l’intersection des discriminations. C’est à partir du « sentiment de discrimination » qu’iels construisent leurs enquêtes et tentent ainsi de proposer un large panorama des vécus.
–
Chiffrer le sexisme, le racisme, et les LGBTphobies
La première partie de l’ouvrage est consacrée à la question du sexisme dans la ville, et plus spécifiquement dans les espaces publics de cette dernière. À partir de la notion d’un « continuum des violences » subies par les femmes, récemment illustrée par l’enquête VIRAGE (Brown et al., 2021), les auteur·ices considèrent que « la mise en vulnérabilité des femmes n’est pas le produit d’une inégalité biologique […] [mais] le produit d’un impensé : celui de l’espace urbain comme théâtre d’expression des normes de genre et de domination » (p. 34). Afin d’appréhender les discriminations et les pratiques spatiales qui en découlent, les sociologues reviennent sur la socialisation différenciée entre garçons et filles, dans la famille comme à l’école, qui se traduit dans une construction genrée de la peur (Pain, 2001 ; Lieber, 2008). L’apprentissage féminin de la peur prend appui sur des réalités objectives. En effet, « toutes les femmes [ont déjà] fait l’expérience du sexisme dans l’espace urbain ». Pourtant plus de 30 % des enquêtées n’en avaient jamais parlé avant l’étude (p. 53). Les chercheur·euses estiment que nous faisons face à une « banalisation » des événements sexistes.
Qu’en est-il des pratiques des mobilités ? Si la ville est un « immanquable », un lieu de passage obligé, « c’est à la condition de stratégies nombreuses » que les femmes se déplacent. « Mettre les écouteurs sur les oreilles, faire attention à ses vêtements, sortir en groupe, éviter certains quartiers, etc. » (p. 44), ces dispositions nombreuses nous rappellent que le genre construit la mobilité, cette dernière étant dépendante des actions humaines (Massey, 1994 ; Hanson, 2010). En outre, vivre la ville est aussi une question de conditions : de classe (la voiture étant privilégiée par certaines – les plus aisées, qui voient d’ailleurs la ville comme un espace sûr), de statut (être étudiant·es, augmentant la fréquence des actes de harcèlement, p. 47) mais aussi d’apparence, notamment à travers l’imbrication entre le sexisme et la grossophobie, les femmes perçues comme grosses évitant à 68 % des espaces par peur d’actes de harcèlement (p. 51).
La deuxième partie de l’ouvrage se concentre sur l’expérience du racisme. Malgré l’héritage de la sociologie urbaine américaine, il semble que la sociologie française ait tardé à prendre en compte la race comme variable dans l’élaboration des politiques publiques urbaines, mais aussi plus globalement comme élément constitutif du rapport à la ville (Palomares, 2013 ; Palomares et Roux, 2021). Cette partie se base sur deux enquêtes, menée en 2019 et 2021, dans deux métropoles françaises. Les auteur·ices rappellent que cette discrimination n’est pas nouvelle, mais s’oppose aujourd’hui considérablement à l’idéal d’égalité, notamment porté par les administrations (p. 57). Les enquêtes basées sur le sentiment de discrimination rappellent que les personnes victimes de racisme le sont particulièrement à l’embauche (33 %, soit 3 points de pourcentage de plus que les victimes de sexisme), mais aussi dans les services publics (8 % des personnes, p. 60). Ces résultats font écho des rapports conflictuels qu’entretiennent les institutions, et spécifiquement les forces de l’ordre avec les personnes racisées, de quartiers populaires (Jobard, 2006 ; Jobard & Névanen, 2007 ; Fassin, 2011). Ces institutions sont peu mobilisées par les victimes, qui portent très peu plainte (p. 70) et qui dans tous les cas, ne se sentent que peu écoutées (83 % des enquêté·es victimes de racisme contre 65 % en moyenne pour le reste de la population, p. 73). Une donnée intéressante concerne les réactions aux discriminations : 17 % des personnes victimes de racisme en parlent sur les réseaux sociaux (contre 4 % pour le reste de la population, p. 73). Ce chiffre fait sûrement écho à la place grandissante du web dans les mobilisations, qui permet pour certaines communautés de construire et de partager une expérience minoritaire commune (Le Bail & Chuang, 2021 ; également dans le cas du féminisme, voir Jouët et al., 2017). Bien qu’il soit nécessaire de déterritorialiser le racisme (Kirszbaum, 2015), cette partie de l’ouvrage semble négliger la dimension spatiale, pourtant mise en évidence par l’enquête TéO 1, qui rappelle que les principaux lieux du racisme sont les espaces publics (Beauchemin et al., 2015 : 457). Spatialement, l’ouvrage rappelle enfin que les discriminations ont lieu « dans et hors du quartier [d’habitation], car une immense majorité des personnes relatant des faits de racisme les situent en dehors de ce dernier, ou en provenance de personnes de l’extérieur » (p. 70).
La dernière partie de l’ouvrage revient sur les discriminations relatives aux personnes LGBTIQ+, à partir d’une enquête de 2018 dédiée et inédite selon les auteur·ices, riche de 1 643 réponses collectées via la diffusion d’un questionnaire. Les profils des répondant·es au questionnaire rejoignent ceux des enquêtes menées auprès des populations LGBTIQ+ depuis de nombreuses années : on note une légère surreprésentation d’hommes, une surreprésentation de cadres, peu de personnes des plus de 65 ans et l’absence des moins de 18 ans (p. 81-82).
Un des résultats de l’étude semble à nouveau être la quotidienneté des événements LGBTphobes. En effet, « pour 83 % [de ces personnes], un événement LGBTphobe s’est déroulé au cours des douze derniers mois » (p. 86), étant dans la grande majorité des regards insistants (30 % des enquêté·es) et des commentaires non désirés et/ou des injures (29 %). Néanmoins, le rapport à l’espace semble de nouveau genré, les lesbiennes se sentant moins sereines en ville que les gays (p. 83). Par ailleurs, l’un des apports de l’enquête est la production de données à propos des personnes trans. En effet, « c’est encore une fois les personnes trans, queer, non-binaires ou intersexes qui témoignent de la fréquence [d’agression] la plus élevée : 17 % d’entre elles subissent ces agressions plus de 10 fois dans l’année » (p. 88). Néanmoins, le livre décale son objet en ne se concentrant que peu sur les questions d’ambiances urbaines, mais plutôt sur les relations au service public, les auteur·ices notant une absence d’études sur les relations des personnes LGBTIQ+ à ces services (p. 94). De ce fait, « on obtient qu’au cours des douze derniers mois, en moyenne, 19 % des personnes LGBTIQ+ se sont senties discriminées dans les services publics » (p. 96), avec un « effet sexe » dans la répartition des lieux, les femmes étant victimes dans les services de santé notamment, et les hommes dans les services de police. Enfin, malgré ces discriminations, « tout paraît nous dire que les victimes “font avec” » (p. 101), les personnes ne changeant pas leur habitude de fréquentation (pour 60,98 % des hommes cis et gays ; 55,34 % des femmes cis et lesbiennes et 43,18 % des personnes trans, différence tout de même notable). Une explication possible se trouve notamment dans la difficulté à éviter ces services, en opposition aux espaces privés, résultat allant en faveur de l’un des objectifs conclusifs de l’ouvrage (rappelant les théories du droit à la ville de Lefebvre et de Harvey) : celui de la production de la science dans une volonté réformatrice.
–
Témoin(s) sensible(s) : s’abstenir
Deux éléments en particulier répondent aux objectifs de l’ouvrage, notamment celui de proposer une approche « sensible » et « émotionnelle » des discriminations. Tout d’abord, les enquêtes questionnent les personnes victimes sur l’« après », certes sur leurs « actions concrètes », le fait d’en parler à des proches et/ou à des institutions, mais surtout sur leur ressenti. Comme le rappellent les auteur·ices en conclusion, les discriminations abîment les victimes, et notamment leur confiance en soi, et cela, au-delà même du lien à l’espace urbain (p. 108). Être victime d’actes discriminants provoque chez la grande majorité des enquêté·es, trois principales émotions : la peur, la colère (pouvant d’ailleurs être un facteur de politisation, p. 109 ; Talpin et al., 2021) et la tristesse. D’autres peuvent expliquer l’absence de demande d’aide (notamment dans les cas des populations LGBTIQ+) : la honte ; la peur ; et l’absence de nécessité d’en parler. Ces émotions permettent aussi, voire surtout, de distinguer quatre approches face au « sentiment de discrimination » : fataliste ; relativiste ; pédagogique ; contestataire (p. 113).
D’autre part, l’apport le plus intéressant se situe selon moi du côté de l’analyse des témoins des actes discriminants. En effet, les enquêtes arrivent à montrer l’agissement (ou non) des témoins, qu’il s’agisse de sexisme, de racisme ou de LGBTphobies. On note donc la présence de témoins actifs, mais surtout de témoins passifs. En effet, dans le cas de discriminations sexistes dans l’espace public, « la vue d’un acte sexiste ne provoque aucune réaction chez plus de 88 % d’entre eux, et, quand ils agissent, pour près de 5 %, c’est pour contribuer au sexisme dont ils sont témoins par des ricanements, ou en filmant les faits » (p. 44). Ce constat est également présent, dans une moindre mesure tout de même, dans le cas d’actes LGBTphobes, où le passage du statut de témoin à celui d’acteur se retrouve également dans des proportions variables, en fonction de la nature de l’agression (homophobe, lesbophobe…). Le pourcentage le plus élevé de ce passage à l’acte se trouve chez les victimes de transphobie, où près de 38 % des victimes indiquent que les témoins ont fini par participer à l’agression (p. 89). Autre fait intéressant, être victime de discrimination agirait en faveur du passage de témoin à acteur, cette fois de lutte face aux actes. En effet, les victimes de sexisme, de racisme et de LGBTphobies disent agir à la vue de discriminations « les concernant ».
–
Des analyses sans visages
Quelques regrets cependant à la lecture de cet ouvrage : bien qu’il souhaite s’inclure dans une perspective intersectionnelle, il ne fait que la suggérer, tant par les méthodologies déployées qui s’en tiennent surtout à une approche quantitative de l’analyse du rapport à l’urbain, que dans la forme même de l’ouvrage et son hybridation difficile des thématiques, où l’on semble survoler les sujets. On y lit les manières d’être, les modes de vie, seulement au travers des statistiques, et bien que ces dernières représentent un apport majeur dans la compréhension des phénomènes discriminatoires (comme le montrent les enquêtes TéO et VIRAGE notamment : voir Primon & Simon, 2018), elles semblent aussi montrer, leurs limites dans les analyses spatiales intersectionnelles – ce que les auteur·ices soulignent par ailleurs. L’absence de cette perspective se voit notamment à la rareté des extraits d’entretiens contextualisés (Mazouz, 2015). Ces derniers auraient sûrement permis d’éviter des analyses intersectionnelles parfois au rabais. Ces limites sont d’autant plus flagrantes, qu’il est désormais bien documenté que « les problématiques de déplacements [dans la ville] n’ont pas forcément les mêmes enjeux chez les femmes afro-américaines et chez les femmes blanches » (Parker et Gibert dans Gervais, 2020 : 186).
Bien que des éléments contextuels soient évoqués (les affaires d’agressions récentes, les mouvements de luttes contre les discriminations…), les auteur·ices auraient pu insister sur des éléments caractéristiques des villes étudiées, et cela, afin de ne pas perdre de vue qu’elles orientent les mobilités et plus largement les comportements. En insistant sur les actions institutionnelles (par exemple, les municipalités engageant des projets en matière de lutte contre les discriminations), les lieux commerciaux, voire l’urbanisme au sens architectural (Gervais, 2020 ; Angélil et al., 2022), les auteur·ices auraient pu nous fournir des analyses plus incarnées. Par exemple, dans le cas des populations LGBTIQ+, quels sont les espaces protecteurs au sein des villes étudiées, à distance de la métropole parisienne, souvent associée à une plus grande tolérance à l’égard des minorités (Eribon, 1999 ; Giraud, 2016) ? Nous aurions voulu savoir si des espaces « gayfriendly » sont fréquentés, et si tel est le cas, de quelle manière les individus y accèdent ? En bref, il aurait été souhaitable d’avoir plus d’informations sur la construction des savoirs vernaculaires spatiaux de populations minorisées, notamment analysés dans les recherches cartographiques des espaces fréquentés et/ou évités (Blidon, 2008 ; Chetcuti et Jean-Jacques, 2018).
Dans l’ensemble, l’ouvrage a le mérite de rappeler des éléments contextuels importants de la formation des identités genrées et raciales connues en sociologie et de proposer une lecture simple et claire des faits sexistes, racistes et LGBTphobes de ces dernières années. L’absence notable de bibliographie et les manques soulignés ne permettront sans doute pas aux sociologues (notamment de l’urbain) de tirer parti des résultats présentés. Pour autant, et là est sûrement l’objectif de l’ouvrage, il permettra pour sûr aux acteur·ices de la lutte contre les discriminations de saisir de façon claire ces phénomènes.
AXEL RAVIER
–
Axel Ravier est doctorant en sociologie au DySoLab de l’Université de Rouen-Normandie et au Centre en études genre de l’Université de Lausanne. Il est également Fellow de l’Institut Convergences Migrations. Il travaille sur les modes de vie des minorités sexuelles au sein des grands ensembles franciliens. Il participe à la réédition de l’ouvrage Sociologie de l’homosexualité (La Découverte) avec Sébastien Chauvin et Arnaud Lerch.
–
Référence de l’ouvrage : Alessandrin A. et Dagorn J., 2023, Discriminations dans la ville. Sexismes, racismes et LGBTphobies dans l’espace public, Double Ponctuation, 130 p.
–
Bibliographie
Angélil M., Malterre-Barthes C. et Something Fantastic, 2022, Immigration et ségrégation spatiale : l’exemple de Marseille, Marseille, Éditions Parenthèses, 288 p.
Beauchemin C., Hamel C., Simon P. et Héran F., 2015, Trajectoires et origines: enquête sur la diversité des populations en France, Paris, INED éditions, 624 p.
Blidon M., 2008, « La casuistique du baiser. L’espace public, un espace hétéronormatif », EchoGéo, no 5, en ligne.
Brown E., Debauche A., Hamel C. et Mazuy M., 2021, Violences et rapports de genre : enquête sur les violences de genre en France, Paris, INED éditions, 528 p.
Chetcuti-Osorovitz N. et Jean-Jacques S., 2018, « Usages de l’espace public et lesbianisme : sanctions sociales et contournements dans les métropoles françaises », Cahiers de géographie du Québec, vol. 62, no 175, p. 151‑167.
Eribon D., 1999, Réflexion sur la question gay, Paris, Fayard, 528 p.
Fassin D., 2011, La force de l’ordre : une anthropologie de la police des quartiers, Paris, Editions du Seuil , 392 p.
Gervais L., 2020, Le sexe de la ville : identités, genre et sexualité dans la ville états-unienne, Paris, Éditions Syllepse, 347 p.
Giraud C., 2016, « La vie homosexuelle à l’écart de la visibilité urbaine. Ethnographie d’une minorité sexuelle masculine dans la Drôme », Tracés, n°130, p. 79-102.
Hanson S., 2010, « Gender and mobility: new approaches for informing sustainability », Gender, Place & Culture, 2010, vol. 17, no 1, p. 5‑23.
Jobard F., 2006, « Police, justice et discriminations raciales » in Fassin E., Fassin D. (dir.), De la question sociale à la question raciale ?, Paris, La Découverte, p. 211‑229.
Jobard F. et Névanen S., 2007, « La couleur du jugement. Discriminations dans les décisions judiciaires en matière d’infractions à agents de la force publique (1965-2005) », Revue française de sociologie, vol. 48, no 2, p. 243‑272.
Kirszbaum T., 2015, « Quand la discrimination territoriale occulte les discriminations ethnoraciales », Les Cahiers du Développement Social Urbain, vol. 61, no 1, p. 17‑20.
Le Bail H. et Chuang Y., 2021, « La jeunesse asiatique française en ligne : construction d’une identité collective et lutte contre le racisme », ROUTED, no 15, en ligne.
Lieber, M., 2008, Genre, violences et espaces publics. La vulnérabilité des femmes en question, Paris, Presses de Sciences Po, 328p.
Massey D., 1994, Space, Place, and Gender, Minneapolis, University of Minnesota Press, 288 p.
Mazouz S., 2015, « Faire des différences. Ce que l’ethnographie nous apprend sur l’articulation des modes pluriels d’assignation », Raisons politiques, vol. 58, no 2, p. 75‑89.
Pain R., 2001, « Gender, Race, Age and Fear in the City », Urban Studies, vol. 38, no 5‑6, p. 899‑913.
Palomares É., 2013, « Le racisme : un hors-champ de la sociologie urbaine française ? », Métropolitiques, en ligne.
Palomares É. et Roux G., 2021, « Quand les politiques urbaines font exister la race », Terrains & travaux, vol. 39, no 2, p. 5‑29.
Primon J. et Simon P., 2018, « Mesurer le racisme ? L’apport des enquêtes quantitatives à la sociologie du racisme », Sociologie et sociétés, vol. 50, no 2, p. 175‑202.
Torres Garcia M., 2022, Administrer l’égalité : construction, articulation et conduite des politiques catégorielles de la ville de Paris, Thèse de doctorat, Paris, EHESS, 516 p, en ligne.
–
Couverture : Day of Tolerance (Anete Lusina, Pexels, 2020).
–
Pour citer cet article : Ravier A., 2023, « Discriminations dans la ville. Sexismes, racismes, LGBTphobies dans l’espace public, d’Arnaud Alessandrin et Johanna Dagorn », Urbanités, Lu, septembre 2023, en ligne.
–
- Les enquêtes de victimation consistent à interroger directement les individus sur les infractions dont iels ont été victimes. [↩]











