Lu / The Accidental Ecosystem : people and wildlife in American cities, de Peter S. Alagona
Anne-Lise Boyer
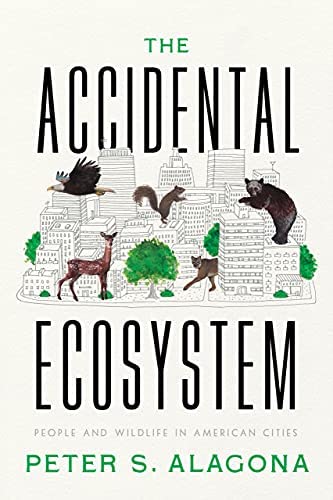 Depuis les années 1990, l’écologie urbaine, en tant que sous-champ de l’écologie scientifique, prend de l’ampleur en lien avec l’accélération de l’urbanisation à l’échelle globale, la multiplication des débats sur l’impact écologique des villes (importantes émettrices de gaz à effet de serre) et le foisonnement des recommandations en matière d’urbanisme durable (aménagement de trames vertes, par exemple). L’ouvrage de Peter S. Alagona, The Accidental Ecosystem : People and Wildlife in American Cities, paru en 2022 aux Presses de l’Université de Californie, s’inscrit dans ce contexte. Il propose en effet une approche pluridisciplinaire – écologie, biologie de la conservation, histoire environnementale, géographie urbaine – pour explorer le paradoxe suivant : comment se fait-il qu’aujourd’hui de nombreuses villes étatsuniennes comptent plus d’animaux sauvages qu’au cours des 150 dernières années, alors que la faune mondiale a diminué en moyenne de 60 %, avec plus d’un million d’espèces en danger d’extinction ?
Depuis les années 1990, l’écologie urbaine, en tant que sous-champ de l’écologie scientifique, prend de l’ampleur en lien avec l’accélération de l’urbanisation à l’échelle globale, la multiplication des débats sur l’impact écologique des villes (importantes émettrices de gaz à effet de serre) et le foisonnement des recommandations en matière d’urbanisme durable (aménagement de trames vertes, par exemple). L’ouvrage de Peter S. Alagona, The Accidental Ecosystem : People and Wildlife in American Cities, paru en 2022 aux Presses de l’Université de Californie, s’inscrit dans ce contexte. Il propose en effet une approche pluridisciplinaire – écologie, biologie de la conservation, histoire environnementale, géographie urbaine – pour explorer le paradoxe suivant : comment se fait-il qu’aujourd’hui de nombreuses villes étatsuniennes comptent plus d’animaux sauvages qu’au cours des 150 dernières années, alors que la faune mondiale a diminué en moyenne de 60 %, avec plus d’un million d’espèces en danger d’extinction ?
Entre une courte introduction et conclusion, ce livre est composé de quatorze chapitres. Le chapitre 1 intitulé « Hot spots » montre comment plusieurs des plus grandes villes des États-Unis sont situées sur des sites qui, avant leur développement, étaient particulièrement riches et divers en termes écologiques : New-York est située au carrefour biologique de plusieurs habitats, entre les basses terres de l’Hudson et le piémont du nord des Appalaches, la ville se trouve aussi sur une interface entre eau de mer et eau douce ; Los Angeles était un hotspot de biodiversité avec son climat doux et des habitats naturels diversifiés (dunes, marais, prairies) qui hébergeaient de nombreux oiseaux migrateurs ; même Las Vegas, considérée aujourd’hui comme l’archétype de la ville contre nature, porte son nom espagnol en référence à la présence de prairies d’herbes sauvages du désert de Mohave. C’est au milieu du XIXe siècle, dans le contexte d’industrialisation, que s’amorce la destruction des écosystèmes, au cœur des zones urbaines mais aussi dans les régions environnantes. En effet, celles-ci sont intensivement mises au service des villes où la demande en ressources naturelles va croissante.
–
Un écosystème accidentel : le retour des animaux en ville
Chacun des treize autres chapitres s’ouvre sur un fait marquant, dans des villes étatsuniennes variées, touchant une espèce en particulier dont l’évolution illustre le propos du livre, à savoir les conditions de sa disparition, celles qui ont permis son retour et les défis que posent désormais la cohabitation entre humains et animaux sauvages.
Le chapitre 2, « The Urban Barnyard », revient sur la disparition des animaux de fermes – vaches, cochons, chevaux – en villes entre le milieu du XIXe siècle (hygiénisme) et les années 1920 (électrification et débuts du tramway). Le chapitre 3 prend l’exemple de l’écureuil gris de Caroline. Celui-ci, largement répandu avant l’arrivée des Européens, disparait dès le XVIIIe siècle avec le développement de la ville moderne où les arbres sont rares. Il fait son retour au début du XXe siècle, à New-York avec notamment la création de Central Park dont il est aujourd’hui l’un des célèbres habitants. À partir du modèle d’urbanisme de Frederick Law Olmsted, la plupart des villes étatsuniennes construisent ensuite des parcs publics arborés, mettant ainsi en place les conditions du retour de l’écureuil gris, l’un des premiers animaux sauvages à revenir au cœur des villes américaines.
Le chapitre 4, « Bambi Boom » nous fait quitter les centres-villes pour les suburbs. Si celles-ci ont indéniablement participé à la destruction d’espaces de nature, elles ont aussi contribué à créer de nouveaux habitats à l’interface entre zone urbaine et terres agricoles ou forestières. Après la Seconde Guerre Mondiale, la croissance des banlieues verdoyantes et le déclin de la chasse en lien avec le mode de vie qui s’urbanise ont contribué au retour de la faune sauvage dans les franges urbaines. Par exemple, la biche à queue blanche en voie de disparition dans les années 1930 (voir le film de Disney Bambi, qui sort en 1942) fait son retour dans les suburbs à partir des années 1970. Le chapitre 5, « Room to Roam », s’intéresse au passereau gobe-moucheron, un petit oiseau natif de la côte californienne à l’origine de la création en 1972 du premier refuge pour la faune urbaine dans la baie de San Franscisco, le Don Edwards National Wildlife Refuge. À sa suite, la loi fédérale sur les espèces en danger est actée au Congrès en 1973. Ces mesures sont prises dans le contexte d’une opposition croissante à l’étalement urbain dans les villes de la Sun Belt et notamment de l’Ouest des États-Unis. Le chapitre 6, « Out of the Shadows », se concentre lui sur la présence de coyotes en ville, considérés en écologie comme une espèce remarquablement adaptée à l’urbain (« urban adapter »), qui fait facilement la navette entre les zones sauvages et urbaines, notamment la nuit. Le chapitre 7, « Close Encounters », s’ouvre sur le face à face avec un ours devenu bipède dans une banlieue du New Jersey en 2014, « l’état des États-Unis le plus peuplé en humains et en ours » (p. 84). La présence de cet animal, particulièrement charismatique depuis le début du XXe siècle, a soulevé un vif débat sur le défi que représente la coexistence avec la faune sauvage.
Le chapitre 8 « Home to Roost » nous emmène à Pittsburgh en Pennsylvanie où la réintroduction de l’aigle à tête blanche, l’oiseau national des États-Unis, a été un succès montrant dans les années 1990 comment le redéveloppement des villes de la Rust Belt autour des secteurs de la santé, de l’éducation et du tourisme a permis à l’environnement de se remettre de 150 ans d’exploitation industrielle. Le chapitre 9, « Hide and Seek », rapporte l’anecdote d’un puma, qui parvenant à circuler dans la ville malgré l’extrême fragmentation des corridors biologiques causé par le réseau d’autoroutes, atteint le zoo de Los Angeles et tue un koala à la faveur de la fermeture d’un tronçon de l’I-405. Le chapitre 10, « Creature Discomfort », analyse le cas des chauve-souris à Austin pour aborder la question des zoonoses, ces maladies qui se transmettent des animaux aux humains comme cela a été le cas du SARS-Covid 19. Le chapitre 11, « Catch and Release », nous parle de la présence d’animaux exotiques en ville, en lien avec le commerce de ces espèces depuis le XVIIIe siècle et la présence de zoos desquels s’échappent plus de 1 000 animaux par an. Le renforcement du phénomène d’ilot de chaleur urbain facilite aussi leur survie et développement.
Le chapitre 12, « Damage Control », se concentre sur la lutte contre les nuisibles, qui reste la principale forme de gestion de la faune sauvage dans de nombreuses villes américaines. Elle représente une industrie de plusieurs milliards de dollars. Ici, l’espèce centrale est le rat, à l’origine de la création en 1885 de la première institution de gestion de la faune qui devient en 1940 l’U.S. Fish and Wildlife Service. L’auteur souligne qu’en 2019, les institutions de gestion de la faune étatsunienne ont encore tué plus d’1 million d’animaux. Le chapitre 13 évoque le déclin de la présence du moineau à partir des années 1990 pour illustrer les limites que l’environnement urbain pose à l’évolution des espèces qui l’habitent, notamment en termes de dérives génétiques liées à l’isolement. Enfin, le chapitre 14, « Embracing the Urban Wild », prend l’exemple des otaries et des truites arc-en-ciel à Seattle. Fragilisées par les infrastructures urbaines, notamment par l’écluse de Ballard, ces dernières sont des proies idéales pour les lions de mer au point que très peu parviennent à trouver leur chemin vers la mer, affectant ainsi tout l’écosystème côtier.
–
Pour une coexistence humains-animaux en ville
Tout au long du livre, Peter S. Alagona nous montre que les villes sont bel et bien des écosystèmes, composées de roches, de sols et d’eau où nutriments et matières organiques circulent et sont transformés. Ces écosystèmes ont la particularité d’être dominés par une seule espèce clé de voûte : l’humain. L’auteur considère ces écosystèmes comme accidentels car ils sont le résultat involontaire de décisions d’urbanisme au XIXe siècle, de gestion des ressources naturelles au début du XXe siècle ou de protection de la nature à partir des années 1970 qui, pour certaines, n’avaient pas directement à voir avec les animaux eux-mêmes. Chacun des chapitres entreprend de souligner les relations contradictoires que les urbains entretiennent avec la faune sauvage : ils n’apprécient guère les chauve-souris mais cela n’empêche pas les touristes de se masser sous le Congress Avenue Bridge à Austin pour les regarder s’envoler en été ; la ville de Pittsburgh se prend de passion pour le retour des aigles à tête blanche jusqu’à ce que ceux-ci soient filmés en train de dévorer un chaton…Alors, que voulons-nous vraiment pour nos écosystèmes urbains ? Et que faudrait-il pour que les hommes et les animaux sauvages puissent vivre ensemble dans les villes du XXIe siècle ?
–

Un sanglier dans la suburb d’Oro Valley, au nord de Tucson (Brian O’Neill, 2020)
–
La visibilité accrue de la faune sauvage dans les zones urbaines a déjà suscité l’intérêt du public, en particulier lorsqu’il s’agit d’espèces charismatiques comme l’écureuil, l’ours ou le cerf. Ce phénomène a été renforcé pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19 en 2020 : « pendant un bref moment déconcertant, le monde a tourné son attention vers la faune urbaine » (p. 211), alors que sur les réseaux sociaux se multipliaient vidéos et photos de flamants roses, de sangliers, de pumas ou de coyotes déambulant dans des quartiers vidés de leurs voitures et piétons.
Il semble donc qu’il y ait une demande croissante pour que l’urbain soit rendu plus accueillant pour la faune sauvage, ce qui converge avec l’idée générale d’une ville plus verte et plus saine pour ses habitants humains.
Cependant, les villes sont encore des écosystèmes qui restent hostiles aux animaux. Leurs lumières sont trompeuses pour les espèces migratrices ou sont particulièrement propices à la sur-prédation par les araignées, chauve-souris et reptiles. Leurs bruits et leurs odeurs sont déroutantes pour tous les animaux qui dépendent de leur ouïe ou de leur odorat pour se déplacer, trouver des proies, échapper aux prédateurs et communiquer. Cela a des conséquences sur les humains aussi : la lumière nocturne et les températures plus chaudes dans les villes peuvent prolonger la période d’activité quotidienne des moustiques qui transmettent la dengue, le Zika et d’autres maladies. Le bruit chronique affecte la santé humaine à long terme en aggravant les conditions d’hypertension artérielle liées au stress, ou les insomnies.
Ce livre se présente donc comme un manifeste pour « passer d’une ère accidentelle à une ère plus intentionnelle dans l’histoire de la faune urbaine » (p. 210). Il souligne l’importance des efforts d’éducation et de sensibilisation du public qui s’appuie sur le boom des études d’écologie urbaine. Les différents chapitres nous montrent un certain nombre de mesures remarquables qui ont été prises pour améliorer la vie en ville des animaux, et du même coup celle des humains. Par exemple, en 2001, Flagstaff en Arizona, ville modèle en matière de politique d’éclairage public depuis la fin des années 1950, est la première ville du monde à protéger son ciel de nuit. Cependant, les obstacles restent de taille : les risques liés à l’éco-gentrification, la persistance de l’étalement urbain, la complexité du jeu d’acteurs à l’interface entre aménagement du territoire et protection de l’environnement (agences publiques, institutions privées, associations et citoyens), la lenteur de processus de décision bureaucratiques et le manque de financement.
–
Conclusion
Cet ouvrage écrit sur un ton envolé en faveur de l’écologie urbaine et pour une meilleure inclusion des animaux en ville est facile d’accès, pour des lecteurs de tous horizons. Et heureusement ! Pourtant publié par des presses universitaires, sa consultation dans un objectif de recherche efficace d’informations n’est pas aisée. L’introduction est succincte et ne présente pas le propos de l’ouvrage dans son entier comme le font pourtant beaucoup de publications anglophones. Les titres des chapitres ne nous dévoilent rien sur leur contenu et sont eux-mêmes construits de manière parfois énigmatique autour d’une anecdote qui donne lieu à des considérations plus générales sans que liens et transitions entre ces différents éléments ne soient très clairs. Dans l’ensemble, les chapitres 2 à 13 déclinent la même idée – le retour des animaux en ville et les réactions humaines – illustrée par des exemples variés au risque de se répéter. Le dernier chapitre se distingue pour les pistes de réflexion qu’il offre quant à l’aménagement de villes plus juste vivables et plus justes pour les humains et les non-humains. Mais vu la rareté des réflexions sur le sujet, si elle déçoit un peu, la lecture de cet ouvrage reste tout de même bienvenue…
ANNE-LISE BOYER
–
Anne-Lise Boyer est post-doctorante pour le Labex DRIIHM, rattachée au laboratoire Environnement Ville Société (EVS – UMR 5600) à l’ENS de Lyon. Ses travaux de recherche prennent place au sein du projet Transverse HYDECO qui analyse les évolutions des socio-hydrosystèmes au prisme des processus de dé-connexions/ re-connexions à partir de cas d’études situés dans sept Observatoires Hommes-Milieux (en France, au Portugal, au Canada et aux États-Unis).
–
Référence de l’ouvrage : Alagona P. S., 2022, The Accidental Ecosystem: people and wildlife in American cities, University of California Press, 296 p.
–
Couverture : Un canard dans une piscine d’Ahwatukee, une suburb du sud de Phoenix (A.-L. Boyer, 2020).
–
Pour citer cet article : Boyer A.-L., 2022, « The Accidental Ecosystem : people and wildlife in American cities, de Peter S. Alagona », Urbanités, Lu, novembre 2022, en ligne.











