Lu / La ville stationnaire. Comment mettre fin à l’étalement urbain ?, de Philippe Bihouix, Sophie Jeantet et Clémence de Selva
AMINE MESSAL
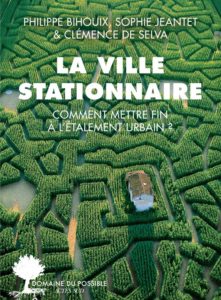 Où en est-on de la fabrique de l’espace ? Comme pour dresser un état des lieux, les auteur·e·s préfèrent filer la métaphore des ressources biophysiques : l’espace n’est pas une denrée inépuisable, et sa consommation devrait être étudiée à cette aune. Partant, à travers l’analyse quantitative très riche qu’iels nous procurent, les auteur·e·s tentent ici de représenter, d’appréhender, de synthétiser la complexité du phénomène d’étalement urbain à l’aune des enjeux socio-écologiques. En effet, avec la volonté de ne pas étudier l’étalement urbain comme un processus isolé, via une considération résolument multiscalaire, les lecteur·e·s seront presque tenté·es d’y voir la spatialisation de ces enjeux. Nonobstant la transversalité prégnante de l’analyse, le découpage de l’ouvrage en neuf chapitres permet de structurer le propos, à travers un effort pédagogique qui permettra tant aux urbanistes confirmé·es qu’aux non-initié·es d’appréhender le problème pour la première fois.
Où en est-on de la fabrique de l’espace ? Comme pour dresser un état des lieux, les auteur·e·s préfèrent filer la métaphore des ressources biophysiques : l’espace n’est pas une denrée inépuisable, et sa consommation devrait être étudiée à cette aune. Partant, à travers l’analyse quantitative très riche qu’iels nous procurent, les auteur·e·s tentent ici de représenter, d’appréhender, de synthétiser la complexité du phénomène d’étalement urbain à l’aune des enjeux socio-écologiques. En effet, avec la volonté de ne pas étudier l’étalement urbain comme un processus isolé, via une considération résolument multiscalaire, les lecteur·e·s seront presque tenté·es d’y voir la spatialisation de ces enjeux. Nonobstant la transversalité prégnante de l’analyse, le découpage de l’ouvrage en neuf chapitres permet de structurer le propos, à travers un effort pédagogique qui permettra tant aux urbanistes confirmé·es qu’aux non-initié·es d’appréhender le problème pour la première fois.
–
Urbaniser, densifier et innover par temps d’urgence écologique
Après une brève histoire de la croissance des villes de la révolution industrielle à nos jours, le premier chapitre entame d’abord une description critique de l’urbanisation croissante des territoires (français le plus souvent), présentant désormais un parc de logement qui croît plus vite que la population, à l’heure d’une sous-utilisation de l’immense parc déjà bâti. À l’aide d’une typologie des densités (de population, d’activité, résidentielle, bâtie, vécue), de la notion de métabolisme physique (analyse des flux d’énergie, d’eau et de matière), et d’une analyse évolutive de l’étalement urbain, les auteur·e·s entendent montrer en quoi la densification est parfois un phénomène ambigu. Les idées reçues d’une ville plus « verte » parce que plus dense, ou plus dense parce que plus haute, sont déconstruites : effet rebond lié aux mobilités intra et interurbaines, pression écosystémique de l’urbanisation malgré les efforts de renaturation, et « rendements décroissants » de la construction d’un bâti plus haut, que ce soit en termes d’empreinte matière ou d’emprise au sol, étayent la démonstration.
Le second chapitre s’attaque aux « promesses » (« non tenues ») de la croissance économique mondialisée, que le phénomène de métropolisation semble compromettre. Une triple remise en cause est évoquée : celle de l’accès au dynamisme économique – face au prix du foncier en drastique augmentation –, celle de la multiplicité des fonctions urbaines – face à la saturation de l’espace qui repousse les activités productives et culturelles autour des villes –, et d’une mobilité facilitée – face à la congestion et l’augmentation des distances parcourues. Les villes-mondes ne sont pas oubliées, identifiées comme participant à l’uniformisation des paysages et des cultures, ainsi qu’à l’accélération socio-technique des modes d’existence. Ainsi, la recherche d’attractivité territoriale est accusée de ne pas toujours améliorer la qualité de vie, ce qui pourrait justifier l’apparition, encore très timide, d’un « demarketing territorial ».
Le troisième chapitre dresse une brève histoire du concept de smart city, avant d’entamer une critique corrosive de ses prétendues vertus écologiques. Les gains d’automatisation et d’optimisation attendus par la récolte et le traitement massif de données au sein d’une ville connectée sont revus dans une perspective systémique (empreinte matière, effet rebond, infrastructures réseau nécessaires). Loin de conclure à l’inutilité systématique de l’innovation high-tech, les auteur·e·s en appellent à un « techno-discernement », à travers une invitation à repenser les besoins et usages à l’aune des limites planétaires, des enjeux de résilience des systèmes techniques et de sécurité liés à l’utilisation des données.
Au cours du quatrième chapitre, les auteur·e·s reviennent sur l’évolution des réglementations et pratiques liées à l’éco-construction. Si l’empreinte énergétique du secteur du bâtiment ne se résume pas à la phase d’exploitation, l’utilisation de matières premières n’est pas en reste. En revenant sur les limites technologiques d’une décarbonation des productions de béton et d’acier (en raison des processus chimiques à l’œuvre), des matériaux biosourcés (au regard des quantités demandées), du recyclage (au vu d’une dégradation qualitative), et de réemploi direct (en raison de limites économico-organisationnelles), les auteurs n’éliminent pourtant aucune piste de solution. Néanmoins selon elle·eux, « faire flèche de tout bois » ne pourra représenter un espoir qu’à condition de construire moins. Afin de compléter ce vaste état des lieux, le cinquième chapitre invoque la notion de résilience, battant en brèche son apparition dans le champ académique – en physique, psychologie, écologie – et sa polysémie, jusqu’à son arrivée dans le sillon des politiques publiques. En discutant plus particulièrement la problématique de la résilience alimentaire, les auteur·e·s montrent que si les propositions pour « construire la résilience » ne manquent pas, l’utilisation généralisée de la notion, jusqu’à y inclure des changements à la marge qui ne bouleversent pas les liens structurels des sociétés, pourrait galvauder le concept, à l’image d’un développement durable devenu caduc.
–
Artificialisation des sols : du constat aux voies de solution
Nonobstant le titre de l’ouvrage, c’est seulement aux chapitres six et sept que les auteur·e·s abordent réellement les enjeux d’artificialisation. Une approche historique présente les rythmes de changement d’occupation des sols, avant de prendre à bras le corps les enjeux de définition et la diversité des techniques d’évaluation impliquant une variance statistique entre les sources. Puis, l’objectif récent, au niveau français, de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) est replacé dans une historicité juridique, avant que les auteur·e·s pointent les lacunes du concept de compensation censé clore la séquence ERC (éviter, réduire, compenser). C’est un concept ici fortement remis en cause, en raison d’une complexité écosystémique incommensurable – et donc vraisemblablement impossible à reproduire ex nihilo –, du coût économique de la « renaturation », ou encore de l’inter-temporalité entre impact immédiat et compensation future incertaine. Par ailleurs, malgré une entrée datée dans la loi, le concept de « gestion économe de l’espace » met à l’épreuve la cohérence territoriale entre objectif ZAN à l’échelle nationale, planification régionale des SCoT1, et classification parcellaire de l’espace à l’échelle communale grâce au PLU2. Les limites techniques, méthodologiques et juridiques exhibées, mènent les auteur·e·s à proposer une voie alternative : l’objectif de Zéro Artificialisation Brute. Considérant que les différentes modélisations pour l’atteinte de l’objectif ZAN à l’horizon 2050 envisagent seulement d’actionner les leviers du renouvellement et de la densification urbaine, les auteur·e·s questionnent les conséquences d’un volume de construction toujours croissant. Selon eux, malgré l’énorme potentiel des deux leviers sus cités, leurs limites physiques, méthodologiques et juridiques – en plus des difficultés opérationnelles posées par la compensation – conduiront inexorablement à remettre en cause la croissance de la consommation d’espace, qui se veut stable en moyenne depuis les années 1990. Caractérisée par une consommation d’espace nulle ou presque, les auteur·e·s définissent ainsi la ville stationnaire.
Pour réduire à la fois le volume de construction et les surfaces à artificialiser, les chapitres huit et neuf proposent des voies de solutions plus ou moins opérationnelles : lutte contre la vacance et la sous-occupation du parc privé – notamment des résidences secondaires – et public – en promouvant la multifonctionnalité, par des leviers juridiques, fiscaux, mais aussi culturels. En effet, les auteur·e·s appellent à une recohabitation pour contrer l’augmentation de la surface bâtie par habitant : promouvoir l’habitat collectif, la mise en commun des fonctionnalités de chaque espace, ainsi que l’approche chronotopique – utilisation multifonctionnelle du bâti selon les besoins de différents publics, au long de la journée, de la semaine, de l’année. Par ailleurs, la densification devrait selon elle·eux être répartie de manière géographiquement équitable pour permettre une faible « densité vécue », et ainsi préserver une certaine qualité de vie tout en recherchant la résilience urbaine – nécessitant une renaturation gourmande en surface elle aussi. Néanmoins, malgré des efforts législatifs, fiscaux, d’exemplarité, souhaitables et en partie déjà observables de la puissance publique pour à la fois dynamiser les communes rurales et désengorger les métropoles, les auteur·e·s plaident pour une vision plus « systémique et radicale ». S’iels confessent ne pas avoir de recommandation miracle pour les politiques publiques, les auteur·e·s tentent ici d’esquisser les contours d’une approche nouvelle. Sans avoir peur d’évoquer une nécessaire redistribution de la population via celle des services et des emplois, les auteur·e·s appellent à s’appuyer sur les prémisses d’une dé-métropolisation que la crise sanitaire a laissé observer en 2020. Par ailleurs, iels proposent de partir des besoins en compétence et emploi qu’appelle une bifurcation écologique des forces productives, afin de redessiner l’aménagement du territoire. Ainsi, par exemple, iels insistent sur la mise en cohérence de l’enjeu d’artificialisation avec les trajectoires de transition énergétique, appuyant une nouvelle fois la nécessité de l’approche développée progressivement dans les chapitres précédents : construire moins, construire mieux, rénover plus.
En définitive, on ne trouvera pas dans cet ouvrage la solution miracle au problème de l’étalement urbain, mais ce sera au profit d’une démonstration convaincante de l’urgente nécessité de s’atteler à sa mitigation, comme une tentative plutôt réussie de représenter et d’appréhender la complexité d’un enjeu aux multiples causalités. Étant donné la précision de l’analyse quantitative et géographique – une annexe revenant même sur les bases de données qui concourent à la mesure du phénomène d’étalement et les incertitudes qui l’entourent -, on pourra s’estimer déçu de la moindre rigueur accordée à la dimension socio-économique. Cette dernière, loin d’être oubliée – et dont l’importance est soulignée –est parfois traitée de façon moins scientifiquement sourcée. En particulier, quelques données statistiques, citations d’acteur·e·s, et plus rarement quelques extraits de documents d’urbanisme, concourent à dessiner le début d’une sociologie culturelle des urbanistes, des élu·e·s locaux·ales ou des riverain·e·s. Bien qu’aucune ambition de ce type n’était affichée, mais justement parce qu’on lui aura mis l’eau à la bouche, le lectorat avide d’analyse transdisciplinaire restera peut-être sur sa faim. Ne cherchez pas non plus dans cet ouvrage le schéma d’une ville idéale, qui, à en croire les auteur·e·s, n’est autre que celle-là même dans laquelle nous vivons déjà : le « coup déjà parti » nous oblige à faire avec l’existant, c’est-à-dire l’immense parc de bâti déjà construit. C’est certainement pour cette raison que l’enjeu du « prendre soin » (care) apparaît à plusieurs reprises dans cet ouvrage, les auteur·e·s reprenant à leur compte un adage connu des philosophes et urbanistes (Thierry Paquot, 2021)3 ou encore celui de Christine Leconte et Sylvain Grisot (2022)4. Ainsi, selon les auteur·e·s, les enjeux de résilience climatique, agro-alimentaire, hydrologique, de sobriété matérielle et énergétique, ne s’empilent pas mais se mêlent à celui de l’artificialisation des sols. Dès lors, cet écheveau nous contraint à identifier les solutions qui présentent des co-bénéfices, arbitrer parmi les multiples injonctions contradictoires, afin notamment d’éviter les effets rebonds. En conclusion, l’ouvrage nous invite à appréhender la multitude et la complexité des problèmes socio-écologiques comme source d’une complémentarité des solutions potentielles.
AMINE MESSAL
–
Amine Messal est étudiant au département Sciences humaines et sociales de l’ENS Paris-Saclay, et ingénieur, diplômé de l’École centrale de Nantes.
–
Référence de l’ouvrage : Bihouix Philippe, Jeantet Sophie et de Selva Clémence, 2022, La ville stationnaire. Comment mettre fin à l’étalement urbain ?, Actes Sud, coll. « Domaines du possible », 352 p.
–
Bibliographie et sitographie
Leconte C. et Grisot S., 2022, Réparons la ville ! Propositions pour nos villes et nos territoires, Éditions Apogée. 96p.
Paquot T., 2021, Ménager le ménagement, Topohile.
Couverture : © Nobilis, LABYRINTHE, Collection PERIPETIES.
Pour citer cet article : Messal A., 2023, « La ville stationnaire. Comment mettre fin à l’étalement urbain ?, de Philippe Bihouix, Sophie Jeantet et Clémence de Selva», Urbanités, Lu, octobre 2023, en ligne.
- Schéma de cohérence territoriale. [↩]
- Plan local d’urbanisme. [↩]
- Le « ménagement du territoire ». [↩]
- Qui appellent à « réparer la ville ». [↩]











