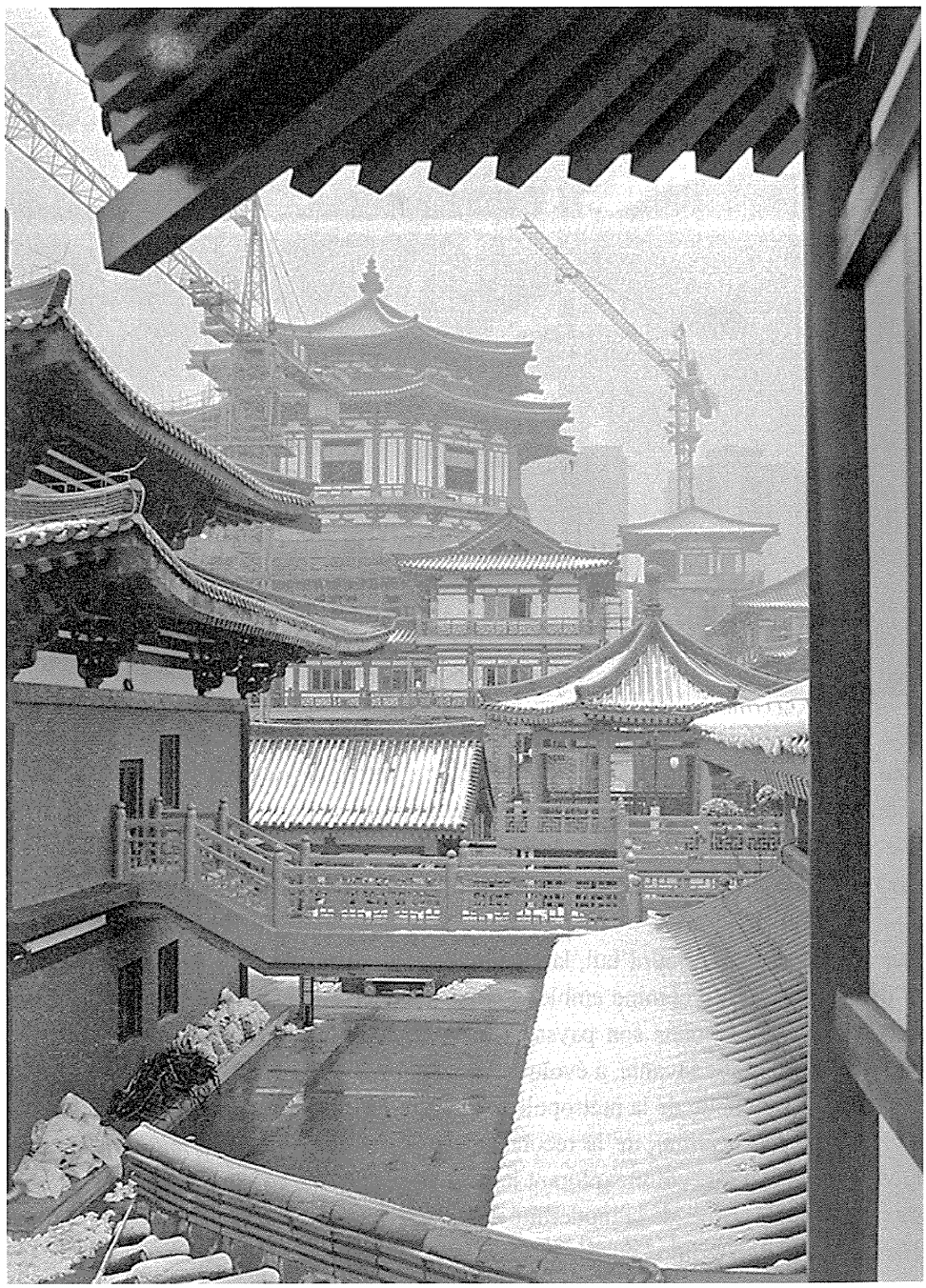Lu / Bousbir, quartier de l’entre-deux
Emmanuel Menetrey
Le Lu d’Emmanuel Menetrey au format PDF
 Quartier réservé. Bousbir, Casablanca, est un ouvrage publié sous la direction de J.-F. Staszak et R. Pieroni. Paru en septembre 2020 chez Georg Editeur, il accompagnait l’organisation d’une exposition photographique, prévue à l’automne 2020 à la Villa des arts de Casablanca puis, au printemps 2021, à l’université de Genève. Ce projet, développé de part et d’autre de la Méditerranée, inscrit l’étude dans une dualité elle-même caractéristique de ce quartier. Enseignants, chercheurs et étudiants en histoire, en géographie mais aussi en sociologie, en architecture et en urbanisme y trouveront un terrain d’étude des dominations coloniales traversées par l’observation des inégalités de genre. Ils y examineront de multiples enjeux mémoriaux et patrimoniaux contemporains, matérialisés par des choix architecturaux et urbanistiques marqués. Rejoints par les plasticiens, ils y trouveront l’expression de la diversité des regards artistiques qu’il est possible de poser sur la ville. En lycée, dans le cadre du nouvel enseignement de spécialité HGGSP (Histoire Géographie, Géopolitique, Sciences politiques) doit être étudiée la notion de patrimoine. L’examen des réflexions et des actions menées à Bousbir sur ce thème mais aussi des difficultés de leur mise en œuvre, pourra offrir un intéressant support d’analyse.
Quartier réservé. Bousbir, Casablanca, est un ouvrage publié sous la direction de J.-F. Staszak et R. Pieroni. Paru en septembre 2020 chez Georg Editeur, il accompagnait l’organisation d’une exposition photographique, prévue à l’automne 2020 à la Villa des arts de Casablanca puis, au printemps 2021, à l’université de Genève. Ce projet, développé de part et d’autre de la Méditerranée, inscrit l’étude dans une dualité elle-même caractéristique de ce quartier. Enseignants, chercheurs et étudiants en histoire, en géographie mais aussi en sociologie, en architecture et en urbanisme y trouveront un terrain d’étude des dominations coloniales traversées par l’observation des inégalités de genre. Ils y examineront de multiples enjeux mémoriaux et patrimoniaux contemporains, matérialisés par des choix architecturaux et urbanistiques marqués. Rejoints par les plasticiens, ils y trouveront l’expression de la diversité des regards artistiques qu’il est possible de poser sur la ville. En lycée, dans le cadre du nouvel enseignement de spécialité HGGSP (Histoire Géographie, Géopolitique, Sciences politiques) doit être étudiée la notion de patrimoine. L’examen des réflexions et des actions menées à Bousbir sur ce thème mais aussi des difficultés de leur mise en œuvre, pourra offrir un intéressant support d’analyse.
Aujourd’hui un des quartiers à vocation résidentielle de Casablanca, Bousbir a été inauguré le 1er mai 1923 sous l’autorité de l’administration coloniale française, établie au Maroc depuis la naissance d’un protectorat, en 1912. Jusqu’en 1955, cet espace urbain regroupa des prostituées dans ce qui fut alors, en tant que quartier réservé, la plus vaste maison close à ciel ouvert du monde. Claustration/ouverture : cette tension caractérisa Bousbir dès l’origine et est une des nombreuses manifestations des ambivalences qui caractérisent l’histoire de ce quartier et des regards qui y furent et y sont encore portés.
L’étude s’ouvre sur une préface de l’architecte casablancais Rachid Andaloussi, suivie d’une introduction des deux directeurs de l’ouvrage. Celui-ci s’organise en trois parties. Une présentation historique détaillée du quartier est proposée par J.-F. Staszak. L’auteur complète son analyse d’un examen des enjeux contemporains, notamment patrimoniaux, qui le caractérisent. Est ainsi établie la relation avec les deux chapitres suivants. Ils permettent de mettre en miroir le regard porté par deux femmes photographes sur Bousbir, de l’époque où celui-ci remplissait sa fonction de « quartier réservé » à la période contemporaine. Denise Bellon le découvrit lors d’un bref séjour en 1936. Son travail est présenté par Anaïs Mauuarin. L’œuvre de Melita Vangelatou, qui vit et travaille à Casablanca depuis 2000, est décrite par Raphaël Pieroni. La confrontation du regard de ces deux photographes traduit la multiplicité des problématiques que suscite l’étude du quartier de Bousbir. Il fut en effet revendiqué par les autorités françaises comme l’expression de la cohérence de leur projet colonial, en tant que mise en œuvre d’une action d’aménagement visant à valoriser le rôle de la présence française au Maroc, ainsi que dans tout l’empire. Il fut aussi pensé comme un moyen de consolider les hiérarchies et les dominations propres aux politiques et aux sociétés coloniales. En cela, il devint également le symbole effectif et encore actuel de leurs contradictions, opprimant là où il prétendait civiliser et libérer. Un des intérêts majeurs de l’ouvrage est de souligner cette dichotomie. Il n’est certes pas le premier à s’emparer de cette question, à une époque où les débats politiques et sociétaux sur la colonisation restent des questions vives, alimentées par des études, notamment historiques, à la fois nombreuses et aux problématiques renouvelées. Cette étude offre toutefois un regard moins habituel sur la mise en œuvre de la colonisation européenne, et en l’occurrence française. Il en souligne les caractéristiques fondamentales, volonté de maîtrise de l’espace et sujétion des peuples colonisés, à travers un exemple original, précis, localisé et richement documenté. Dans le même mouvement, il donne à voir les paradoxes et les injustices de cette politique et confirme, si besoin était, l’imposture de sa prétendue « mission civilisatrice ». Étendant son regard jusqu’à notre époque, l’ouvrage met aussi en exergue une autre façon d’interroger cet héritage colonial, en conduisant le lecteur européen à interroger les perceptions locales de cette histoire ainsi que les pratiques sociales et spatiales qui en découlent. De façon là aussi très contemporaine, sa lecture pourra enrichir, au titre des gender studies, des questionnements extrêmement actuels, particulièrement autour des représentations du corps féminin.
–
Paradoxal Bousbir
Au cœur des contradictions qui le caractérisent se trouve le choix réalisé, dès 1923, d’un quartier à l’architecture dédiée au commerce du sexe à grande échelle. Initialement retiré de l’espace urbain derrière de hauts murs, il y était toutefois relié par une ligne de bus venue du centre-ville. La réalisation du quartier, pensé comme espace nécessairement soustrait à la plupart des regards, fut dans le même temps voulue par ses décideurs comme modèle urbanistique possiblement reproductible dans l’ensemble de l’empire colonial français. Cacher mais diffuser…
Aménagé dans une perspective sécuritaire et prophylactique, et dès lors présenté comme une mesure d’utilité publique, le quartier n’en fut pas moins livré à des intérêts financiers centrés sur l’exploitation de l’être humain. Paré par les autorités coloniales françaises des vertus de l’intérêt général, la réalité quotidienne du quartier fut d’être livré, pendant plus de trente ans, à des ambitions mercantiles liées à l’exploitation de l’être humain.
L’ensemble de ces éléments firent de Bousbir un haut lieu du tourisme colonial. J.-F. Staszak rappelle à quel point la façon dont ses visiteurs perçurent le quartier fut irriguée par un imaginaire orientaliste. De nombreux touristes firent d’ailleurs état de l’impression artificielle laissée par le quartier, de son ambiance de simulacre, sans que son attrait en fût toutefois amoindri. Il semble même que la facticité fut partie intégrante de l’expérience que l’on venait y quérir, considérée comme accompagnement et prolongement d’une activité prostitutionnelle d’abord perçue comme « art de l’illusion » (p. 72). Les murailles et la porte monumentale du quartier, ruptures symboliques, frontières dans le tissu urbain, consacraient Bousbir comme hétérotopie, manifestation d’une réalité spatiale et temporelle différente, inscrite dans la vision d’un « Maroc précolonial idéalisé » (p. 77).
Les implications, les références, à la fois érotiques et exotiques, de cet univers sensément onirique, entraient toutefois en résonance avec une culture bien réelle : celle de la domination coloniale, structurée de sujétion sociale, culturelle, ethno-raciale et ici articulée aux rapports de genre. L’action des promoteurs de cette soumission sexuée puisait aux sources de la supposée lascivité des femmes indigènes exploitées dans le quartier, elles-mêmes vues comme l’incarnation des torpeurs suggestives du climat nord-africain. À Bousbir se sont ainsi connectés fantasme orientaliste et réalité de multiples dispositifs de sujétion. Entre 1923 et 1955, le quartier a proposé la conversion d’une « imaginaire géographique » (p. 22) aux mesures concrètes d’une politique. Le rêve orientaliste s’y est nourri du cauchemar de l’exploitation sexuelle.
La conception même du quartier donne la mesure des contradictions qui le traversent. En tant que projet inscrit par le colonisateur dans une politique de planification urbaine, considéré comme un aménagement soucieux de garantir l’hygiène publique en termes de contrôle de la diffusion des infections sexuellement transmissibles, Bousbir était paré des vertus de la modernité. Dans le même temps, les choix architecturaux qui y furent adoptés distinguaient le quartier de la ville moderne pour lui conserver, mis à part le recours à l’éclairage public considéré comme une indispensable mesure sécuritaire, tous les atours du vieux centre d’une ville arabe : hauts murs, porte d’accès monumentale, rues labyrinthiques… Ces choix furent soulignés par le recours massif au style néo-mauresque. Voulu par l’architecte Edmond Brion, ce parti-pris ne se voulait toutefois pas simple concession ornementale à la mode orientaliste mais comme le résultat d’un réel retour aux sources et d’une volonté d’adaptation aux réalités locales. Plus globalement, ce choix s’intégrait dans la politique menée par Lyautey, premier résident général du protectorat français. Elle se voulait protection du patrimoine marocain et promotion des savoir-faire locaux à des fins certes pratiques mais aussi économiques et politiques.
Dans le même temps, cette valorisation des traditions indigènes trouvait aussi sa limite dans le plan même du quartier, intrinsèquement lié à la fonction très spécifique que l’aménageur lui assigna. Alors que d’autres quartiers réalisés à Casablanca, comme celui des Habous garantissait une préservation des espaces privés auxquels les populations locales, notamment féminines, étaient très attachées, le plan en grille de Bousbir se voulait garantie des « impératifs modernes de circulation et de ventilation » (p. 68) dans la mesure où « le quartier n’était pas conçu pour les femmes qui y vivaient mais pour les prostituées qui y officiaient » (p. 68-71). L’enjeu n’y était pas la pudeur mais au contraire l’exhibition. Dissimulé par son enceinte, relégué dans l’espace urbain par sa localisation périphérique (au moment de son aménagement), le quartier se voulait, dans son fonctionnement interne, l’espace du voyeurisme, du spectacle. Le succès touristique que rencontra le quartier finit d’ailleurs par donner, forme de nouveau paradoxe, une plus grande visibilité à ce que les autorités coloniales voulaient y dissimuler. Bousbir devint la destination d’un « tourisme des bas-fonds », dont le développement fut soutenu par la proximité du Bidonville de Casablanca. La curiosité voyeuriste pour la prostitution, la misère humaine nourrissait la venue de visiteurs également motivés par la découverte d’un lieu dont l’aménagement était aussi considéré comme une réalisation coloniale réussie, d’ailleurs promue lors de l’Exposition coloniale de 1931 à Paris.
Retirer des regards externes, offrir aux regards internes ; dissimuler et promouvoir : ces contradictions se voulaient dans l’esprit des aménageurs indispensable complémentarité à l’échelle de la ville. Par-delà ces apparents paradoxes se révèle donc aussi la cohérence interne du projet urbanistique défini par les autorités françaises. Partageant avec d’autres puissances coloniales une inquiétude quant à la prostitution, elles s’efforçaient d’en prendre le contrôle. Ce souci fut particulièrement affirmé en Afrique du Nord. Cette institutionnalisation du commerce du sexe fut, à Bousbir, inscrite dans l’espace et répondait à une volonté de consolidation de l’ordre colonial. En favorisant, notamment auprès des jeunes colons célibataires, les relations avec des prostituées, il s’agissait à la fois de satisfaire à leurs besoins sexuels, de contrôler par un encadrement strict tout risque moral, sanitaire ou social, d’éviter tout métissage pouvant résulter de relations durables avec des maîtresses indigènes. Cette volonté de promouvoir des liens ponctuels et superficiels renvoie au projet colonial dans sa dimension ségrégationniste, excluante et discriminatoire. À ce titre, la cohérence affichée par le colonisateur se voyait rattrapée par les contradictions du système qu’il avait lui-même institué. Celui-ci se présentait en effet comme civilisateur et émancipateur, notamment pour la femme indigène qu’il fallait « sortir du harem » auquel l’imaginaire orientaliste l’assignait. Dans un même mouvement, il l’enfermait au sein d’un espace dévolu à son exploitation sexuelle, l’exposait à des formes de violence verbale et physique, la condamnait à un rejet social sur fond de désapprobation morale et religieuse.
–
Questionnements mémoriels
Le quartier en lui-même finit par être l’objet de ce rejet. Il fut fermé le 16 avril 1955. Loin de son image de modèle à offrir à tout l’empire colonial français, il était devenu la cible de multiples critiques, exacerbées par le contexte de décolonisation.
Après l’évacuation des prostituées, le quartier fut dévolu à l’accueil de militaires des forces supplétives marocaines de retour d’Indochine. Il est aujourd’hui un quartier populaire, englobé dans une agglomération dont l’importante extension spatiale s’est déroulée sans schéma directeur depuis les années 1920. Il en résulte un espace urbain très dense et peu organisé au sein duquel Bousbir a conservé des spécificités qui expliquent le fort attachement dont témoignent ses habitants à son égard. Son enceinte n’a pas disparu, sa trame viaire reste plus ouverte, plus aérée que dans le reste de Casablanca. Bien que marqués par un ensemble de transformations, les choix architecturaux qui ont guidé sa construction marquent encore le paysage urbain de Bousbir et il se distingue par une densité de population moindre que dans les autres quartiers de la métropole marocaine. Par le retournement de son dispositif architectural initial, Bousbir est passé d’un lieu de claustration d’une main-d’œuvre exploitée sexuellement à un espace aux apparences de village, protecteur et protégé d’un urbanisme incontrôlé.
Le quartier semble marqué par une volonté de ne pas conserver d’autres liens avec son passé que ceux qui subsistent des choix initiaux qui ont structuré son aménagement. Ce choix est notamment symbolisé par les changements des noms de rues. Ils ne portent plus, comme à l’origine, des noms de localités marocaines, références à l’origine géographique des prostituées qui y officiaient, mais des noms de fleurs. Dans un entre-deux qui rappelle les paradoxes initiaux de l’histoire du quartier, le passé prostitutionnel est mis à distance, difficilement évoqué tout en affleurant rapidement au gré des conversations avec ses habitants.
Que faire de ce passé ? Les habitants de Bousbir peuvent-ils, plus que d’autres, en décider des usages ? Quelle place laisser à l’histoire et à la mémoire des femmes qui y furent exploitées ? L’opprobre dont elles furent l’objet a-t-elle vocation à se perpétuer ? Comment s’affranchir du tabou de la prostitution pour construire une mémoire apaisée du quartier, gage de patrimonialisation ? Car Bousbir dispose d’une vocation patrimoniale : celle attachée à l’ensemble architectural qui le caractérise ; celle d’entretenir la mémoire d’un épisode douloureux de l’histoire urbaine et coloniale qui interroge lui-même sur les possibilités d’en faire un objet de conservation patrimoniale. De quelle acceptabilité sociale peut profiter une politique de valorisation d’un lieu symbolisant l’oppression coloniale ?
L’auteur indique toutefois que le passage du temps, la succession des générations et l’activisme de certaines associations tendent à permettre progressivement la sauvegarde de ces traces architecturales ou urbanistiques héritées de la colonisation, au titre d’une nécessaire réconciliation de la ville et de sa population avec leur propre histoire. L’enjeu est particulièrement de taille à Casablanca où ces témoignages sont spécifiquement nombreux. Il ne sera surmonté qu’en collaboration avec les habitants du quartier et dans un va-et-vient entre l’histoire française et marocaine comme révélateur des logiques coloniales qui furent à l’œuvre, préalable à un travail de reconnaissance et de réconciliation. Bousbir, hier et aujourd’hui, quartier de l’entre-deux.
–
Regards croisés
Cet entre-deux clôt l’ouvrage dans la mise en relation qu’il permet entre le travail de deux photographes à près de 75 ans de distance.
En 1936, Denise Bellon produit un reportage sur le quartier de Bousbir. Dans son article, Anaïs Mauuarin retrace le passionnant parcours de cette photographe intrinsèquement lié aux mutations techniques, esthétiques et organisationnelles qui marquèrent sa profession durant les années 1930. D. Bellon appartient à une nouvelle génération de reporters dont l’action va se développer à l’échelle mondiale. Elle participe à la création de l’agence Alliance Photo, à une époque où les studios indépendants se multiplient sous l’effet d’une demande affirmée d’images d’actualité, favorisant la naissance de revues entièrement constituées de photographies, telles que le magazine Vu, en 1928. Dans le même mouvement, D. Bellon se rapproche des avant-gardes, et notamment du mouvement surréaliste et de celui de la Nouvelle Vision. Enfin, elle profite des innovations matérielles de son temps, marquées par la mise à disposition d’appareils plus maniables, de supports photographiques plus souples. Ils permettront à D. Bellon de mettre en accord son regard sur le monde et sa production iconographique. A. Mauuarin rappelle la façon dont D. Bellon et son travail à Bousbir en 1936 ont pu se trouver à l’intersection de deux phénomènes marquants de cette époque. Tout d’abord l’essor du reportage photographique, auquel D. Bellon participe pleinement, caractérisé par le succès grandissant de la presse illustrée, lui-même garanti par de nouvelles possibilités techniques. Ensuite, le développement du tourisme, et tout particulièrement au Maghreb, considéré par les autorités françaises comme un moyen de valorisation de leur politique coloniale. C’est ainsi que D. Bellon reçut commande des chemins de fer du Maroc d’un reportage qui se voulait le reflet d’un itinéraire parcouru à travers le pays dans le but d’en vanter le potentiel touristique. Le quartier réservé de Bousbir se devait d’y avoir toute sa part. D. Bellon se fit-elle dès lors la complice d’une iconographie coloniale stéréotypée et fidèle aux attentes du regard occidental, alors que les années 1930 étaient marquées par une forte demande de sujets ethnographiques, de thèmes exotiques ?
A. Mauuarin souligne au contraire à quel point la vision de D. Bellon sur les femmes de Bousbir s’inscrit en rupture avec cette imaginaire orientaliste. Refusant tout voyeurisme, toute quête du spectaculaire, D. Bellon s’efforce au contraire de considérer ses modèles, de les valoriser. Elle les regarde, au sens plein du terme, afin de leur rendre la dignité que l’exploitation dont elles étaient l’objet les privait. À aucun moment, elle ne renonce à une ambition iconographique mais aussi sociale et ne cède à la complaisance. Elle cherche à rendre à ces femmes leur existence, en les photographiant à d’autres moments que celles où elles se livrent à la prostitution. Ainsi, elle « nuance leur assignation sociale et politique » (p. 120), ouvre « une brèche dans la chape visuelle coloniale qui dessinait alors les contours d’un érotisme orientaliste » (p. 123).
Elle inscrit de surcroît son travail dans une quête de modernité, entre autres symbolisée par le goût des « vues d’en haut ». Elles seront, à Bousbir, l’occasion d’un jeu avec l’architecture du quartier comme traduction des multiples rapports de domination et de ségrégation qui s’y exercent. Rendre aux femmes de Bousbir leur dignité, c’est aussi aller à leur rencontre. Les vues verticales s’accompagnent d’images faites depuis la rue, rendues d’autant plus nécessaires par les contraintes techniques liées à l’objectif de 50 mm utilisé par D. Bellon. Prises sur le vif, ces images révèlent les dynamiques relationnelles qui structurent l’espace social du quartier. Leur caractère d’apparence spontané, traduit par le flou de certains clichés, perçu alors comme gage d’instantanéité et donc de crédibilité, ne gomme en rien la mise en scène de leur propre corps à laquelle les prostituées de Bousbir devaient sacrifier. Ce rapport du corps aux autres corps, statiques ou en mouvement, dans le cadre architectural très spécifique du quartier est un des aspects les plus remarquables du travail de D. Bellon.
A. Mauuarin a toutefois le mérite d’exposer les limites du travail de D. Bellon. Cette dimension critique repose sur le constat que le regard de D. Bellon, pour empathique qu’il soit, n’en demeure pas moins une vision « euphémisée de la violence et de la misère » (p. 120) du quartier de Bousbir. Le séjour de D. Bellon fut-il trop bref pour approfondir sa perception des multiples réalités de Bousbir ? Son regard et sa présence furent-ils parfois source de défiance ? Ces interrogations soulignent finalement la position ambivalente de D. Bellon vis-à-vis des femmes de ce quartier réservé : visiteuse indiscrète ou témoin salvateur ? Il semble, à suivre A. Mauuarin que le regard de D. Bellon fut d’abord celui d’une photo-reporter, certes sensible, mais renonçant à un engagement plus approfondi auprès des femmes du quartier, demeurant « à la surface de qui s’y produit » (p. 121) et, de ce fait, faisant rejouer une « domination sociale, ethno-raciale et culturelle » (p. 121) dont elle incarnait un nouvel agent. La recherche esthétique, riche d’enseignements quant à la perception des formes architecturales et spatiales du quartier, semble l’avoir emporté sur le portrait social.
L’ouvrage se conclut sur la présentation de clichés produits à la fin des années 2010 par Melita Vangelatou. Leur analyse permet de reposer les enjeux du rapport de ses habitants à Bousbir et notamment à son passé. Elle interroge les possibilités que celui-ci laisse à ceux-là pour se l’approprier. Le quartier y retrouve sa caractéristique d’un espace du paradoxe, de l’entre-deux, de l’ambiguïté voire de la contradiction. L’atmosphère paisible qui y règne aujourd’hui peut-elle s’affranchir de son passé d’exploitation, de domination, de sujétion ? L’amnésie peut-elle se faire gage de vie simple et heureuse ? R. Pieroni nous rappelle à quel point les regards de M. Vangaletou, installée à Casablanca, et D. Bellon, qui n’y séjourna que quelques jours, se distinguent d’un point de vue thématique, chromatique et formel. Le lecteur pourra voir dans le travail de ces artistes deux projets esthétiques opposés. Ou au contraire y discerner des visions complémentaires, dessinant les contours d’une « photo au féminin » (p. 161).
Cette ambivalence nous accompagne jusqu’au terme de l’ouvrage. Le lecteur garde de Bousbir les images d’un espace encore profondément marqué par le passif des confrontations coloniales. Il peut y voir aussi, grâce à l’action contemporaine de ses associations, de ses habitants, la promesse d’en dépasser le lourd héritage.
EMMANUEL MENETREY
–
Emmanuel Menetrey est professeur certifié d’Histoire-Géographie. Il enseigne au collège A. et R. Dinet à Seurre.
emmanuel.menetrey@gmail.com
–
Référence de l’ouvrage : Staszak J.-F., Pieroni R., Andaloussi R. et Mauuarin A., 2020, Quartier réservé. Bousbir, Casablanca, Chêne-Bourg, Georg éditeur, p. 201
–
Couverture : Plan montrant les subdivisions de Casablanca, par Georges Buan (Guigues L., 1915, Guide de l’Exposition Franco-Marocaine, Casablanca).
–
Pour citer cet article : Menetrey, A., 2021, « Lu/ Bousbir, quartier de l’entre deux », Urbanités, en ligne.
–