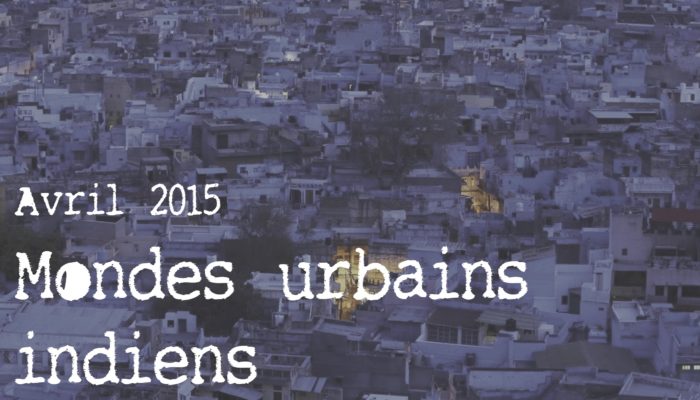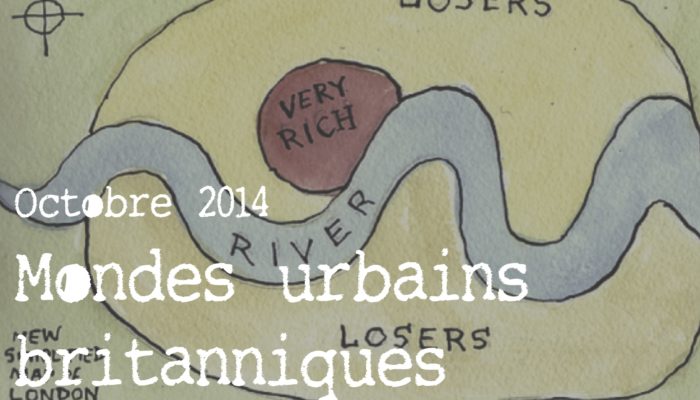Les villes nord-américaines / Les années Trump. Conservatisme, suprémacisme et Black Lives Matter. Regards croisés sur les États-Unis
Entretien avec Pap Ndiaye et Charlotte Recoquillon
–
Citer cet entretien / PDF de l’entretien / Sommaire du dossier
Pap Ndiaye est directeur général du Palais de la Porte Dorée, historien. Il vient de publier Les Noirs Américains. De l’esclavage à Black Lives Matter aux éditions Tallandier (2021).
Charlotte Recoquillon est chercheuse rattachée à l’Institut français de géopolitique et journaliste spécialiste des États-Unis. Après une thèse sur les enjeux géopolitiques des résistances à la politique municipale de gentrification à Harlem (New York), ses recherches se sont principalement portées sur le racisme institutionnel, les violences policières et le mouvement Black Lives Matter.
charlotte.recoquillon@geopolitique.net
–
Le 20 janvier 2021, Joe Biden est investi 46ème président des États-Unis, à l’issue d’une saison électorale – et, en fait, d’une mandature Trump – particulièrement violente. Le 3 novembre 2020, un nombre record d’électeur·trice·s se sont mobilisé·e·s, en personne ou à distance, dans un contexte pandémique tendu. Joe Biden a ainsi succédé à Donald Trump grâce aux 306 grands électeurs conquis par 81,28 millions de suffrages lors du vote populaire. L’investiture n’aura pourtant pas été facile tant le candidat perdant a agité ses électeur·trice·s avec des théories complotistes sur une élection supposément truquée, à tel point que le 6 janvier 2021, des centaines de ses partisans d’extrême droite ont attaqué le capitole pour tenter d’empêcher les grands électeurs d’entériner la victoire de Biden. Cinq personnes ont été tuées lors de cette opération planifiée depuis plusieurs semaines notamment par des groupes suprémacistes blancs. Cette insurrection peut être considérée comme le point culminant de la violence inouïe qui a caractérisé le mandat de Donald Trump et confirme sa proximité avec l’extrême droite, dont il a contribué à l’expansion en relayant quotidiennement des propos xénophobes et haineux, des fausses informations1, voire des complots, et en alimentant la défiance envers la presse et les institutions, ou encore en développant des politiques inhumaines vis-à-vis des migrant·e·s par exemple. Signe ultime que le clivage de la société américaine est à son paroxysme, le mouvement social Black Lives Matter de lutte pour la justice raciale, né à l’aube du second mandat d’Obama, en 2013, a pris une ampleur historique.
Pourtant, au contraire d’une rupture ou d’un accident, l’élection de Donald Trump s’inscrit dans la continuité de l’évolution du conservatisme américain. Personnalité clivante et hostile, Trump a aussi soudé son clan – ses électeurs, comme le parti républicain – et transmis à Joe Biden la tâche de redresser un pays en grande difficulté sans la coopération des Républicains. Pap Ndiaye, historien des États-Unis et directeur général du Palais de la Porte Dorée, et Charlotte Recoquillon, chercheuse associée à l’Institut français de géopolitique, spécialiste des violences policières, reviennent sur ces quatre années sidérantes sous la forme d’un entretien-dialogue.
–
Charlotte Recoquillon : En 2016, l’élection de Donald Trump produit un effet de surprise. Quelques mois plus tôt, personne n’aurait parié sur ce candidat venu de la télé-réalité, apparemment grossier, raciste, misogyne, sans aucune expérience politique et avec un succès modéré dans ses affaires immobilières. L’explication qui a surgi le plus rapidement est celle du retour de bâton. En effet, après l’élection historique de Barack Obama et le retour des questions raciales au centre du débat public avec Black Lives Matter et la lutte contre les violences policières, une partie de la population s’est – c’est le moins qu’on puisse dire – crispée. L’élection de Donald Trump, juste après celles d’Obama, montrait à quel point les États-Unis n’étaient pas devenus une société post-raciale (Célestine et Martin-Breteau, 2016 ; Recoquillon, 2020), que les barrières raciales n’étaient pas tombées et que, au contraire, ils étaient travaillés par deux idées exclusives l’une de l’autre : l’idée d’une société historiquement multiraciale d’une part, et celle d’une nation blanche dont la pureté et l’hégémonie seraient menacées d’autre part. Mais, rétrospectivement, on peut comprendre l’élection de Donald Trump en 2016, non pas comme une rupture ou une réaction, mais comme le résultat d’une évolution du conservatisme américain notamment.
Pap Ndiaye : On peut effectivement inscrire la victoire de Donald Trump en 2016 dans une histoire longue, celle de l’essor du conservatisme américain. Trump n’arrive pas comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il s’inscrit dans un demi-siècle d’activisme droitier au sein du parti républicain – qui a plus ou moins de succès et qui s’intensifie après l’élection de Bill Clinton (1946 – …) en 1994 et l’émergence de Newt Gingrich (1943 – …, Représentant de la Géorgie de 1979 à 1999 et chef du groupe républicain à la Chambre des représentants de 1995 à 1999).
Cette histoire longue commence dans les années 1960 et juxtapose un discours à la fois anti-État-providence et hostile aux minorités. Il s’agit de freiner, sur le front de l’égalité, l’avancée du Mouvement pour les droits civiques qui plaide pour une nation plus multiculturelle. À ce moment, les choses évoluent au sein du parti républicain, notamment avec l’arrivée de militants très radicaux, ainsi que les premiers évangéliques – qui deviendront très importants beaucoup plus tard. En 1964, le sénateur de l’Arizona Barry Goldwater (1909-1998) veut donc capitaliser sur l’électorat blanc du Sud, sur la défensive, en se présentant contre le Président sortant, le démocrate Lyndon B. Johnson (1908-1973). Sur l’aile droite du parti républicain, Goldwater incarne la rupture avec le conservatisme modéré de Dwight D. Eisenhower (1890-1969), président de 1953 à 19612. Il est très largement battu par Johnson mais sa campagne porte des thèmes très à droite en matière d’économie (faire reculer l’État-providence et minimiser l’intervention de l’État en général), mais aussi à forte connotation raciale. Puis, en 1968, Richard Nixon (1913-1994) est élu. Plus modéré que Goldwater, lui aussi tient un discours très racial, mais codé. Il dit, en substance, « ça suffit le désordre, le mouvement pour les droits civiques, les demandes des Afro-Américains, on ne peut plus supporter ces images de violence à la télévision… il faut revenir à l’ordre, restaurer la loi et l’ordre … ». C’est lui qui invente la formule à ce moment-là.
En 1980, avec un discours sur le retrait de l’État qui, selon sa formule, « est le problème, n’est pas la solution », la campagne de Ronald Reagan (1911-2004, président de 1981 à 1989) s’adresse au monde blanc, ouvrier et populaire notamment, qu’il veut faire basculer du côté républicain. En 1988, George H. W. Bush (1924-2018) est élu et restaure le parti républicain le plus classique qui soit (celui des élites moyennes et modérées, des chambres de commerce) avant d’être battu par Bill Clinton en 1992. C’est un moment très important.
En 1994, Gingrich, dont un des héros était Goldwater, théorise le tournant à droite du parti républicain autour de cinq valeurs fondamentales : liberté individuelle, opportunité économique, État fédéral aux pouvoirs limités, responsabilité individuelle, sécurité intérieure et extérieure. Ces grands principes seront la base du « Contrat avec l’Amérique » (Meyer, 2015). Héritier de cette évolution, Bob Dole (1923 – …) est candidat face à Clinton en 1996. Sénateur républicain depuis 1969, Dole est très fâché de voir l’émergence de cette aile radicale du parti dans laquelle il ne se reconnaît pas du tout. Mais au cours de primaires républicaines, on a vu émerger une autre figure, une figure pré-Trump, celle de Pat Buchanan (1938 – …). Catholique, traditionnaliste, anti-élites, populiste, il veut mener un assaut (symbolique) et se débarrasser de tous ces politiciens de Washington. Face à Dole, Buchanan n’a pas les forces politiques suffisantes et il échoue. Mais on voit déjà qu’il a de l’audience et un certain pouvoir de déstabilisation.
–

La chronologie des présidents des États-Unis et des majorités au Congrès depuis les années 1960 (© C. Recoquillon, 2021)
–
Charlotte Recoquillon : Cette trajectoire du conservatisme républicain est très éclairante pour comprendre l’émergence de Donald Trump. On voit bien que la revanche sur les droits civiques et le retour à la tradition ont été utilisés pour mobiliser l’électorat blanc, notamment autour d’idées de souffrance et de dépossession (Laurent, 2020). En attisant le sentiment de peur parmi les Blanc·he·s, les conservateurs ont activement participé à l’évolution du nationalisme blanc et des mouvements identitaires, en réaction aux avancées des Noir·e·s d’abord, à l’immigration ensuite, notamment dans les années 1990-2000, puis à la menace terroriste après les attentats du 11 septembre 2001.
Grâce au parallèle entre Nixon à la fin des années 1960 – comme réaction au Mouvement pour les droits civiques – on voit bien comment l’ascension de Trump répond aussi à la perte symbolique de pouvoir pendant huit ans de présidence Obama et l’émergence du mouvement Black Lives Matter est, aussi, une réaction aux progrès des minorités, qu’ils soient réels ou pas d’ailleurs.
Pap Ndiaye : C’est non seulement une réaction aux progrès de l’ère Obama – des progrès relatifs bien entendu – mais aussi à cinquante ans de changement. D’ailleurs, son slogan « Make America Great Again » ne parle pas d’un retour aux années Bush ou aux années pré-2008, mais d’un retour aux années 1950. Finalement, c’est une nation mythifiée, débarrassée du multiculturalisme, des minorités… bref, de tous ces changements des années 1960, y compris de la désindustrialisation qui est contemporaine du mouvement pour les droits civiques. « Make America Great Again », c’est le retour à son enfance en fait, une enfance où les Afro-Américains qu’il connait sont les serviteurs qui se tiennent à « leur place ». Il s’agit d’un retour au pouvoir de l’Amérique blanche, un pouvoir très sérieusement écorné depuis cinquante ans. Et, en cela, son discours est ancien – même s’il a une violence et une brutalité inédites, à côté desquelles Nixon apparaît comme un enfant de chœur. Nixon lui-même est un vieux politique, il avait été vice-président d’Eisenhower, ce qui lui interdisait une rupture trop grande par rapport aux élites républicaines. Au contraire, Trump peut s’en débarrasser complètement et tenir un discours d’une très grande radicalité, dont on trouve toutefois des échos chez Goldwater, Nixon, Buchanan, et même chez Reagan aussi en 1980 comme je le disais.
–

Le président Donald Trump en meeting à Battle Creek (Michigan), le 18 décembre 2019 (© AFP, 2019)
–
Charlotte Recoquillon : Donc Donald Trump s’inscrit à la fois dans la continuité et incarne la rupture dans le parti républicain. On retrouve ce paradoxe dans ses discours et sa posture politique. D’un côté, il est très clivant. De l’autre, il a une capacité remarquable à créer du « nous », à galvaniser les foules et les unir. Ce qui conduit à cette situation où, en même temps qu’il perd l’élection présidentielle (74,2 millions de voix pour Trump contre 81,3 millions pour Joe Biden), sa campagne est un succès puisqu’il convainc 11 millions de personnes supplémentaires par rapport à 2016 ! On est loin de l’accident. En se référant aux enquêtes d’opinion, on voyait que Trump bénéficiait, en comparaison de ses prédécesseurs, d’un taux d’opinions favorables particulièrement bas mais également très stable, ce qui montrait la solidité de ce bloc électoral3. Cette union s’est aussi consolidée autour des représentations de l’« Autre »… L’altérisation est un procédé que Trump a utilisé dès le début à l’encontre de Barack Obama (1961 – …), en propageant des rumeurs sur son lieu de naissance ou sa religion. En mentionnant fréquemment son nom complet, Barack Hussein Obama, il sait qu’il stimule l’imaginaire raciste des foules très majoritairement blanches qui l’écoutent. On l’a vu réitérer avec la vice-présidente Kamala Harris (1964 – …), dont il a écorché le nom volontairement à plusieurs reprises pendant la campagne. Et on peut mentionner aussi Ilhan Omar (1982 – …), une cible récurrente pendant sa campagne. En septembre 2020, lors d’un meeting à Bemidji dans le Minnesota, il demandait par exemple à la foule « comment ça va avec vos réfugiés ?4 », une référence explicite à Omar, représentante au Congrès de cet État, citoyenne américaine née en Somalie. Tous ces procédés rhétoriques ont activement participé à nourrir l’image d’une nation blanche, en désignant les non-Blanc·he·s comme des opposants pour créer un sentiment d’unité parmi sa base. Même dans son discours de clôture le 20 janvier 2021, quand il dit « nous reviendrons », je suis frappée par ce nous. Sans compter la panique que suscitent les annonces du bureau du recensement sur les évolutions démographiques des groupes raciaux et ethniques. Leurs projections sur la croissance des minorités prévoient en effet que la population blanche cessera d’être majoritaire en 2044, ce qui nourrit des craintes de relégation et d’affaiblissement parmi les Blanc·he·s5. Dans ce contexte, l’habileté et l’éloquence de Trump ont fortement contribué à son succès électoral d’abord, et politique et médiatique en général. Partagez-vous cette analyse et quels sont, selon vous, les traits saillants de ce nous pour Trump ?
–

La représentante Ilhan Omar (© Ilhan Omar for Congress, juillet 2020)
–
Pap Ndiaye : C’est effectivement cette idée d’un collectif que Trump a déclinée pendant quatre ans en s’adressant, de façon délibérée et avec une violence inédite, exclusivement à son Amérique à lui, à la « vraie Amérique », l’Amérique blanche. Il adore s’exprimer devant les foules, il est galvanisé par cette énergie et, franchement, il est un grand orateur. Il sait faire rire, il joue avec la foule avec beaucoup de talent.
Mais, en principe, on joue la polarisation pendant la campagne présidentielle, on s’adresse à « ses troupes » et puis, une fois élu, on tient un discours présidentiel et on s’adresse à tou·te·s les Américain·e·s de manière assez consensuelle. La caractéristique de Donald Trump est qu’une fois élu, il a continué de s’adresser à ses électeurs. Au fond, depuis cette fameuse scène où il est descendu par les escaliers mécaniques de la Trump Tower le 16 juin 2015 pour annoncer sa candidature, il n’a pas cessé d’être en campagne et de tenir des meetings – ce qui est inhabituel pour un président élu. Pendant quatre ans, tous ses discours et même tous ses tweets étaient tournés vers ses électeurs, vers « ses gens », « my people » comme il l’a parfois dit avec une franchise désarmante.
Donc selon moi, l’originalité de Trump n’est pas le nous de la campagne, qui me semble assez logique pour mobiliser les électeurs, mais c’est le nous présidentiel en quelque sorte, qui est inédit. Y compris si on se réfère à des présidents qui avaient fortement polarisé pendant leur campagne comme Nixon, par exemple, ou même Reagan en 1980, qui avait abandonné le discours partisan une fois entré à la Maison Blanche. Avec Trump, il y a autre chose qui se produit et qui est, à ma connaissance, complètement inédit dans l’histoire politique américaine.
Ce nous présidentiel, qui délimite une population d’électeurs, son peuple, épouse une double norme sociale : celle d’une Amérique non seulement blanche, mais aussi rurale, à l’opposé de celle des grandes villes. C’est très frappant de voir comment Trump a abandonné New York, dont il est lui-même natif. Et, de manière réciproque, New York l’a très violemment rejeté. Il réalise des scores extrêmement faibles dans les grandes villes6. Il faut aller vers le Texas, ou vers le Sud le plus conservateur pour trouver des villes moyennes qui ont voté pour Trump ! Typiquement, une ville comme Birmingham (62 %), par exemple, ou Mobile (55,3 %) dans l’Alabama ont majoritairement voté pour lui. Mais si on regarde les très grandes villes, les scores de Trump sont vraiment très mauvais, y compris en dehors des côtes, comme à Denver (41,9 %), à Kansas City (38 %), et sans parler des grandes villes du Texas (31,6 % à El Paso, 26,4 % à Austin, 33 % à Dallas…), ou de Saint-Louis où il réalise un score de 16 % ! Donc à qui parle-t-il, au fond ? Le rapport de Trump aux grandes villes me semble très intéressant. Qu’est-ce que la grande ville finalement, sinon la ville des minorités et du cosmopolitisme, la ville océanique tournée vers le monde, en quelque sorte ? Cette grande ville est emblématique de l’autre Amérique, celle qu’il rejette, l’Amérique bleue, celle qui ne veut pas de lui. À l’opposé de son Amérique rêvée, l’Amérique blanche. Il rêve que les très grandes villes aient moins de poids et, finalement, c’est encore un portrait des années 1950.
Mais même si la caractéristique première est raciale, cela ne veut pas dire que ce nous blanc ne peut pas admettre, au compte-goutte, des non-Blanc·he·s, par cooptation, si ces derniers donnent tous les gages de rejet du groupe racialisé auquel ils peuvent être assimilés. Ils permettent à Trump de s’enorgueillir d’être l’ami des Noirs – il le faisait d’ailleurs en campagne en désignant dans la foule parfois une personne noire en disant « vous voyez, moi j’ai des amis… je suis l’ami des Noirs » et en organisant des petits groupes de « African Americans for Trump ». Des coquilles vides en fait, mais il en a besoin pour donner le change sur les marges. La réalité, c’est qu’il parle à un groupe : l’Amérique blanche. Et, « les Autres », ce sont les démocrates, les mondialistes, les cosmopolites, les minorités… ça fait beaucoup de monde, évidemment, « les Autres ».
–
Charlotte Recoquillon : Il est vrai que d’entendre Donald Trump pérorer qu’il est le président ayant le plus fait pour les Africain·e·s-Américain·e·s, est assez sidérant. Dès son élection, le Southern Poverty Law Center a relevé une hausse importante des agressions racistes, ce qui montre que ses électeurs avaient bien compris son message. Sans compter la multitude de déclarations et décisions politiques7 qui ont eu des effets néfastes sur les minorités, en particulier les Noir·e·s. Mais Trump a systématiquement nié être raciste, même avant d’être président. En outre, les personnes concernées ne sont pas non plus exemptes de préjugés. Alicia Garza (2020 : 95-122) explique, par exemple, que ce qui l’a poussée à fonder Black Lives Matter en 2013 était son exaspération vis-à-vis des discours sur la responsabilité personnelle des jeunes hommes noirs, victimes de conditions sociales et politiques qu’ils n’ont pas créées et auxquelles ils ne peuvent échapper. Des discours portés par des leaders noirs, à commencer par Barack Obama, et qui reflètent une « croyance ancienne dans les communautés africaines-américaines [que] si les personnes noires se comportaient correctement, les autres agiraient de manière juste avec eux » (Garza, 2020 : 115).
Pap Ndiaye : Il y a une norme sociale antiraciste, comme en France où l’on est supposément « aveugles à la couleur ». Aux États-Unis, un homme politique de premier plan ne peut pas ouvertement dire « je suis raciste ». Même le plus réactionnaire dans le comté le plus réactionnaire du Mississippi. Bien entendu la réalité est toute autre. Mais le racisme d’aujourd’hui est moins un racisme pur et dur à l’ancienne, un racisme biologique qu’un racisme culturel8. Et donc il y a des gens qui tiennent des propos racistes, qu’ils ne considèrent pas comme racistes parce qu’on s’est déplacé du racisme biologique vers d’autres formes de racismes.
Charlotte Recoquillon : Et le mouvement antiraciste a d’ailleurs particulièrement exposé le racisme dans ses dimensions systémiques, c’est-à-dire son omniprésence dans les institutions, comme un héritage du passé. D’ailleurs, il y a un autre élément original chez Trump c’est son rapport à l’histoire et, notamment, à un certain récit national. Cette saison électorale a montré une nation américaine très mobilisée sur les questions d’identité, d’origines et de destin commun. Trump a participé à remettre sur le devant de la scène des symboles historiques, notamment ceux de l’armée confédérée, des Sécessionnistes et des esclavagistes…
Pap Ndiaye : Des symboles repris par un président qui n’a aucun goût pour l’histoire d’ailleurs, comme il l’a avoué lui-même. Quand il lui a fallu choisir son président préféré, comme la tradition pour le président nouvellement élu l’y invite, il lui a fallu un peu de temps et il a finalement choisi Andrew Jackson. Président entre 1828 et 1837, sa première caractéristique est d’avoir été un grand massacreur d’Indien·ne·s. Mais il fut aussi, d’une certaine manière, un des premiers présidents non Virginien9. Il est d’origine modeste, et lorsqu’il a été élu en 1828, il a, en quelque sorte, mis fin à la domination des Virginiens sur la Maison Blanche depuis les origines des États-Unis. Donc il y a eu ce clin d’œil à Jackson, qui n’a pas fait plaisir du tout aux Amérindien·ne·s.
Ensuite, il me semble que Trump n’a pas manifesté un intérêt particulier pour l’histoire – sauf à propos des statues des généraux confédérés qu’il a défendues bec et ongles, y compris contre l’armée quand le Pentagone souhaitait débaptiser des bases et en supprimer les références aux généraux sudistes. Et, c’est absolument clair, il a fait de la défense du Sud confédéré un élément très important, un marqueur idéologique de sa présidence, avec une vigueur que là encore on ne connaît pas dans l’histoire récente des États-Unis. Il faut sans doute remonter à Thomas W. Wilson (1856 – 1924), premier sudiste élu après la guerre de Sécession pour retrouver un président (1913-1921, démocrate) aussi indulgent à l’égard du Sud confédéré. Ça fait quand même un siècle que les présidents américains ne se permettent pas d’avoir des mots aussi indulgents pour le Sud confédéré ! Et d’ailleurs les partisans et les racistes du Sud, les suprémacistes blanc·he·s, ne s’y sont pas trompé·e·s. Dans les meetings de Trump, des drapeaux confédérés flottent à chaque fois. On en a vus également le 6 janvier, lors de l’insurrection du Capitole, où l’un de ces drapeaux confédérés est même entré, pour la première fois. Même les sudistes n’avaient pas réussi à prendre Washington au début de la guerre de Sécession et il y avait une certaine fierté à dire que le drapeau confédéré n’avait jamais flotté sur le Capitole. Mais cette fois, il y est entré, et par l’intermédiaire de Trump, littéralement. Donc ses références à l’histoire sont incroyablement marquées d’un point de vue idéologique et il y a maintenant une centralité autour de la guerre de Sécession et du Sud confédéré qui est complètement inédite. Même Reagan ou Nixon ne faisaient pas de clins d’œil aussi appuyés à l’électorat suprémaciste.
Charlotte Recoquillon : De ce point de vue-là l’insurrection du Capitole est vraiment la continuité et l’apothéose de ce mouvement. Et quand on pense qu’en 2015, la réalisatrice et militante américaine pour les droits civiques Bree Newsome (1985-…) décrochait un drapeau confédéré flottant devant le parlement de Caroline du Sud, et qu’en 2021, des centaines de suprémacistes aidés par Trump le font entrer au Capitole, on mesure à quel point les rapports de force sont actifs.
Pap Ndiaye : D’ailleurs, il y a toute une continuité dans le mandat Trump avec ces groupes d’extrême droite très actifs, et longtemps sous-estimés. Mais ce sont pourtant ces groupes, très bien organisés, qui étaient à la manœuvre le 6 janvier dernier, charriant avec eux les habituels égarés de l’extrême droite. Ils avaient déjà entamé cette unification en août 2017 à Charlottesville. Il y a là des continuités qui sont extrêmement inquiétantes pour la démocratie américaine.
Charlotte Recoquillon : Effectivement, déjà en 2017, Trump n’avait pas dissimulé son soutien aux suprémacistes blanc·he·s lorsqu’il avait déclaré qu’il y avait « des gens bien des deux côtés » (« some very fine people on both sides »). Pour mémoire, le 12 août 2017 à Charlottesville, en Virginie, cette manifestation « unite the right » avait pour objectif d’unifier et consolider les différents groupes de suprémacistes et nationalistes blanc·he·s et constituait en même temps une démonstration de force et une opération d’intimidation vis-à-vis des antiracistes qui voulaient que la statue du Général Lee soit démontée. Les suprémacistes, dans une ambiance agressive, armé·e·s de torches enflammées et de tenues codées, se sont opposés aux antiracistes, au point qu’une voiture a foncé dans la foule, tuant une jeune manifestante antiraciste. Et dans la continuité, on a l’insurrection du Capitole. Cette opération coordonnée plusieurs semaines en amont, avec de la levée de fonds, des bus pour acheminer les insurgés… a sollicité toutes les infrastructures de l’extrême droite. Quant au discours de Donald Trump qui invite ses soutiens à y participer, ce n’est pas qu’un petit clin d’œil idéologique mais l’aboutissement de la consolidation de l’extrême droite (Recoquillon, 2021.
Pap Ndiaye : Oui, on est très loin d’un mouvement spontané auquel Trump aurait simplement servi de détonateur. Il y a un degré élevé de planification. Cela ne veut pas dire d’ailleurs que ces groupes d’extrême droite vont rester accrochés à Trump pour toujours. Il y a déjà des groupes qui ont pris leurs distances en considérant qu’il s’était un peu dégonflé dans la dernière semaine, qu’il n’était pas allé jusqu’au bout d’une démarche qui, dans leur esprit, devait conduire à un coup d’État pur et simple. Et ces groupes fascisants – ce n’est pas un vocabulaire que j’emploie à la légère, mais je n’en trouve pas d’autre pour parler de ceux qui considèrent que Trump n’est plus le bon cheval – peuvent se tourner vers un autre candidat. Finalement, Trump quitte ses fonctions en ayant quand même participé à la structuration et à la consolidation de ces groupes-là et, même si ce n’est plus lui leur prochain candidat, il risque d’y avoir un espace pour un autre candidat d’extrême droite sur lequel ils vont investir. On parle de Josh Hawley (1979 – …), le plus jeune sénateur des États-Unis (Missouri)– qui est d’ailleurs soupçonné d’avoir participé à l’insurrection dans les jours précédents par des manœuvres indirectes. Ted Cruz (1970 – …), sénateur du Texas, pourrait aussi être un candidat à la tête d’affiche de l’extrême droite du parti républicain. En tout cas, il n’est pas du tout sûr que Trump puisse survivre à cette séquence, non pas par sa radicalité mais par son manque de radicalité ! Ces groupes suprémacistes lui reprochent de s’être arrêté au bord du Rubicon, de s’être dégonflé au dernier moment et de n’avoir pas été jusqu’au bout de la voie qui avait été ouverte par la prise d’assaut du Capitole. Cependant, quelques semaines après son départ, on voit que l’influence de Trump dans le parti républicain reste forte, et qu’il n’a pas été lâché.
–

Les émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole (Washington D.C.) (© Leah Millis / Reuters, 2021)
–
Charlotte Recoquillon : Il y a donc tout ce qui s’est passé du côté de l’extrême droite américaine, qui s’est enhardie et consolidée au point d’aboutir aux événements spectaculaires du 6 janvier, mais il y a également eu un mouvement social à gauche d’une grande vigueur. D’ailleurs, les deux mouvements se font écho et réagissent l’un à l’autre. La présidence de Trump a aussi été marquée par Black Lives Matter, qui a ensuite joué un rôle déterminant dans l’élection de 2020 en se mobilisant fortement pour assurer la victoire de Biden ou, surtout, pour assurer la défaite de Trump. Ce mouvement pour la justice raciale est né en 2013, sous Obama donc, mais a progressé au point de devenir, en juin 2020 après le meurtre de George Floyd, le plus grand mouvement social de l’histoire américaine selon le New York Times ! En quoi son ampleur est historique ?
Pap Ndiaye : Premièrement, c’est le plus grand mouvement social de l’histoire des États-Unis ! Il est beaucoup plus important, dans son ampleur, que les plus grands mouvements des années 1960 ou que les grands mouvements ouvriers des années 1880 (comme les grandes grèves à Chicago en 1886) ou des années 1930 avec les grèves massives de chômeurs au moment de la grande dépression. Si on compare Black Lives Matter avec ces épisodes importants, celui-ci les surpasse dans sa géographie et dans son ampleur numérique. En cela, quelles que soient les conséquences à long terme, c’est déjà un moment historique.
Deuxièmement, la géographie de ces mobilisations n’est pas simplement calquée sur la géographie de l’Amérique noire. La population africaine-américaine est très réduite dans certaines villes de premier plan dans les manifestations, comme Portland ou Seattle, par exemple. Si on prend le cas du Vermont, sur lequel je me suis un peu plus penché, c’est l’État où, avec l’Alaska, la population noire est la plus faible. Et pourtant, à Burlington, la ville du sénateur Bernie Sanders (1941 – …), et dans d’autres villes, des manifestations que le gouvernement n’a jamais connues depuis 1791, depuis la révolution américaine, ont eu lieu !
Il y a aussi des manifestations dans les grandes villes noires bien sûr, et dans des villes où la population noire n’est pas importante mais qui se sont mobilisées pour des raisons conjoncturelles, comme à Minneapolis. La population noire y est relativement réduite, environ 18 %, mais Minneapolis a été au centre pour des raisons évidentes [ville où George Floyd a été tué par Derek Chauvin le 25 mai 2020]… Donc la géographie de Black Lives Matter couvre l’ensemble du pays, avec une mobilisation plus marquée dans les grandes villes, mais aussi dans les college towns, des villes universitaires qui ne sont pas forcément très grandes mais où la jeunesse estudiantine a été très mobilisée. Le fait qu’il n’y avait pas de cours, en raison de l’épidémie de Covid-19, a pu les aider à se mobiliser. C’est vrai pour les lycéens aussi d’ailleurs. À Chicago, par exemple, ils ont manifesté parce que leurs possibilités de le faire étaient plus grandes. Le fait de ne pas avoir de cours c’est très important pour la mobilisation de la jeunesse. C’est pour que les enfants puissent participer aux manifestations que les professeurs font grève dans les lycées de Birmingham au printemps 1963, par exemple. Donc, pour en revenir à Black Lives Matter, la participation lycéenne est un élément tout à fait important. On s’en aperçoit dans le Vermont, où les lycéen·ne·s entraînent toute leur famille.
Et puis il y a une autre carte, c’est celle des mobilisations anciennes. Oakland, par exemple, s’est fortement mobilisée pour Black Lives Matter mais est déjà une ville centrale pour les Black Panthers10 dans les années 1960, ou pour le garveyisme11 dans les années 1920, dont elle accueille une des sections les plus importantes du pays. Donc il y a des histoires de mobilisations intéressantes et qui se transmettent dans les familles. Cette histoire longue donne le sentiment, quand on manifeste à Birmingham ou à Montgomery dans l’Alabama par exemple, d’être juché sur les épaules des géants comme disent les Américains. Quel sentiment quand on est à Montgomery, près du Capitole, à côté de l’église Dexter de Martin Luther King, quand on est sur une terre qui a déjà vu de la sueur et du sang de ceux qui, il y a 50 ou 60 ans manifestaient ! C’est une terre qui a été arpentée par des géants et les gens sont imprégnés de ce sentiment, de cette notion d’être dans les pas de celles et ceux qui ont ouvert la voie. Il y a le sentiment d’une responsabilité qui est particulièrement évident dans les villes qui furent des hauts-lieux de la révolte noire.
Charlotte Recoquillon : Et un sentiment qui est nourri, par la transmission intergénérationnelle, certes, mais aussi sciemment organisé par le mouvement Black Lives Matter qui, justement, fait un travail de mémoire et d’historicisation. On parlait tout à l’heure du rapport de Trump à l’histoire mais celui des activistes contemporains à l’histoire étatsunienne est passionnant. Ce ne sont pas les premiers à s’y intéresser, bien sûr. Les Black Panthers avaient développé de nombreux programmes éducatifs aussi, pour servir les communautés noires, dont les écoles publiques étaient souvent déplorables du fait du désinvestissement chronique. Or, dans ces programmes éducatifs12, l’histoire comme un lieu de bataille idéologique et comme outil à la portée émancipatrice, notamment pour les plus jeunes, avait une place importante. On retrouve cette approche critique dans le mouvement aujourd’hui. Les activistes déploient beaucoup d’énergie et de pédagogie pour vulgariser des épisodes ou des notions historiques peu visibles auparavant et pour outiller les militant·e·s et le grand public avec des connaissances historiques. Ainsi, par exemple, l’inoculation du virus de la syphilis à quatre cents Noir·e·s à Tuskegee en 1932 et l’histoire de la discrimination dans le domaine de la santé sont mobilisées par les militant·e·s pour expliquer la plus grande défiance des communautés noires vis-à-vis de la vaccination contre le coronavirus aujourd’hui. D’autres initiatives sont portées par le cinéma. Avec sa série sur Netflix, la réalisatrice Ava Duvernay a ainsi donné une visibilité inédite à l’histoire des Cinq de Central Park, cinq adolescents injustement accusés du viol et de l’agression d’une joggeuse blanche à Central Park en 1989 et contre lesquels Trump avait demandé la peine de mort en achetant une pleine page de publicité dans quatre journaux de New York. La réhabilitation de ces hommes aux yeux du grand public est une forme de réparation et l’un d’entre eux, Yusef Salaam, a annoncé qu’il serait candidat à l’élection sénatoriale de l’État de New York.
Pap Ndiaye : Oui, il y a cette histoire, cultivée, travaillée… Les activistes la cultivent parce que c’est une force morale que de s’appuyer sur une histoire héroïque, qui donne du cœur, qui donne du courage, qui donne de l’enthousiasme ! Je suis frappé par le fait qu’il y a des cours d’histoire dans les sections les plus actives de Black Lives Matter ! Et ces récits historiques ne sont pas simplement une histoire de malheur, c’est aussi une histoire héroïque si l’on peut dire, c’est une histoire édifiante, une histoire qui vise à faire des militant·e·s, pas à faire des professeur·e·s d’histoire. Et c’est une histoire qui vise à galvaniser aussi…
Charlotte Recoquillon : Effectivement, elle vise aussi à faire comprendre comment le système et les institutions sont imprégnés par cet héritage historique. Il semble que le point commun entre tous les exemples de mobilisations cités, c’est qu’ils sont toujours organisés. Même lorsqu’ils peuvent paraître spontanés en apparence, démarrer ou changer d’échelle brusquement à la suite d’un événement faisant l’effet d’un détonateur, ils sont en fait toujours travaillés en amont. Et ils ne sont, en tout cas, pas seulement le fruit des réseaux sociaux. Le terme organized social movement circule justement de plus en plus pour désigner cette dimension. On voit bien qu’il y a une insistance sur la dimension active, pensée, intentionnelle de l’organisation et du développement de ce mouvement social.
Pap Ndiaye : L’ancienneté de l’organisation est primordiale. Ce n’est pas le jour dit qu’on organise une manifestation. C’est littéralement du community organizing, en fait, où un vrai travail de terrain est développé. C’est pour ça que ce qui s’est passé après le meurtre de George Floyd était à la fois imprévu par son ampleur, mais en même temps la cristallisation d’années de travail, parfois très silencieux et très peu visible mais qui a permis et produit l’ampleur nationale de ce mouvement.
Charlotte Recoquillon : Je partage totalement cette analyse. Pour comprendre l’ampleur de la mobilisation qui suit la mort de George Floyd, il ne suffit pas de prendre en compte la période pré-électorale de tensions raciales, ni même les États-Unis de Trump. D’ailleurs, expliquer ce passage d’une mobilisation locale à un mouvement de masse est l’objet du livre d’Alicia Garza (2020). Le mouvement qu’elle a co-initié, Black Lives Matter, est né à la charnière entre les deux mandats du premier président noir des États-Unis. Certes, Obama avait peu d’espace politique pour mener une politique d’égalité raciale offensive, mais était quand même plutôt embarrassé par la question raciale. Comment Donald Trump s’est positionné lui sur la question raciale et sur Black Lives Matter ?
Pap Ndiaye : Il me semble que Trump a toujours été clair sur son mépris et son hostilité à l’égard de Black Lives Matter. Avant même de se lancer en politique d’ailleurs. En 1989, il s’était illustré dans l’affaire des Cinq de Central Park. Donc Trump a une longue histoire d’agissements et de déclarations racistes, documentée. Sans parler de la ségrégation qu’il pratiquait avec son père, Fred Trump, dans leurs logements jusque dans les années 1970 et 1980. Donc sa réaction à l’égard de Black lives Matter est cohérente. Cette hostilité à l’égard des minorités ne s’est jamais démentie et a culminé en mai dernier, lorsqu’il a déclaré « when the looting starts, the shooting starts » (quand le pillage commence, la fusillade démarre). C’est une expression remontant à 1967 qui constitue littéralement un appel au meurtre. Par cette formule, il a souhaité que l’armée puisse intervenir dans la répression des manifestations de Black Lives Matter – ce que l’armée a refusé. Donc, à l’image de son racisme aveuglant, la réaction de Trump à l’égard des manifestants fut agressive et violente, et s’il avait eu les mains libres, ça aurait été un carnage.
–
Charlotte Recoquillon : Donald Trump quitte donc le pouvoir en laissant les États-Unis encore plus clivés. D’un côté, le mouvement social a fortement progressé et s’est consolidé – sur le front de Black Lives Matter mais aussi sur le front de la gauche radicale en général et notamment des socialistes démocrates de Bernie Sanders. Leurs progrès peuvent se mesurer à la sophistication du débat public et le progressisme des revendications avancées ces dernières années. Mais de l’autre côté, toute aussi consolidée, il y a une Amérique blanche, le nous de Donald Trump dont nous parlions tout à l’heure. Ces deux parties semblent complètement irréconciliables et plus que jamais éloignées et divisées. La tâche pour Biden sera compliquée. Lui se dit réconciliateur et homme de consensus, et pour cela il veut à la fois lutter contre le suprémacisme blanc et faire l’unité des Américain·e·s. Deux objectifs qui paraissent incompatibles. Surtout dans la mesure où la gauche radicale réclame non pas un retour au consensus mais un dépassement de la situation pré-Trump. La mission de Biden est-elle possible ?
Pap Ndiaye : Biden a devant lui une tâche herculéenne à accomplir. À cela il faut ajouter la crise sanitaire et la crise économique13. Bref, les dossiers sur son bureau sont énormes et jamais un président américain n’a été confronté à cela depuis Franklin Roosevelt quand il arrive en mars 1933 à la Maison Blanche. Il doit alors affronter la crise économique bien sûr, mais aussi la crise politique avec des manifestations, avec des millions de gens, des vagabonds, et avec une Amérique ouvrière très profondément déstabilisée – et à la merci d’un démagogue fasciste, c’était une possibilité aux États-Unis comme en Europe à la même époque. Comment va-t-il s’y prendre ? Ça je ne suis pas sûr qu’on puisse déjà le dire. Ce qui me paraît pourtant évident c’est qu’il faut s’attaquer aux groupes fascistes. Il faut extirper, arrêter et poursuivre ces groupes qui représentent depuis longtemps des menaces, pas seulement pour la démocratie, mais des menaces vitales ! Ce sont des groupes sur-armés qui, de toute évidence, peuvent passer à l’action. Ils l’ont fait, et ils peuvent être encore plus dangereux qu’ils ne l’ont été. Donc je ne vois pas comment on peut laisser prospérer des groupes fascisants aux États-Unis, qui ont grossi, qui ont relevé la tête depuis 4 ans… D’ailleurs, j’étais aux États-Unis au moment de l’élection de Trump en 2016 et je me souviens qu’on voyait, par le biais de la presse américaine aussi, des pick-ups avec des drapeaux confédérés qui paradaient dans les quartiers noirs de plusieurs villes. C’était une manière de dire voilà, on est au pouvoir, on a gagné. C’était une sorte de provocation. À Oakland et ailleurs, des membres des « Proud Boys », des hommes surarmés se promenaient avec des drapeaux en jouant la provocation et en attendant une réaction ou une étincelle pour pouvoir tirer et avoir recours à la violence. Et cela, ça s’appelle une milice fasciste. C’est ainsi qu’ils faisaient dans les quartiers ouvriers de Berlin au début des années 1930. Donc, le FBI et les polices fédérales peuvent s’attaquer à cette menace-là et, pour moi c’est prioritaire, si non de se débarrasser, en tout cas de limer les crocs de ces groupes-là qui sont particulièrement venimeux.
–
Charlotte Recoquillon : On a beaucoup parlé du rôle des réseaux sociaux à la fois dans la mobilisation de Black Lives Matter – surtout dans ses débuts – mais aussi dans la radicalisation des militants d’extrême droite mais ces défilés de pick-ups avec des drapeaux montrent que c’est aussi une bataille qui se passe sur le sol, sur le terrain physiquement, et pas seulement sur les forums de la fachosphère (Miller-Idriss, 2020).
Pap Ndiaye : C’est aussi une réalité matérielle, effectivement. Il y a des gens armés un peu partout dans le pays, chauffés à blanc par Trump et qui n’ont pas déposé les armes – c’est le moins qu’on puisse dire ! – même s’ils ont reçu un coup puisque plusieurs ont été arrêtés suite aux événements du 6 janvier 202114.
Charlotte Recoquillon : On commençait à partir sur l’hypothèse d’une politique de Biden plus au centre, plus conservatrice et la configuration d’un bras de fer avec sa gauche. Mais finalement, les premières semaines de Joe Biden au pouvoir furent assez surprenantes. Il semble aller au-delà des effets d’annonce et des mesure cosmétiques. Même sur le plan social, Joe Biden se montre plus offensif que nous pouvions imaginer.
Pap Ndiaye – Au départ, cela n’a pas tellement été un bras de fer avec sa gauche. Attendons quand même de voir ce qui va se passer autour de la question migratoire, notamment. Nous sommes à nouveau dans une situation de crise de ce côté-là, et nous ne savons pas encore comment la nouvelle administration va y réagir. On peut penser qu’elle ne mettra pas en œuvre des politiques aussi inhumaines que Trump, notamment la séparation des enfants et de leur famille, mais dans quelle mesure l’administration Biden va introduire une inflexion par rapport à l’époque Obama, pour l’instant ce n’est pas clair. La question migratoire risque d’être une des pierres d’achoppement avec la gauche, si achoppement il y a.
Sinon, tant du point de vue de la nomination du gouvernement que des responsables des agences au plus haut niveau de l’État, il a nommé des gens professionnellement compétents et avec beaucoup de diversité. À commencer par son choix de Kamala Harris, dont la vigueur du symbole est très puissante. Ça, c’est l’opposé de Trump qui ne nommait que des Blanc·he·s, voire des incompétents. Cela dit, même si elle n’est pas sur l’aile gauche du Parti démocrate du tout, le programme de Biden est beaucoup plus à gauche que celui d’Obama en 2008 ! On voit que le programme de Biden a été marqué par le challenge posé par Bernie Sanders et Elizabeth Warren lors des primaires.
Sur le plan social, il montre beaucoup de signes intéressants, comme son soutien au doublement du salaire minimum, par exemple. Il faut dire qu’il est imprégné du New Deal de Roosevelt, c’est sa référence. Il s’imagine avoir sur les bras une situation aussi grave que celle de Roosevelt et donc il est imprégné aussi de l’idée des 100 jours, de l’idée d’imprimer très vite et très fort un tournant et que, sinon, les élections de mi-mandat dans deux ans pourraient être délicates pour le parti démocrate – qui pourrait même perdre la Chambre des représentant·e·s. Donc, il y a peut-être l’idée d’une inflexion à gauche pour mobiliser et, surtout, pour ne pas s’enliser. Et puis il y a une autre variable très importante : c’est qu’il n’y a rien à négocier avec un parti républicain tellement trumpisé ! Et c’est une des surprises aussi. On pensait qu’après la défaite de Trump il y aurait une désintoxication, que Trump serait lâché, mais pas du tout, il garde une emprise remarquable. Donc, Joe Biden se heurte à un parti républicain avec qui il n’est plus possible de négocier quoi que ce soit, tellement c’est un parti radicalisé, droitisé, trumpisé, hors d’atteinte. Pourtant, en tant que sénateur modéré du Delaware, habitué des parties de golf avec ses amis sénateurs républicains et des sociabilités de la haute société politique de Washington, Biden est un président qui était taillé sur mesure pour les accords bipartisans. Mais quitte à ne pas pouvoir négocier quoi que ce soit avec les Républicains, autant aller sur une ligne plus marquée à gauche. Donc je vois ses premières semaines aussi comme un effet de la non-coopération des Républicains, qui ne laissent pas beaucoup d’espace au milieu – si tant est que ce soit son équilibre de départ.
–
Charlotte Recoquillon : Au moment de la publication de ce texte, en novembre 2021, le taux d’approbation de Biden est en chute après une séquence politique difficile. Le retrait des troupes d’Afghanistan et la révélation de tirs sur des civils, l’évacuation chaotique du pays, l’abandon de la population afghane… ont assombri cette décision. Sur le plan de la politique étrangère, Biden n’a pas tenu sa promesse de rupture et semble s’inscrire dans la continuité de la politique de Trump. Du côté de la crise sanitaire, après une première phase de vaccination plutôt réussie, la circulation du variant delta du coronavirus a de nouveau fragilisé le pays. Sur le plan économique de nouvelles inquiétudes émergent et sur le plan politique, le président rencontre des difficultés à faire voter ses lois. Son plan de relance a été amputé, l’effacement de la dette des étudiants sera finalement limité, quand l’accord bipartisan sur la réforme de la police a lui été enterré définitivement. Ainsi, Biden semble décevoir sa gauche. Les républicains et les conservateurs se sont de nouveau emparés de la question raciale, notamment en agitant le débat public avec des accusations d’endoctrinement des écoliers par la théorie critique de la race. L’approche des élections de mi-mandat, en novembre 2022, sont une source légitime de préoccupation pour les démocrates.
ENTRETIEN RÉALISÉ EN MARS 2021, MIS À JOUR À L’AUTOMNE 2021
–
Couverture : Manifestation Black Lives Matter à Minneapolis le 4 juin 2020 (© AFP / Chandan Khanna, 2020)
–
Bibliographie
Alba R., 2020, The Great Demographic Illusion: Majority, Minority, and the Expanding American Mainstream, Princeton University Press, 336 p.
Beaud S. et Noiriel G., 2021, Race et sciences sociales : Essai sur les usages publics d’une catégorie, Agone, 432 p.
Benn Michaels W., 2009, La Diversité contre l’égalité (The Trouble with Diversity), Paris, Raisons d’agir, 155 p.
Célestine A. et Martin-Breteau N., 2016, « “A movement, not a moment”: Black Lives Matter and the reshaping of minority struggles under Obama », Politique américaine, vol. 28, n° 2, p.15-39.
Garza A., 2020, The Purpose of Power, How We Come Together When We Fall Apart, One World, 336 p.
Laurent S., 2020, Pauvre petit Blanc, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 230 p.
Meyer A., 2015, « Chapitre II. Des paroles et des hommes », Les républicains au congrès, La résistible ascension des conservateurs américains, Presses Universitaires de Rennes, 276 p., pp. 61-87.
Miller-Idriss C., 2020, Hate in the Homeland: The New Global Far Right, Princeton University Press, 272 p.
Ndiaye P., 2021, Les Noirs Américains. De lesclavage à Black LIves Matter, Tallandier, 272 p.
Recoquillon C., 2020, « “Black Lives Matter” : mobilisation politique des Noir·e·s contre le racisme systémique dans l’Amérique d’Obama », Géographie et Cultures, CNRS, n° 114.
Recoquillon C., 2021, « Trump “a permis le développement de l’extrême droite à l’échelle mondiale comme jamais vu auparavant” », Basta Mag, 15 mars.
–
Pour citer cet entretien : Ndiaye P. et Recoquillon C., 2021, « Entretien : Les années Trump. Conservatisme, suprémacisme et Black Lives Matter. Regards croisés sur les États-Unis », Urbanités, Dossier / Les villes nord-américaines à l’ère de Trump, novembre 2021, en ligne.
–
- À de nombreuses reprises, le journalisme de vérification a révélé que les déclarations de Donald Trump étaient partiellement ou totalement fausses. Après 941 vérifications, le Poynter Institute a recensé 73 % de déclarations au moins partiellement fausses. Quant au Washington Post, au 20 janvier 2021, les journalistes avaient identifié 30 573 déclarations fausses trompeuses en quatre ans. [↩]
- Il critiquait aussi bien l’administration démocrate de John F. Kennedy (1917-1963), Président de 1961 jusqu’à son assassinat en 1963, que le parti républicain modéré des chambres de commerce qu’Eisenhower incarnait. À ses yeux, ce parti républicain ne rompait pas avec le New Deal et l’avait même validé quand il était revenu au pouvoir en 1952 – après avoir été absent du pouvoir pendant 20 ans. [↩]
- Selon Gallup, 45 % des Américain·e·s approuvaient Trump dans ses fonctions au début de son mandat et, ce chiffre ayant faiblement oscillé, ils et elles étaient toujours 43 % à l’approuver au lendemain de l’élection. Barack Obama avaient pris ses fonctions avec en janvier 2009 avec un taux d’approbation record de 67 %, mais ce taux a connu de fortes et fréquentes variations pour atteindre 43 % en août 2010, par exemple, ou encore 57 % en décembre 2012. De même, Joe Biden a déjà oscillé entre 57 % en janvier 2021 à 49 % en août 2021. [↩]
- « You’re having a good time with the refugees ». [↩]
- À propos de l’évolution démographique et sociologique de la majorité blanche et des minorités, lire The Great Demographic Illusion de Richard Alba (2020). [↩]
- Le déclin du parti républicain dans les grandes villes, où il peine à toucher un électorat urbain, plutôt jeune, minoritaire, multiculturel, était une tendance antérieure à Trump. [↩]
- Rashawn Ray et Keon L. Glibert (Brookings Institution) esquissent une réponse à cette affirmation de Trump en passant en revue ses actions en matière d’économie, de lutte contre les discriminations, de police et de justice, et de politique de santé : https://www.brookings.edu/blog/how-we-rise/2020/10/15/has-trump-failed-black-americans/. [↩]
- Aux États-Unis, l’organisation politique et sociale de la société a d’abord reposé sur des critères biologiques, comme la règle de l’unique goutte de sang (one-drop rule) qui assignait à la catégorie noire toute personne ayant un seul ancêtre noir ou métisse. Le racisme culturel, notion apparue après la Seconde guerre mondiale, est une forme plus sophistiquée du racisme qui fait référence aux identités, à des mœurs considérées comme problématiques… et qui aboutit, comme le racisme biologique, à la hiérarchisation des groupes ethno-raciaux et au refus de la mixité. [↩]
- La Virginie est l’État natal de huit présidents américains (George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, William Henry Harrison, John Tyler, Zachary Taylor et Woodrow Wilson) dont quatre parmi les cinq premiers. [↩]
- Parti politique révolutionnaire pour la libération des Noirs fondé en 1966 à Oakland par Huey P. Newton et Bobby Seale. [↩]
- En référence au mouvement nationaliste noir de Marcus Garvey. [↩]
- Un de ces programmes les plus emblématiques était la Oakland Community School (OCS), une école primaire le quartier de Fruitvale à East Oakland, dirigée par Ericka Huggins. [↩]
- Au moment de la révision de ce texte, en septembre 2021, le retrait des troupes américaines d’Afghanistan et la reprise du pouvoir par les talibans sont devenus un défi politique majeur pour Joe Biden. [↩]
- Au moins 570 participant·e·s sont poursuivis pour trouble à l’ordre public et présence illégale dans un bâtiment fédéral. Les procès sont attendus pour janvier 2022. [↩]