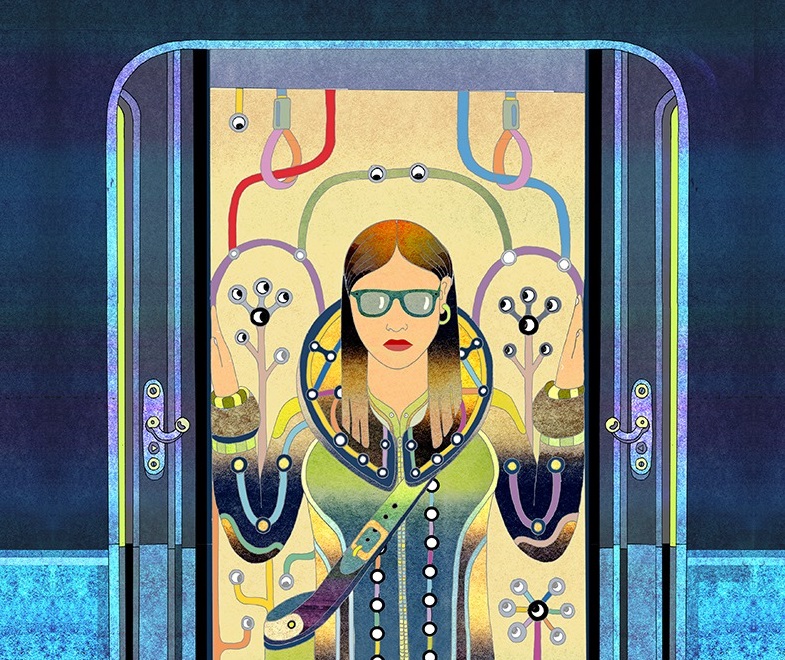Lu / Les sens de la ville, Corinne Luxembourg, Damien Labruyère et Emmanuelle Faure
Marc Dumont
Le Lu de Marc Dumont au format PDF
 Malgré une récente montée en puissance, les recherches portant sur les différentes façons concrètes d’agir sur les inégalités de genre et les formes variées de domination en milieu urbain restent encore marginales dans le champ de l’urbanisme, de ses débats théoriques et scientifiques autant que dans le cadre des univers techniques et professionnels de la conception urbaine. Ce n’est pas une nouveauté que de relever la difficulté persistante des questions d’inclusion sociale à se frayer une véritable place aux côtés de celles largement dominantes des logiques de valorisation économiques et foncières d’opérations immobilières ou de production d’infrastructures. Cette situation peut s’interpréter au croisement de plusieurs facteurs ; mentionnons, entre autres : une réticence idéologique à accepter de considérer la façon dont la nouvelle question sociale est traversée par les question de corps, de genre et de race, un manque d’expérimentation des services techniques des collectivités rétifs ou démunis pour incorporer ces questions dans leurs propres pratiques (Delarc, 2018), ou, encore, une large domination masculine persistante dans les sphères directionnelles des principaux réseaux professionnels – à ce jour moins d’une dizaine de femmes directrices sur les 50 agences d’urbanisme françaises, par exemple. C’est un des sujets, mais non le seul de ce imposant ouvrage sur « Les sens de la ville » dirigé par Corinne Luxembourg, Damien Labruyère et Emmanuelle Faure, articulant plus de 25 contributions autour de thèmes complémentaires : « Entendre et observer » (portant davantage sur des enjeux de méthodes), « vivre et pratiquer la ville » (éclairant certains rapports à la ville), « Jouer » (autour des enjeux de la création autant que du sport entre autres), « Dessiner » (posant les défis de cartographies participatives, mentales….) et « Fabriquer » (explorant les perspectives du projet d’urbanisme ou d’architecture).
Malgré une récente montée en puissance, les recherches portant sur les différentes façons concrètes d’agir sur les inégalités de genre et les formes variées de domination en milieu urbain restent encore marginales dans le champ de l’urbanisme, de ses débats théoriques et scientifiques autant que dans le cadre des univers techniques et professionnels de la conception urbaine. Ce n’est pas une nouveauté que de relever la difficulté persistante des questions d’inclusion sociale à se frayer une véritable place aux côtés de celles largement dominantes des logiques de valorisation économiques et foncières d’opérations immobilières ou de production d’infrastructures. Cette situation peut s’interpréter au croisement de plusieurs facteurs ; mentionnons, entre autres : une réticence idéologique à accepter de considérer la façon dont la nouvelle question sociale est traversée par les question de corps, de genre et de race, un manque d’expérimentation des services techniques des collectivités rétifs ou démunis pour incorporer ces questions dans leurs propres pratiques (Delarc, 2018), ou, encore, une large domination masculine persistante dans les sphères directionnelles des principaux réseaux professionnels – à ce jour moins d’une dizaine de femmes directrices sur les 50 agences d’urbanisme françaises, par exemple. C’est un des sujets, mais non le seul de ce imposant ouvrage sur « Les sens de la ville » dirigé par Corinne Luxembourg, Damien Labruyère et Emmanuelle Faure, articulant plus de 25 contributions autour de thèmes complémentaires : « Entendre et observer » (portant davantage sur des enjeux de méthodes), « vivre et pratiquer la ville » (éclairant certains rapports à la ville), « Jouer » (autour des enjeux de la création autant que du sport entre autres), « Dessiner » (posant les défis de cartographies participatives, mentales….) et « Fabriquer » (explorant les perspectives du projet d’urbanisme ou d’architecture).
–
L’enquête, mode d’action sur les inégalités
Le travail de recherche-action de cette publication collective à l’issue de six années d’investissement de terrain sur la commune de Gennevilliers en région parisienne en France, second volet éditorial d’une étude de longue haleine portant sur le genre de la ville (Mizzulinich, 2019), est exceptionnel à plusieurs titres. L’équipe de recherche y a posé un double pari, peu évident à tenir. Le premier est d’incorporer de façon productive l’hétérogénéité des démarches, des statuts, des postures, des angles d’approche et des méthodologies autour de ce sujet complexe. Agrégeant un collectif dans toute sa pluralité de géographes, d’artistes, de sociologues, d’anthropologues ou encore d’architectes, cette recherche loin d’être monolithique, s’est déployée sur le territoire de cette commune à travers des performances artistiques, des ateliers d’écritures, des cartographies participatives, des entretiens, des balades nocturnes, pour constituer une vaste enquête proliférante et multi-dialogique. Cette pratique d’association (artistes, chercheur.e.s praticien.ne.s) n’est jamais simple, elle n’évite d’ailleurs pas toujours au long de l’ouvrage parfois l’écueil de la juxtaposition et de la dissymétrie des récits et contributions, ainsi que la difficulté à restituer dans l’écriture brute des formes d’expérience sensible (théâtrale) et de partage. Pourtant, elle dépasse et incorpore cette hétérogénéité qui lui est constitutive avec une remarquable efficacité grâce à une posture commune aux membres de l’équipe : une réflexivité et une prise de recul critique soutenues et constantes, unanimement partagées, qui font de l’ouvrage une véritable matière à penser, à déconstruire et déranger un certain nombre de cadres, de politiques publiques autant que de stéréotypes de genre. Leur motif commun, déclencheur de recherche, est celui des souffrances et injustices spatiales multiples vécues par les femmes et d’autres à travers l’espace public autant que l’espace domestique, des espaces vecteurs non d’émancipation mais d’exclusions nombreuses, de formes d’oppression culturelle et de dominations implicites ou explicites. La recherche opte ainsi pour des sciences sociales engagées ayant pour seule visée de contribuer à que chacun.e puisse trouver « une juste place » (p. 70) en milieu urbain, d’où le recours également maïeutique, libératoire, exutoire, et parfois jubilatoire, aux jeux, dessins, écritures, théâtres. Il fallait mobiliser une très forte énergie collective pour surmonter les obstacles multiples d’une recherche aussi engagée physiquement et émotionnellement : les régulières incompréhensions habitantes, les distances voire hostilités de cloisonnements des territoires de légitimités professionnelles, les formes de condescendance et, bien sûr, des rapports de genre et formes d’exclusion omniprésents, incorporés et mises à jour. Une mise à jour elle-même difficile à aboutir tant certaines formes d’oppression et de domination dans l’espace urbain conduisent les femmes qui les subissent à un évitement du sujet, à la résignation. D’autres voies d’enquêtes et d’action sont alors à explorer, comme les pratiques ludiques, abordées à travers un vaste chapitre (« Jouer »). En cela, cet ouvrage est déjà par lui-même un puissant mode d’emploi et un guide de précautions, de réflexion méthodologique pour qui souhaite s’engager dans ce type d’enquêtes et de travail.
Le deuxième parti pris est rigoureusement scientifique, quoique pour autant pas si légitime, loin s’en faut, dans le milieu académique. L’équipe, le collectif, a résolument ancré son épistémologie dans un pragmatisme revendiqué de façon limpide : l’enquête, saisie comme forme horizontale de construction de connaissances et comme mode d’action visant à transformer le monde au sein duquel sont produites ces connaissances. Cette double épistémologie empruntant à Dewey et aux théories de la recherche-action (Hugues Bazin, cité par C. Luxembourg) fait de la recherche scientifique et de l’activité de production de connaissances une performance, c’est-à-dire à la fois transformation du monde et la création d’une forme d’expérience partageable à rebours de toute posture de surplomb et parti pris théorique initial. Ce point est ici important : les auteur.e.s ne se revendiquent d’aucun champ théorique déterminé au préalable, d’inscriptions théoriques dont on sait qu’elles sont par ailleurs sujettes à riches débats voire divergences, pour plus modestement opter pour une recherche activiste – et féministe ! Plus ou moins explicitement les contributions s’écartent également de ce qu’elles peuvent, pour certaines, mentionner comme un risque épistémologique d’un prisme exclusif des études de genres qui pourrait être trop réducteur. C’est ce qui leur permet alors de travailler sur les recoupements et les redoublements de plusieurs formes de domination et d’exclusion, comme par exemple être femme et célibataire avec enfant à charge à faibles revenus dans un écoquartier à Rennes, ou être migrant.e.s et subissant des oppressions liées à l’orientation sexuelle. Cette indétermination dans l’objet même de la recherche, certes, orientée initialement nettement sur la condition des femmes à Gennevilliers, permet au travail, de façon habile, d’aborder beaucoup plus largement et sans véritablement la nommer sauf dans le cadre d’une ou deux contributions, la capacité inclusive de la ville. Une notion de « ville inclusive » que l’on sait revendiquée (Hancook et Lieber, 2017) mais aussi discutée dans le champ scientifique pour sa réelle portée voire ses effets neutralisants (Clément et Valageas, 2017) d’où des contributions complémentaires à la recherche sur Gennevilliers portant sur le vieillissement, les territoires rassurants des pratiques sportives ou les structures d’hébergement temporaire.
Au-delà de ce fort intérêt d’ordre méthodologique et « praxique », les apports globaux de cet ouvrage peuvent être relevés autour de quatre enjeux de réflexion : la complexité et l’imbrication des dominations à l’œuvre dans les usages et pratiques de la ville, les voies porteuses d’émancipation, les leçons de certains échecs de performances publiques, et limites d’une possible inflexion de l’urbanisme par le genre.
–
Urbaniser, davantage, le genre
Infléchissons, provisoirement l’adhésion de la lecture pour ouvrir une controverse. Dispose-t-on, au terme de l’ouvrage, de voies nouvelles pour réformer l’urbanisme saisi au prisme du genre ? Les éléments de dialogues, avec les élu.e.s (deux contributions) restent sur ce plan il est vrai relativement convenus et moindrement instructifs, sinon révélateurs quant aux marges d’action étroites des édiles ou cantonnées à de timides explorations notamment dans le cadre de politiques culturelles et sportives visant à agir sur les inégalités de genre. Les contributions de la cinquième et dernière partie de l’ouvrage maintiennent elles-mêmes timidement le travail en deçà des enjeux attendus de conception urbaine. Pour comprendre ce relatif manque, la lecture du puissant texte de Dolores Hayden traduit pour le premier ouvrage (La ville : quel genre ?) est éclairante. Dans ce texte, qui n’a rien perdu d’actualité quarante ans plus tard et qui a inspiré plusieurs auteur.e.s de l’ouvrage, celle-ci rappelle la façon dont la conception de la ville par le courant moderne a joué puissamment sur l’accentuation des inégalités de genre en milieu urbain. Hayden y invite à déconstruire et identifier les stéréotypes implicites portés par les politiques de programmation du logement et de l’habitat. Elle y souligne l’importance de la justice économique et environnementale pour les femmes dépassant les divisions sexuées des tâches, et la domination de la « ménagère ». Avec la séparation de la suburbia des espaces (zones) de travail et d’activité, la ville moderne a assigné les femmes dans des identités et des rôles spécifiés, a produit l’univers domestique et ses accessoires de consommation obligé, comme espace d’enfermement cognitif et spatial, comme le rappelle à plusieurs reprises Corinne Luxembourg, co-auteure de l’ouvrage. Mais si D. Hayden affirme aussi tout un programme en indiquant « je pense que s’attaquer à la division conventionnelle entre public et l’espace privé doit devenir une priorité socialiste et féministe dans les années 1980 », elle échoua de notre point de vue dans ses propositions de subversion féministe du modèle, du fait de cantonner exclusivement le travail de l’urbanisme à une réflexion sur l’espace du logement, autour des communautés sociales et des expérimentations que celles-ci peuvent porter quant à la programmation de l’habitat. Ce faisant, l’approche reste en deçà d’une réforme de conception de l’ensemble des autres espèces d’espaces propres aux mondes urbains où se déroulent majoritairement l’expérience quotidienne (autre clé d’entrée de l’ouvrage) : culturels, commerciaux, ludiques, récréatif, mobilitaires etc., sur les logiques compartimentées et hétéronormées à l’œuvre à travers leur conception et leurs formes dominantes de pratiques, malgré d’apparentes inflexions en termes de mixité programmatiques ou de normes nouvelles d’accessibilité, par exemple.
C’est ce même cantonnement aux espaces résidentiels de l’habitat et de leurs environnements proches (parc, espaces collectifs…) qu’adoptent les réflexions de conception proposées par plusieurs contributions de la cinquième partie (« Fabriquer »). Aux côtés des intéressantes « propositions paysagères » (SensOmoto et C. Luxembourg) qui convergent avec d’autres textes sur l’importance d’agir sur les espaces partagés, les parvis, les lieux où les femmes peuvent se poser et s’exposer, les autres propositions de scénarios d’architectes portant sur une rue (P. Rivain) ou sur le chantier comme moment d’empowerment (T. Morlé Devès, C. Pujet), toutes expriment à leur manière l’approche d’un urbanisme correctif plutôt que transformant en profondeur. Faut-il peut-être en tirer que la portée de l’urbanisme ne peut-être que limitée sur les formes de domination prégnantes au cœur des pratiques des espaces urbains : si l’urbanisme peut agir sur l’expérience voire la pratique de la ville, il ne peut que très peu, voire pas, intervenir sur la condition des femmes en ville et un certain nombre de facteurs structurels autant que de dominations ordinaires.
–
De quelques dominations ordinaires dans la ville contemporaine
Héritage de la ville conçue par le modernisme, et de sociétés patriarcales, les inégalités de genre s’expriment fortement au sein des rapports de conjugalité, démontre Marion Tillous, géographe, exposant de façon précise la multiplicité des formes de contrôle spatial et les mécanismes des rapports de domination qui sont à l’œuvre dans le cadre des couples hétéronormés. Cette inégalité se traduit d’abord, souligne-t-elle, dans les « mobility of care » auxquelles les femmes se retrouvent largement contraintes et assignées (transports des enfants, visites médicales…). M. Tillous pose l’hypothèse que les dynamiques propres à la conjugalité produisent un contrôle spatial de manière ordinaire engagé par le conjoint à travers les registres de la jalousie, de la protection supposée et de l’identification. S’appuyant sur le travail de Jacqueline Coutras et Jeanne Fagnani sur les effet des rapports conjugaux sur les mobilités des femmes employées, la géographe identifie quatre formes marquées de contrôle spatial et de domination s’exerçant sur la mobilité des femmes : par connaissance (par le partenaire, des mobilités de sa conjointe), par redéfinition (le partenaire a son mot à dire sur ces mobilités et tente de les modifier), par encadrement (accompagnement de la partenaire dans son déplacement) et par limitation (refus de certaines mobilités). Un redoublement de ces formes de contrôle est intervenu avec l’introduction et la généralisation des TIC, avec un impact direct sur ces pratiques spatiales.
Une autre forme de domination, mise à jour par Anastasia Meidani (sociologue), s’immisce à travers le vieillissement, longtemps resté un parent pauvre de la recherche urbaine, constate-t-elle. La ville produit une ségrégation spatiale des corps âgés (p. 64) car les personnes âgées font l’objet de mécanismes d’invisibilisation, d’a-sexuation, et de réclusion dans la sphère domestique voire d’assignation à domicile. Le vieillissement urbain est un phénomène complexe, instable temporellement et spatialement, non limité au vieillissement des centres-villes et d’espaces spécifiques. Or, au delà de politiques publiques excessivement actives sur la problématique médiatique de la mixité intergénérationnelle (autre question réductive de l’habitat), la ville poursuit inexorablement sa lente mais méthodique disqualification des corps âgés. Les corps performants, sportifs, agiles, dominent et clivent les espaces publics entre jeunisme (performance et accélération) et âgisme car les villes sont conçues, certes, d’abord pour les hommes, mais aussi pour les jeunes et ceux qui sont rapides. En s’additionnant à la sortie des routines imposées par le travail, elles conduisent, démontre-t-elle, sur la base entre autres d’une enquête réalisée à Toulouse, à une réfraction des espaces quotidiens pratiqués autour de « bouts de ville » bien connus et circonscrits en substitution à des usages globaux de l’espace. Face à cela, les politiques engagées effacent par des approches et catégories homogénéisantes (« ainé.e.s », « seniors »…) la diversité forte des situations et du vécu des dominations (comme le genre, la classe sociale, l’âge et la génération, l’appartenance etno-raciale, socio-culturelle et l’état de santé…), et conduisent à considérer que par essence, la personne âgée est victime, handicapée (réductionnisme qu’il importe de réfuter), jamais subissant davantage un rapport de domination.
En complément de ce croisement des formes complexes de domination, l’urbaniste François Valagéas démontre comment les standards des écoquartiers produisent également des effets ségrégatifs, et la normalisation des pratiques qu’ils portent, exerce, elle aussi, des formes de domination. Il y a analysé l’imbrication de plusieurs rapports de domination, en l’occurrence rapport de genre et d’inégalités sociales, notant que « les enjeux de rapports de genre sont largement absents des démarches locales de mise en œuvre de la ville durable » (p. 295). Trois facteurs expliquent ce constat : une dominance masculine dans les instances de décision et de conception, une forte homogénéité dans les expériences d’écoquartiers, appuyées sur des standards dans lesquels dominent surtout les impératifs de bonne gestion, mais aussi en raison de la façon dont les espaces sont conçus pour encadrer les pratiques (en interdire certaines ou en inciter d’autres jugées vertueuses, telles les approches normatives d’éco-citoyenneté). Cette saturation normative à l’œuvre dans les écoquartiers en quête de rationalisation technique des gestions et des usages, conduit à l’éviction de questions comme le genre, et la diversité des pratiques et origines culturelles, ce qui rejoint les travaux de Matthieu Adam (2016). Habiter un écoquartier se transforme en épreuve d’exclusion lorsque inégalité de genre et inégalité sociale se croisent : être femme célibataire avec enfant, c’est aussi se retrouver évincée des parcs publics lorsque leurs éclairages sont supprimés le soir en vue de réduire la pollution nocturne (ignorant des attentes de sécurisation des femmes). Ou, également, être confrontées à l’évolution d’espaces initialement ouverts et partagés, et qui se referment avec exclusion des enfants et des femmes les ayant en charge, dont les pratiques sont reportées ailleurs et de façon plus lointaine en raison de conflits de coexistence qu’elles subissent (voir plus loin la contribution de François Valageas). Enfin, est aussi mis à jour un décalage entre technicisation poussée de la gestion des espaces, notamment liée aux objectifs visés de réduction des consommations, et détournements engagés par les habitants, en particulier les femmes, que ces dispositifs techniques importunent et limitent (pour faire sécher le linge, par exemple), révélant la saturation de rapports de domination normatifs et genrés qui traversent cette forme sublimée par les urbanistes, des écoquartiers.
–
Produire des connaissances par des performances critiques dans l’espace public
Différentes voies d’action ont alors été explorées par cette recherche, avec un fort recours aux performances et méthodes dérivées de certaines disciplines (cartographies sensibles…). Leur bilan conduit à une nouvelle déconstruction désenchantée des dispositifs technico-administratifs de l’engagement de la politique de la ville autant que du recours à ce type d’action. Les enquêtrices ont dû faire face à des conflits de légitimités, des difficultés d’accès aux « jeunes », des postures de fermeture de certaines structures d’action sociale, compartimentant et verrouillant l’accès à des « publics », mais aussi construire de l’action sur la base de dispositifs d’enquêtes porteur de l’image de l’institution, comme les roulottes des procédures de concertation. Il y a, dans ce travail, beaucoup d’échec narrés instructifs sur les errements persistants de la Politique de la ville en France, canal obligé de soutien à des formes d’action culturelle, des échecs en cours d’action lié au non-investissement ciblé de la municipalité sur un territoire ou à un micro-conflit politique conduisant à ce qu’une performance soit possible sur un site et impossible dans un autre secteur de la commune.
Agathe Dumont, Fanny Gayard et Rosé Guégan restituent les déboires de la réponse à un appel à projet finançant une compagnie de théâtre : pas de participant.e.s, un cadre politique (trop) balisé, et interrogent : « dans quelles mesures ces cases administratives visant initialement à soutenir des projets émancipateurs, peuvent-elles devenir des carcans normatifs et limitatifs ? » et participer d’un « fantasme républicain concernant le rôle de l’artiste et de l’action artistique en direction de publics bénéficiaires ciblés, les personnes les plus pauvres dans les territoires les plus populaires de la ville » (p. 128). Elles soulignent comment ce type d’appel à projet conduit à assigner des identités à des publics en décalage avec la façon dont elles les perçoivent elles-mêmes en tant qu’artiste et dont ces publics se perçoivent eux-mêmes, comme cela a pu être montré par ailleurs (Auclair, 2011). Elles doivent faire face au mépris de classe visant « les jeunes » estimés a priori pas intéressés et peu accessibles ou pour lesquels certains personnels administratifs défendent vigoureusement leur légitimité d’être les portes d’accès. L’accès cognitif aux « quartiers », est verrouillé par des représentations incorporées sur les hommes (nécessairement pas intéressés au théâtre), et doit se confronter aux conseils condescendants sur la façon d’aborder ces secteurs en tant que femme. L’expérimentation devient une forme de maïeutique révélant le rapport au quotidien des femmes rencontrées et finalement, cette expérience, qualifiée « d’errance en territoire culturel » (p. 126) restera le « point de départ pour repenser l’enjeu des corps, des circulations et de présences en ville » (p. 148).
L’action chorégraphique engagée par Marlène Lieber, Annick Charlot et Min Tang est différente, partant du souhait de déconstruire les connaissances théoriques produites par les universitaires sur les pratiques et usages genrés de l’espace, « exposés et formulées selon les carcans usuels des disciplines dans lesquelles elles s’inscrivent » (p. 153), mais peu à même d’être en capacité de transformer. Sur la base d’expériences menées par l’atelier d’hybridation anthropologique (AHA) à Bruxelles ou le POLAU de Tours, leur proposition est d’engager des formes d’expérimentations concrètes de ces connaissances, des performances telles que l’insulte inversée (remarques ouvertes de femmes sur le physique d’hommes dans la rue) ou des postures provocantes d’investissement de bancs public qui questionne la violence genrée quotidienne des rapports femmes/hommes dans l’espace public. Une forme d’intervention dans et par l’espace publique que questionnent différemment plusieurs autres contributions, comme celle de Chloé Mercier sur les carnets de voyage et la cartographie sensible, lui donnant une portée précise et singulière. En effet, l’objectif de ces performances est moins d’entrer en lutte politique et inverser des rapports de domination ou encore d’« avoir à prouver quoique ce soit, ou performer les places et rôles sociaux qui nous contraignent déjà » (p. 59). Il s’agit plutôt, à travers l’opportunité du projet, de pouvoir ne serait-ce que « profiter de cet environnement bienveillant » mis en place par la performance artistique.
–
Quelles possibles formes d’émancipation ?
À travers l’ouvrage, différents contextes apparaissent dès lors propices à de possibles formes d’émancipation. Les deux premiers sont régulièrement étudiés. Il s’agit d’abord des pratiques d’agriculture urbaine, décrites par Angélique Dupont, Emmanuelle Faure et Corinne Luxembourg. Les jardins pouvant constituer des lieux de renversement des stéréotypes de genre et de résistance, même s’il resterait à nuancer cette appréciation au regard de leur localisation géographique dans une métropole et suivant les contextes culturels (Robert-Bœuf, 2019). Puis, en termes de mobilité, du vélo, sujet traité par Emmanuelle Faure et Sylvie Coupleux sur la base d’enquêtes comparées à Gennevilliers et Bordeaux, démontrant comment le vélo, malgré les inégalités qui en traversent encore largement l’usage, est un véritable vecteur d’émancipation et d’inclusion sociale. Cette enquête sur la mobilité permet de mieux restituer l’importance majeure du corps dans l’intervention sur les discriminations et les formes de domination. L’activité physique et le sport restent les activités où se sont construites le plus les partitions de genre comme le souligne dans une longue contribution Antoine Le Blanc. Celui-ci expose un important travail portant sur les safes spaces, sur la production des espaces communautaires porté par le projet des associations sportives LGBT et qui existent dans une tension entre ouverture, indifférenciation des genres de pratiquant.e.s, et fermeture sur une forme de repli protecteur, réponse explorée face à un vécu de marginalisation (p. 172). Ces safes spaces ne sont pas en soi militants, mais visent également à créer des formes spatiales de « bienveillance ». Le sociologue Igor Martinache développe quant à lui les axes de travail de dégenrisation du sport, autour de deux vecteurs indirects : le sport santé et la non-mixité dans la pratique sportive permettant d’affranchir des regards chosifiant, la non-mixité étant vectrice de création de solidarité, de sociabilité, de sérénité et plus largement concevable comme « un moment de l’émancipation » (p. 220).
Jeux, bienveillance, rassurance, c’est peut-être finalement l’une des leçons les plus importantes de ce travail remarquable à laquelle l’ensemble de son équipe de recherche pourrait inviter : créer dans la ville une infinité d’opportunités de mise en suspension des inégalités et rapports de domination sous-jacents, une pluralité de conditions partagées de bienveillance. Tout un programme d’urbanisme et de militantisme scientifique très proche de celui prôné par Silvia Federici : « le principe du militantisme joyeux, c’est que les politiques que nous mettons en place sont libératrices si elles changent notre vie d’une manière positive, nous font grandir, nous rendent joyeux, sinon, c’est que quelque chose ne marche pas. » (Federici, 2021).
MARC DUMONT
—
Marc Dumont est professeur en urbanisme et aménagement de l’espace à l’Université de Lille, membre du laboratoire Territoires Villes, Environnement et Sociétés (TVES). Ses travaux portent sur les politiques territoriales et la géographie sociale des périphéries urbaines.
marc.dumont@univ-lille.fr
–
Références de l’ouvrage : Luxembourg C., Labruyère D. et Faure E. (dir.), 2020, Les sens de la ville, Pour un urbanisme de la vie quotidienne, Le Temps des Cerises, 512 p.
–
Couverture : La place des Arts à Montréal (M. Dumont, 2018)
–
Bibliographie
Adam M., 2016, La production de l’urbain durable. L’enrôlement des concepteurs et des habitants par l’intégration des contradictions, Thèse en géographie, Université François-Rabelais de Tours, 545 p.
Auclair E., 2011, « Les ambiguïtés des projets artistiques et culturels dans les PRU. Entre finalité sociale et finalité urbaine », Les Cahiers du Développement Social Urbain, 2011/2 (n° 54), 29-30.
Delarc M., 2018, Une immersion dans le projet ”Réinventons nos places” à Paris (Places des Fêtes, de la Nation et de la Bastille) : une analyse de situations de travail et de productions de connaissances au sein des services de la Ville de Paris, Thèse en Géographie. Université Paris-Est, 463 p.
Federici S., 2021, « Notre corps est un réservoir de savoir-faire, de résistances », entretien avec Valentine Faure, Le Monde, 18 juillet 2021, p. 30
Garance C. et Valageas F., 2017, « De quoi la “ville inclusive” est-elle le nom ? Exploration d’un concept émergent à partir de discours scientifiques et opérationnels », Métropoles, 20 | 2017, en ligne.
Hancock C. et Lieber M., 2017, « Refuser le faux dilemme entre antisexisme et antiracisme. Penser la ville inclusive », Les Annales de la recherche urbaine, n°112, 16-25.
Mizzulinich A., 2019, « Lu / La ville : quel genre ? L’espace public à l’épreuve du genre », Urbanités, en ligne.
Robert-Bœuf C., 2019, Les jardins collectifs : entre urbanisation de la campagne et agrarisation de la ville : mise en regard de l’Ile-de-France et de Kazan, Thèse de doctorat, Université Paris Nanterre.
–
Pour citer cet article : Dumont M., 2021, « Lu / Les sens de la ville, Corinne Luxembourg, Damien Labruyère et Emmanuelle Faure », Urbanités, octobre 2021, en ligne.
–
–