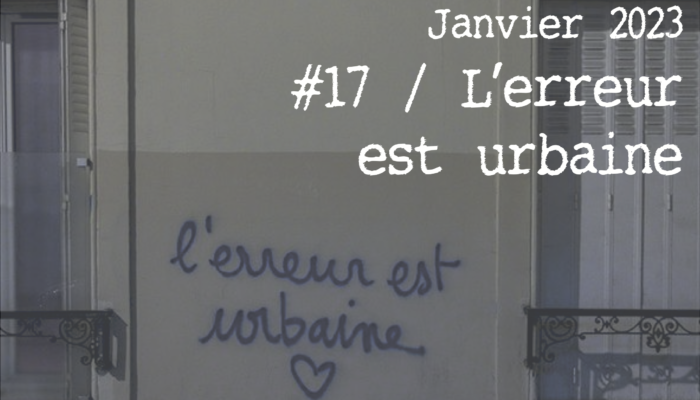Edito #16 / À l’école de la ville
Marine Duc et Camille Vergnaud
PDF de l’édito / Citer cet édito / Sommaire du numéro
Introduction : Polarisation sociale et inégalités scolaires au prisme de l’urbain
L’appel à articles pour le numéro #16 d’Urbanités, intitulé « À l’école de la ville » invitait à étudier la dimension spatiale des inégalités socio-scolaires par le prisme de l’articulation entre contextes urbains et systèmes éducatifs.
Les articles réunis ici se sont emparés de cette thématique avec une approche souvent commune : interroger les relations réciproques entre ségrégation urbaine et accès à l’éducation. Plusieurs contributions décrivent ainsi l’articulation entre des dynamiques spatiales de polarisation sociale (qualifiées de ségrégations, inégalités, polarités, fractures) et la fréquentation des établissements à l’échelle intra-urbaine, par exemple à Lille, Toulouse ou Marseille, ou encore Atlanta. La carte scolaire – et ses contournements ou modifications – tient une place importante dans ces liens entre ségrégation urbaine et inégalités scolaires, comme le montrent l’expérimentation de réaffectation d’élèves hors de leur secteur résidentiel initial à Toulouse pour lutter contre la ségrégation scolaire (Étienne Butzbach et Choukri Ben Ayed), ou bien le changement de périmètre de sectorisation d’une nouvelle école pour en réserver l’accès à des catégories sociales favorisées dans le cadre du projet Euroméditerranée à Marseille (Gwenaëlle Audren et Aude-Line Gervais). De même, le rôle des mobilités résidentielles est particulièrement mis en lumière à l’échelle du numéro, favorisant des logiques d’entre-soi comme présenté par Alexis Alamel concernant le processus de studentification à Lille, participant à une homogénéisation sociale du public étudiant par recrutement de proximité dans l’exemple de l’Université du Mans (Pauline Collet), ou encore contribuant à une autre échelle à une polarisation sociale universitaire entre académies comme explicité dans le portfolio de Victor Chareyon, Hugo Harari-Kermadec et Gilles Martinet.
Les contributions du numéro présentent également le point commun d’une attention particulière portée aux objectifs et modalités de l’action publique en matière d’éducation. Certaines contributions en font leur objet d’analyse principal, en étudiant les objectifs, les conditions de mise en œuvre, et les effets de projets ou de politiques d’action publique dans le domaine éducatif. C’est la démarche opérée par Étienne Butzbach et Choukri Ben Ayed qui ont été sollicités par le département de la Haute-Garonne pour accompagner un dispositif expérimental de mixité sociale dans les collèges toulousains. Cette démarche de mise en regard entre les objectifs annoncés de politiques publiques et leurs effets est également appliquée à deux grands projets urbains et éducatifs portés en partie par l’État. Etudiant la création du campus Condorcet au sud de la Plaine-Saint-Denis, Antoine Gosnet, Beatriz Fernandez et Marie-Vic Ozouf-Marignier mettent en question les tensions entre la volonté affichée d’ouverture de l’établissement et son insertion locale, vu l’offre de formation proposée et la présence voire le renforcement de discontinuités urbaines. L’objectif de mixité sociale, porté par le volet éducatif du projet de renouvellement urbain des quartiers Euroméditerranée à Marseille, est lui aussi soumis à une analyse critique, montrant une « montée en gamme » élitiste renforçant des « logiques concurrentielles et hiérarchie scolaire » et contribuant à « un espace scolaire fragmenté et contesté » (Gwenaëlle Audren et Aude-Line Gervais).
Ces deux angles d’approches amènent donc à décrypter la production ou le renforcement d’inégalités éducatives au prisme des relations entre contextes urbains et systèmes scolaires ou universitaires à différentes échelles, et à interroger le rôle attribué à l’école dans et pour la ville dans le cadre d’une action publique dont les acteurs, modalités et objectifs se transforment.
–
Territorialisations de l’école en question
Les articles présentés dans le numéro donnent à voir la territorialisation des politiques publiques éducatives en France, mise en œuvre depuis les années 1980 dans le cadre général de la décentralisation et des transferts de compétences associés. L’analyse par les jeux d’acteurs permet de mettre en évidence la diversification des acteurs publics, que ce soit l’État et ses services déconcentrés sectoriels (via le rectorat notamment) ou les collectivités locales (communes, département, régions et intercommunalités). Le rôle moteur du département de Haute-Garonne dans la conception et la mise en œuvre du dispositif de mixité au collège à Toulouse en est par exemple représentatif. Dans le champ de l’enseignement supérieur, cette territorialisation se manifeste par une implication croissante des régions (notamment via les contrats de plans État-Région) et des communes (et intercommunalités). À ce titre, la comparaison des acteurs parties prenantes dans la construction de nouveaux campus, dans le cas de Toulouse dans les années 1960 – 1970 (article de Pauline Collet) et de Condorcet à la Plaine Saint-Denis dans les années 2000 et 2010 (article d’Antoine Gosnet, Beatriz Fernández et Marie-Vic Ozouf-Marignier) montre la reconfiguration de la place de l’État dans le pilotage universitaire et la montée en puissance des collectivités territoriales et des établissements comme acteurs des projets urbains et éducatifs. Cette logique de territorialisation correspond à la volonté d’adapter des politiques sectorielles nationales aux spécificités territoriales locales. Les études de cas présentées confirment la pertinence d’une analyse localisée des enjeux éducatifs pour comprendre ou agir sur les inégalités scolaires. Ainsi, les autrices de l’article « À Marseille, la construction d’une polarité éducative haut de gamme au service du renouvellement urbain » rappellent en introduction la spécificité de cette ville, où contrairement à d’autres métropoles régionales françaises, notamment Paris et Lyon, le centre-ville demeure populaire. De même, l’expérimentation de réaffectation d’élèves en dehors de leur secteur scolaire à Toulouse s’appuie sur une adaptation aux spécificités du contexte local, que ce soit l’organisation urbaine de la ville ou les pratiques et représentations des familles dans leur espace-vécu, notamment en termes de mobilité.
Cette logique de territorialisation des politiques éducatives ainsi que la forte corrélation entre géographie résidentielle et fréquentation des établissements peuvent conduire à vouloir résoudre ces inégalités en modifiant leur contexte territorial, ici urbain. Cette « conception externalisante de la ségrégation scolaire » d’après les termes de Choukri Ben Ayed consiste alors à considérer que les causes de cette ségrégation sont à rechercher en dehors de l’institution scolaire (pratiques d’évitement scolaire des familles, ségrégation urbaine par exemple). Cela aboutit, d’après l’auteur, à une « perspective fataliste » et une « inertie qui a longtemps caractérisé le système éducatif [français] en la matière ». Focaliser l’analyse sur une transformation du contexte territorial, de manière mono-scalaire, présente aussi le risque de masquer d’autres mécanismes structuraux qui produisent les inégalités (Frouillou, 2020). Axer une territorialisation des politiques éducatives sur un type de quartier, déterminé par un zonage de géographie prioritaire, amenuise la possibilité d’une analyse relationnelle entre, par exemple, espaces de relégation mais aussi espaces d’agrégation de populations les plus favorisées. De même, le territoire peut devenir le principal facteur en cause, invisibilisant la diversité des populations habitantes, et d’autres déterminants d’inégalités éducatives comme l’âge, le genre, l’assignation raciale, ou la position sociale. S’opère alors une réduction analytique des facteurs d’inégalités éducatives à un type de territoire (banlieues, quartiers populaires), participant alors à des processus de stigmatisation territoriale et laissant de côté des explications – et donc des possibilités d’action – d’autres ordres ou échelles. Ainsi, la création d’un « entre-soi résidentiel d’une population étudiante aisée » dans le quartier Vauban à Lille est à mettre en perspective avec un déséquilibre général entre l’offre de logement et le nombre d’étudiants en France depuis 1960, accentué par une « forte hausse récente des effectifs étudiants en France, équivalente à 26 % entre 2000 et 2019 » (Alexis Alamel). Cette analyse relationnelle et multiscalaire pour décrypter les enjeux éducatifs au sein d’un périmètre d’action publique est particulièrement mise en évidence dans le cas de quartiers populaires du centre de Marseille, dans lequel des éléments de micro-géographie (architecture de cour d’école, ségrégation à l’échelle d’une rue, etc.) sont tributaires de la création d’une cité scolaire internationale, elle-même produit éducatif d’appel dans le projet de renouvellement urbain Euroméditerranée.
La portée heuristique des jeux d’échelle permet enfin de mettre en lumière de nouvelles inégalités, en mettant en perspective différents niveaux d’analyse. Ce changement d’échelle d’analyse est mobilisé par Julie Tremoureux pour suggérer que si « l’ouverture d’une université de proximité au Mans a permis une démocratisation quantitative et qualitative de l’accès à l’enseignement supérieur en Sarthe », des polarisations sociales persistent à l’échelle infra des disciplines, voire se renforcent à l’échelle supra, puisque cette moyennisation du public du pôle manceau accentuerait alors une différenciation entre sites à l’échelle nationale participant à un « élitisme de la géographie universitaire » nuançant le processus de démocratisation qualitative repéré. Cette étude de cas fait particulièrement écho au portfolio proposé par Victor Chareyon, Hugo Harari-Kermadec et Gilles Martinet qui montre comment les mobilités étudiantes inter-académiques s’inscrivent dans un contexte général de croissance et de démocratisation étudiante mais contribuent aussi à renforcer les inégalités sociales entre des pôles urbains métropolitains et des universités de ville de rang inférieur. Cette perspective multiscalaire et relationnelle apparaît donc comme une démarche indispensable face à certains écueils de la territorialisation des politiques publiques – ici éducatives : se focaliser sur un quartier, homogénéisé et identifié à un type de territoire en laissant de côté des déterminants multiscalaires d’inégalités ; et laisser dans l’ombre une accentuation de différences dans et entre établissements, entre territoires d’action publique (communes, départements, régions), ou entre types de territoires à l’échelle régionale et nationale (urbain/rural/périurbain ; petites/moyennes/grandes villes par exemple).
–
Renforcement d’une visée instrumentale de l’école : produire une autre école pour transformer la ville ?
Dans ce numéro, de multiples registres discursifs sont mobilisés par les auteurs et autrices pour qualifier les mises en œuvre de l’action publique éducative en ville, tantôt évoquées sur le registre de l’inédit (par Choukri Ben Ayed et Etienne Butzbach), tantôt sur celui de l’expérimentation (Pauline Collet) ou de l’exceptionnalité (Beatriz Fernández, Antoine Gosnet et Marie-Vic Ozouf-Marignier). Ce renvoi à la nouveauté, à un écart à un fonctionnement normal de la territorialisation de l’action publique éducative soulève un certain nombre de questions. Est-ce qu’il s’agit de rendre compte d’une adaptation à des spécificités locales qui ne pourrait alors prendre que la forme d’une exception ? S’agit-il pour les acteurs territoriaux d’un même ressort commun de distinction, reprenant la rhétorique du marketing urbain ? À la lecture des contributions proposées, l’établissement, tant universitaire que scolaire, apparaît de plus en plus comme un produit d’appel au service d’un marketing urbain, et même la tête de pont à partir de laquelle impulser une transformation territoriale. Cette forme de territorialisation de l’école, ici sa place et sa fonction dans un territoire, donne à voir une nouvelle visée – instrumentale – de l’établissement scolaire. Après la tentation de changer le contexte urbain pour changer la ségrégation scolaire, voit-on la tentation de changer l’école pour changer la ville ?
Les articles qui forment ce numéro confirment que l’offre de services éducatifs, indépendamment de leur position dans la chaîne scolaire, est largement pensée comme un levier d’attractivité par différents acteurs, publics, para-publics, comme privés : les établissements sont de plus en plus pensés comme des aménités urbaines (Felouzis et al., 2013 ; Ben Ayed, 2015). Cet usage n’est pas nouveau. En France, il s’inscrit au croisement des principes directeurs de l’aménagement du territoire (développement et égalité territoriale) et des politiques éducatives de diffusion de l’instruction mais également de démocratisation de l’enseignement, visant l’égalisation des chances scolaires, indépendamment du lieu de résidence et du niveau scolaire considéré (Merle, 2010).
Mais certaines contributions proposées donnent à voir une transformation de ces logiques d’équipement du territoire national et d’attractivité démographique et économique via l’implantation ou le maintien d’une offre éducative. En effet, cet usage instrumental de l’école s’approfondit, s’étend et se recompose. Il s’approfondit dans la mesure où l’offre et l’équipement éducatifs sont envisagés comme les moteurs même d’une transformation territoriale : les objectifs recherchés excèdent de manière croissante les frontières du secteur éducatif. L’offre scolaire est alors envisagée comme un « objet d’attractivité » (Nora Nafaa), un instrument mis au service d’une transformation urbaine. À Atlanta, Nora Nafaa montre ainsi que l’école devient une « porte d’entrée dans les quartiers » afin de déployer un redéveloppement urbain s’appuyant sur un renouvellement immobilier et sur une offre de services variés visant à garder la population résidente : « l’école, par la maîtrise de son territoire scolaire, et plus largement éducatif étant donné la panoplie de services offerts, devient un outil de revitalisation du territoire urbain ». Considérer « l’offre scolaire de qualité » comme « un outil du redéveloppement local » se retrouve dans les stratégies de revitalisation urbaine dans le quartier d’Euroméditerranée à Marseille. Les objectifs recherchés de valorisation territoriale sont mobilisés par différents acteurs de l’urbain, en jouant sur plusieurs effets. D’une part, l’équipement éducatif est mobilisé via des effets symboliques, liés tant à la localisation qu’aux qualités associées à l’établissement lui-même, afin de faire valoir une image de marque pour la ville : c’est notamment ce qui est décrit dans la mise en œuvre d’un label d’excellence académique pour une citée internationale à Marseille dans l’article de Gwenaëlle Audren et Aude-Line Gervais, mais aussi du Campus Condorcet à Aubervilliers par Antoine Gosnet et ses collègues. De l’autre, il s’agit de tirer parti des caractéristiques associées aux publics. Cette dimension transparaît bien dans le processus de studentification touchant les quartiers centraux de Lille et analysé par Alexis Alamel. Les bailleurs privés ont cherché à s’emparer d’un segment du marché locatif du quartier Vauban, en tablant sur la composition sociale des publics du quartier : les étudiant·e·s plutôt bien doté·e·s de l’Université Catholique de Lille qui cherchent à se loger à proximité de leur lieu d’étude. L’auteur montre par ailleurs que cette visée instrumentale n’est pas forcément portée par l’établissement lui-même (ses opérateurs ou gestionnaires) mais qu’elle peut être recherchée par des acteurs connexes, ici les bailleurs privés et les agences immobilières.
Cet usage instrumental des établissements scolaires et universitaires s’inscrit plus largement dans différents volets des politiques de métropolisation, avec une référence croissante aux objectifs d’attractivité, de compétitivité et de visibilité internationale. À Marseille, la mise en œuvre du projet Euroméditerranée s’inscrit explicitement dans une volonté d’attirer la « classe créative » (Florida, 2002) métropolitaine pour renforcer l’internationalisation de la cité phocéenne, suivant ce que Michel Grossetti et Olivier Bouba-Olga ont appelé la « mythologie CAME (Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, Excellence) ». Cette expression désigne en effet la croyance en un impératif de compétitivité imposé par l’approfondissement de la mondialisation, qui ne serait réalisable qu’en encourageant la concentration des richesses dans quelques villes ou quartiers, têtes de pont pour favoriser leur excellence (Grossetti et Bouba-Olga, 2018). Cette « mythologie » imprègne également les politiques actuelles de pilotage universitaire en France, visant à renforcer la visibilité internationale, l’attractivité et la compétitivité des établissements par des politiques dites d’« excellence » (Vergnaud, à paraître). L’article d’Antoine Gosnet, Beatriz Fernandez et Marie-Vic Ozouf-Marignier revient sur ce jeu d’acteurs et cet usage instrumental du campus qui se compose à plusieurs échelles. À l’échelle locale, le campus cherche à répondre à la hausse des effectifs étudiants en région parisienne, mais il entend également faciliter le réaménagement du Sud de la Plaine-Saint-Denis. À l’échelle nationale, l’opération du Campus Condorcet correspond à la recherche de l’inscription du paysage universitaire français dans la géographie globalisée de la recherche et de l’enseignement supérieur. En cherchant à bénéficier d’un effet de cluster d’établissements pour agir sur leur visibilité dans les classements internationaux, et à « contribuer au rayonnement international du Grand Paris en fournissant des infrastructures scientifiques compétitives », il s’agit en effet de correspondre à certains « scripts » dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Musselin, 2008), présentés comme souhaitables à l’heure de l’économie de la connaissance.
Cette logique instrumentale s’approfondit, et elle s’étend également le long de la chaîne éducative jusqu’à l’école. En effet, le supérieur occupe une position particulière, puisque, dès l’époque moderne, les universités commencent à être envisagées comme des atouts du rayonnement des villes par les gouvernements urbains (Bourillon et al., 2018). Cette fonction d’attractivité a ensuite été intégrée à un objectif d’équilibre territorial porté à l’époque par l’État comme présenté par Julie Tremoureux concernant la création de l’université de proximité du Mans. Si l’implantation d’un campus est actuellement considérée par les acteurs urbains comme un facteur d’attractivité économique, à forte valeur symbolique et contribuant à une métropolisation recherchée, cette vision s’étend de plus en plus vers l’école élémentaire et secondaire, comme l’exemple de la cité-internationale à Marseille le montre.
Enfin cet usage instrumental se recompose dans ses modalités avec une multiplication des outils mobilisés (labels, classements…), et une diversification des acteurs. Précédemment prérogative des acteurs publics, en particulier de l’État, cette utilisation de l’équipement éducatif est investie par un nombre croissant d’acteurs publics et parapublics (élu·e·s et administrations locales, agences d’urbanisme, rectorats), privés (promoteurs et agences immobilières) mais également par les établissements eux-mêmes. Cette diversification d’acteurs dans la gestion des systèmes éducatifs s’appuie sur une évolution des dispositifs de gouvernance, (contractualisation, comités de suivi et autres arènes publiques mentionnées par Étienne Butzbach et Choukri Ben Ayed). Elle s’accompagne d’une montée en puissance de la logique de projet, à la fois comme principe porté par l’action éducative, et comme un mode d’action et d’implémentation de cette dernière. Elle se lit par exemple dans la mise en place de partenariats publics-privés, comme c’est le cas entre les différents acteurs impliqués dans le projet de renouvellement urbain d’Euroméditerranée : le rectorat d’Aix-Marseille, les collectivités territoriales, l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, et plusieurs acteurs privés, notamment la congrégation jésuite, chargée de la construction d’un nouveau collège. Cette implication croissante d’une multitude d’acteurs dans la mise en œuvre de l’action éducative exprime aussi en creux une forme de désengagement de l’État central, ou en tout cas, d’une modification de son engagement, dans l’aménagement urbain scolaire et universitaire.
Cette implication croissante du privé trouve, à l’échelle urbaine, les conditions de sa mise en œuvre. Cette privatisation s’effectue dans différentes sphères de la vie éducative : dans les montages financiers permettant la construction de nouveaux établissements publics, dans la gestion de ces derniers, dans le domaine paraéducatif comme le logement à destination des étudiant·e·s, ou encore, dans le développement de l’offre scolaire privée. Cette implication se fait cependant à des degrés divers selon les contextes nationaux. À ce titre, l’article de Nora Nafaa offre un contrepoint précieux de ce qui se joue en France. La compétition organisée par l’État fédéral entre les écoles publiques d’Atlanta permet de prendre la mesure des logiques de « dépossession des territoires éducatifs », autrement dit, de la dépossession de l’accès au service public scolaire, où « les familles n’ont plus le choix de l’école publique » : lorsque les performances scolaires sont jugées trop mauvaises, l’établissement est contraint à la fermeture, ou à sa transformation en charter school, des écoles publiques dont la gestion est déléguée à une organisation privée. Mis en regard avec la situation française, l’exemple d’Atlanta permet ainsi de prendre la mesure de l’état d’avancement du processus géographiquement différencié d’intégration aux logiques néolibérales.
L’échelle urbaine constitue alors une échelle et un contexte privilégiés pour observer la néolibéralisation des politiques scolaires. On entend par là l’ensemble de discours normatifs et de réformes conduites à différents niveaux dans un objectif de dérégulation, jointes à un processus de délégation des compétences de l’État à des organisations tierces, s’accompagnant souvent de la privatisation de services publics (Giband et al., 2020). Les articles du numéro offrent ainsi une perspective complémentaire à d’autres dossiers et numéros récents sur le sujet, qui constataient que les logiques de privatisation se faisaient d’abord sous l’impulsion de l’État, parfois en dialogue avec des organisations internationales (Giband et al., 2020). En effet, les auteurs et autrices de ce numéro #16 mettent l’accent sur l’absence de passivité des acteurs urbains dans ces logiques. Avec la modification de l’engagement étatique dans le jeu scolaire, ils se posent souvent en partenaires dans la conception, en relais dans la mise en œuvre, ou encore, en tant que force d’initiatives. Le constat de la recomposition de l’usage instrumental de l’école et de l’université invite à en questionner les effets. On pourrait en effet faire l’hypothèse, en reprenant le dyptique bourdieusien, qu’à la fonction sociale de reproduction et à la fonction technique de transmission (Bourdieu et Passeron, 1970) vient s’ajouter une troisième, une fonction instrumentale de gouvernement, qui pourrait dominer, transformer ou légitimer les autres fonctions du système scolaire.
–
Stratégies et responsabilités face à l’extension du marché et des fonctions de l’éducation
L’utilisation croissante de l’équipement scolaire et universitaire par des acteurs urbains, publics ou privés, au service d’objectifs non éducatifs, dans un contexte de néolibéralisation des politiques scolaires soulève des enjeux quant aux responsabilités concernant l’école.
Un premier questionnement relève des responsabilités attribuées à et/ou endossées par les établissements. Cela est particulièrement présent dans l’article de Nora Nafaa. Si l’école devient un outil de gouvernement parmi d’autres, alors il est plus aisé de lui associer d’autres missions, extérieures au champ scolaire. Les partenariats entre des gestionnaires privés et le district scolaire permettent « l’apport de davantage de ressources à l’école, mais également une gestion plus libre », et « affranchit de certaines régulations du district ». Le fonctionnement de l’établissement se rapproche dès lors d’un centre social, où se trouvent services juridiques ou services de santé par exemple. Pour Nora Nafaa, c’est justement l’apparition de ces nouveaux services dans des quartiers délaissés par l’action publique qui explique les faibles contestations face au développement des charter schools, montrant bien toute l’ambivalence de la néolibéralisation scolaire. Que ce soit à Atlanta ou à Marseille, la transformation de l’offre scolaire vise une revitalisation urbaine et une recomposition sociale de ces quartiers. La mise en évidence de possibles effets de gentrification pose également la question de la responsabilité à l’égard des inégalités scolaires territoriales : selon les échelles considérées, qui ou quel processus porte le souci de démocratisation de l’éducation et d’égalité territoriale d’accès à l’éducation ? Placer l’école en capacité de porter des aspirations urbaines (comme une attractivité métropolitaine, un renouvellement urbain, un projet immobilier) étend les responsabilités qu’on lui attribue, en tant qu’institution et à ses membres. Celleux-ci se retrouvent chargé·es de nouvelles tâches ; de nouveaux postes doivent être créés pour répondre à ces fonctions élargies (ce qui est particulièrement le cas dans les universités publiques françaises) ; et d’autres acteurs sont associés à l’implication urbaine des établissements, comme les organisations communautaires ou les fondations philanthropiques aux États-Unis. Cela est finement décrit par Nora Nafaa à Atlanta, qui montre la montée en puissance d’acteurs « publics qui ne sont pas ceux de l’administration scolaire (municipalités, agences de logement…), mais aussi privés et très diversifiés (fondations, associations, entreprises…) ».
Un deuxième enjeu présent dans les articles quant aux effets de cette fonction instrumentale de l’école dans et pour la ville est celui des stratégies ou tactiques déployées par les usagers et usagères des services éducatifs : élèves et étudiant·es mais aussi de manière croissante, les familles. Alexis Alamel souligne « le rôle primordial des parents pour obtenir un logement à la location » dans le quartier en tension immobilière de Vauban. À Marseille, la diversification de l’offre scolaire locale, entre établissements publics et privés, mais aussi au sein même de l’enseignement public (filières sélectives, bâti scolaire) renforce les inégalités scolaires. En effet cette offre scolaire, hiérarchisée, présente le risque de renforcer un espace scolaire ségrégué puisque « les familles les plus dotées en capital culturel et économique étant davantage en mesure de faire un choix et de mettre en place des stratégies ». À une autre échelle, Pauline Tremoureux montre que « le choix explicite de la proximité » est davantage mis en avant par les étudiant·es enfants d’ouvriers dans leur choix d’étude à l’université du Mans. La différence de capital mobilitaire entre classes sociales conditionne les choix et opportunités d’études supérieures, et les tactiques à disposition pour maintenir ou améliorer sa position sociale, ce que met en évidence le portfolio proposé par Victor Chareyon, Hugo Harari-Kermadec et Gilles Martinet. Les auteurs montrent ainsi que « parmi celles et ceux qui changent d’académie, les bachelier·es issu·es des classes supérieur·es sont proportionnellement plus nombreux·ses, alors que celles et ceux issu·es des classes populaires restent davantage dans leur académie », aboutissant à une polarisation sociale entre académies.
Dans cette perspective, il serait intéressant de poursuivre les réflexions sur l’articulation entre cet usage instrumental de l’école par des acteurs urbains et le renforcement d’inégalités et de disparités éducatives en mobilisant des travaux sur la montée en puissance d’acteurs et d’instruments pour se positionner dans ces marchés éducatifs. Il peut s’agir de la vente de services d’accompagnement à l’orientation, de cours particuliers, ou de formations complémentaires payantes, proposées par des acteurs privés mais aussi par les établissements publics eux-mêmes. Plus largement, l’ensemble des acteurs, instruments et valeurs permettant de créer, mesurer, diffuser des classements sur un principe de performance joue un rôle fort dans cette articulation entre stratégies urbaines et éducatives. Permettant de stabiliser des ordres de grandeur à des fins de classement des faits sociaux (Desrosières, 2016), la mesure est en effet de plus en plus convoquée comme technique de gouvernement. Cela apparaît notamment dans l’article de Nora Nafaa, où les tests standardisés de performance des élèves répondant à une logique d’accountability impulsée à l’échelle fédérale aux États-Unis, sont au cœur de la délégation de la gestion des établissements états-uniens vers le privé. Cette omniprésence de la mesure, parce qu’elle permet un recours croissant à l’évaluation, exprime les transformations contemporaines de systèmes éducatifs désormais pleinement insérés dans « l’économie de la connaissance » ou le « capitalisme cognitif » – selon les choix conceptuels opérés par les auteur·trices (King, 2009 ; Jarvis, 2014 ; Harari-Kermadec, 2019). Au-delà de classements, ce sont les acteurs, les outils et les marqueurs d’une hiérarchisation, formelle ou non, qui transparaissent. En témoignent les politiques d’excellence dans le secteur universitaire mentionnées par Victor Chareyon, Hugo Harari-Kermadec et Gilles Martinet, ou l’affichage d’un « label d’excellence académique » par la future cité scolaire internationale à Marseille.
Or, ces stratégies urbaines s’appuyant sur le secteur éducatif ne sont pas sans conséquence sur le contenu même des activités menées dans ces établissements scolaires et universitaires. Autrement dit, cette fonction instrumentale de l’école imprègnerait sa fonction de transmission : les conditions d’enseignement, ses acteurs et actrices (dont les enseignant·es) et les contenus et les modalités pédagogiques. Cet enjeu, mentionné par quelques articles, invite à aller voir les effets de ces dynamiques dans les établissements, dans les classes, ce qui constitue l’une des perspectives à ce numéro.
–
Entrer dans l’école, mesurer l’école : perspectives pour saisir la multiplicité des déterminants d’inégalités éducatives
L’établissement scolaire ou universitaire n’est pas un lieu clos hors-sol comme le rappellent des travaux récents (Clerc, 2020 ; Chevalier et Leininger-Frézal 2020a, 2020b). Ce qui se joue dans la salle de classe et plus largement dans la relation pédagogique est intimement façonné par les contextes urbains et les transformations spatialisées des systèmes éducatifs. Les articles du numéro abordent ponctuellement comment la transformation de la place de l’école et de l’université dans les stratégies urbaines contribue à changer aussi leurs fonctionnements, ainsi que les conditions concrètes de travail et le contenu des activités menées en leur sein. C’est ce qui est montré dans le cas de la cité scolaire internationale à Marseille : la « montée en gamme » visée s’exprime via des caractéristiques architecturales modifiant les conditions de travail et d’étude (qualité du bâti, architecte de renom, innovation environnementale). Mais elle implique aussi des transformations pédagogiques comme le « développement de filières sélectives dans l’enseignement public » ou encore des cursus bilangues présentés par la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale comme visant à « renforcer l’ouverture et l’attractivité internationale » de Marseille.
Cette transformation de l’offre éducative et donc des conditions d’enseignement vise une attractivité métropolitaine et certains des publics associés, ce qui se traduit par des tensions scalaires pour déterminer l’offre de formation. C’est l’enjeu qui est pointé par Antoine Gosnet, Beatriz Fernández et Marie-Vic Ozouf-Marignier : à Aubervilliers, l’offre de formation du Campus Condorcet se concentre sur les enseignements de master et de doctorat, le site répondant à des enjeux de visibilité métropolitaine et d’ambition de rayonnement universitaire national et international davantage qu’aux besoins en formation des habitant·es du territoire environnant. De même, à Marseille, le choix de n’accueillir qu’une trentaine d’élèves répartis sur cinq classes dans l’école R2 qui en comporte pourtant vingt-deux montre la volonté de privilégier les attentes éducatives de futurs parents d’élèves de catégories sociales plus favorisées « quitte à maintenir les élèves des écoles alentour dans des locaux saturés et dégradés ». La référence à des échelles de visibilité métropolitaine aboutit dans certains cas à des offres de formation ne répondant pas ou plus à des besoins locaux, rappelant alors des dynamiques de (dé)territorialisation des choix politiques de gestion métropolitaine, ici dans le domaine éducatif.
L’offre éducative apparaît donc comme un enjeu de négociation, voire de conflits incluant les usagers et usagères (parents d’élèves, étudiant·es) et une grande variété d’acteurs au sein des établissements. Si certains types d’acteurs ou de postes sont mentionnés dans les articles proposés (doyens, directrices d’établissements, enseignant·es, maître mixité), l’étude des jeux d’acteurs à l’intérieur des établissements dans ces contextes de transformations urbaines et éducatives fortes reste une perspective à approfondir.
L’analyse de ces arènes et des formes de mobilisation serait intéressante à poursuivre, en y questionnant plus avant la place des établissements : quels effets des politiques éducatives et urbaines sur les conditions, contenus et pratiques d’enseignement ; quelles transformations des établissements analysés comme lieux, à différentes échelles (de l’insertion urbaine d’un campus à la création de bâtiments ou salles spécifiques, comme les Living Lab dans les universités) ; quels jeux d’acteurs en leur sein incluant la multiplicité des personnels d’encadrement, d’enseignement et d’administration?
Analyser les facteurs d’inégalités éducatives, et donc repérer, catégoriser, construire les données permettant d’étudier ces déterminants, pose plusieurs enjeux méthodologiques. L’un d’entre eux concerne les articles adoptant des approches quantitatives. Les données agrégées sont en effet essentielles pour mettre au jour des effets de cohorte, d’origine sociale et géographique des publics dans l’appréhension des inégalités scolaires, comme le démontrent Julie Trémoureux sur les publics de l’Université du Mans ou encore dans celui de Gwenaëlle Audren et Aude-Line Gervais sur Marseille. L’explicitation de possibles biais et la construction de données adaptées constituent de véritables défis méthodologiques, exposés de manière explicite et détaillée dans le portfolio proposé par Victor Chareyon, Hugo Harari-Kermadec et Gilles Martinet. Face à cette profusion de données chiffrées, il n’est pas toujours aisé de s’approprier des nomenclatures susceptibles de reproduire des effets de classements que les chercheur·euses tentent de déconstruire. Par ailleurs, en dépit d’une apparente profusion, les données éducatives ne sont ni toujours accessibles publiquement, ni exemptes de forts effets de sélection : l’article de Victor Chareyon, Hugo Harari-Kermadec et Gilles Martinet sur les mobilités inter-académiques en France le montre bien en ce qui concerne la base SISE. L’approche institutionnelle confronte ainsi l’analyse à un enjeu d’accès et de manipulation de la donnée quantitative, mais les articles adoptant des approches plus qualitatives font également les frais de cette accessibilité. À ce titre, Étienne Butzbach et Choukri Ben Ayed démontrent tout l’intérêt d’une approche immersive, qualifiée de « recherche-intervention » par les auteurs, dans la mise en place d’un dispositif de mixité sociale entre plusieurs collèges de la région toulousaine. Il serait donc intéressant de croiser ces défis méthodologiques avec des travaux portant plus spécifiquement sur les méthodes d’enquête en milieu scolaire et universitaire ou sur les enjeux de « la production et l’analyse des données ouvertes par et pour l’action publique » (voir le colloque « L’action publique des données et les données de l’action publique » à Strasbourg en octobre 2022).
D’autre part, certains facteurs permettant d’étudier les relations entre contexte urbain et inégalités éducatives restent peu explorés à l’échelle du numéro. En effet, le contexte urbain est principalement considéré via la répartition spatiale de différenciations socio-économiques, entendue comme élément structurant d’inégalités en termes d’éducation. D’autres facteurs restent alors un peu dans l’ombre, comme par exemple les modes et infrastructures de transport. Si les mobilités et les effets de proximité ou d’accessibilité sont évoqués par plusieurs articles, la question des infrastructures de transport et des pratiques et représentations mobilitaires pourraient faire l’objet principal d’analyse des inégalités scolaires et universitaires. De même des éléments comme les sociabilités (qui peuvent jouer sur les choix résidentiels, sur les choix d’établissement), ou la proximité à d’autres services (crèche, emploi) restent peu examinés. L’attention portée aux politiques institutionnelles et à leurs mises en œuvre laisse parfois dans l’ombre les pratiques, représentations et expériences vécues des individus. Cette dimension est néanmoins mobilisée par Julie Tremoureux pour appuyer son hypothèse de « moyennisation » du public étudiant au Mans comme conséquence d’une « démocratisation ségrégative », en suggérant une « homogénéisation des comportements, des pratiques et des styles de vie », par exemple en termes de cohabitation avec les parents, fréquentation du centre-ville ou types de loisirs.
Enfin, cette approche générale des inégalités par le prisme des caractéristiques socio-économiques des (potentiels) usagers et usagères (catégorie socio-professionnelle des parents, niveau de revenus) laisse de côté d’autres déterminants, comme le genre, l’assignation raciale, le statut administratif. Ceux-ci sont quasi absents des articles de ce numéro, hormis l’opposition entre quartiers aisés et blancs au nord et quartiers afro-américains et pauvres au sud à Atlanta, et une mention de « ségrégation socio-ethnique » à Marseille, davantage décryptée dans un autre article d’une des autrices (Audren et Baby-Collin, 2017). Les articles témoignent ainsi de défis méthodologiques à saisir empiriquement les déterminants des inégalités, notamment dans le cas français. C’est en particulier le cas des statistiques documentant l’origine raciale des publics scolaires ou étudiants, inexistantes dans plusieurs contextes nationaux. Si elles soulèvent de nombreuses questions méthodologiques et politiques, elles sont essentiellement le produit de cadrages politiques colorblind – aveugles à la couleur (Simon, 2008). Cet « aveuglement statistique » (Escafré-Dublet et Simon, 2011) est hérité de tactiques développées à la suite de la Seconde Guerre mondiale cherchant à écarter la « race » et « l’ethnicité » des textes et pratiques institutionnelles, au nom de l’idée selon laquelle la collecte de ces informations reproduirait une forme de racialisation. Cette absence de données1 et la normalisation de cette absence, si elle n’est pas propre au seul champ éducatif, explique certainement pourquoi la variable de la race n’est finalement mobilisée qu’en filigrane dans les articles portant sur le cas français, constituant l’essentiel du numéro.
–
Conclusion
Que ce soit concernant les déterminants d’inégalités liés à l’assignation raciale, le rôle de l’État dans la reconfiguration des systèmes éducatifs, la place d’acteurs non publics (entreprises, organisations communautaires, fondations philanthropiques) ou les effets d’une néolibéralisation de l’éducation, le contre-point proposé par l’article de Nora Nafaa donne à penser sur le cas français majoritairement présenté. La perspective comparative, que ce soit au sein d’articles ou par leurs croisements au sein d’un numéro, apparaît donc stimulante, surtout au vu d’actualités françaises, telles que les difficultés de recrutement d’enseignant·es au niveau élémentaire et secondaire, particulièrement médiatisées en cette rentrée 2022, ou bien le projet annoncé en septembre 2021 par le président de la République d’expérimenter dans le cadre du plan « Marseille en grand » « une école qui n’existe pas en France », dans laquelle les directeurs pourront « choisir leur équipe pédagogique » et « associer des acteurs extrascolaires » au projet pédagogique. La déclinaison à l’échelle nationale, annoncée le 2 juin 2022, d’un « cahier des charges » et d’une « méthode » issus de cette expérimentation de « l’école du futur » fait particulièrement écho aux enjeux soulevés par ce numéro concernant la place de l’expérimentation dans les reconfigurations des modes de territorialisation des politiques éducatives et concernant cette fonction instrumentale croissante de l’offre éducative au service de stratégies urbaines métropolitaines.
MARINE DUC ET CAMILLE VERGNAUD
–
Marine Duc est est doctorante en géographie à l’université Bordeaux Montaigne et rattachée au laboratoire Passages – UMR 5319. Elle travaille sur les géographies étudiantes, les expériences universitaires et les rapports sociaux dans le contexte (post)colonial entre Groenland et Danemark. Elle est membre du comité scientifique de la revue Urbanités.
marine.duc@ens-lyon.org
–
Camille Vergnaud est maîtresse de conférences en géographie à l’Université Grenoble Alpes, chercheuse au laboratoire PACTE (UMR 5194). Elle travaille sur les missions attribuées aux universités dans différents modèles nationaux et les dimensions spatiales des transformations actuelles du système d’enseignement supérieur et de recherche en France. Enseignante à l’INSPE de l’académie de Grenoble, ses recherches portent également sur l’enseignement de la géographie dans le supérieur et la formation des enseignant·es. Elle est membre du comité éditorial de la revue Urbanités.
camille.vergnaud@umrpacte.fr
–
Couverture : manifestation du 5 mars 2020 contre la Loi de Programmation de la Recherche à Bordeaux (M. Duc, 2020).
––
Bibliographie
Audren, G. et Baby-Collin, V. 2017, « Ségrégation socio-spatiale et ethnicisation des territoires scolaires à Marseille », Belgeo, Revue belge de géographie, n° 2‑3.
Ben Ayed C. B., 2015, Le nouvel ordre éducatif local : mixité, disparités, luttes locales, Paris, Presses universitaires de France.
Bouba-Olga O. et Grossetti M., 2018, « La mythologie CAME (Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, Excellence) : comment s’en désintoxiquer ? », preprint disponible sur HAL.
Bourdieu P. et Passeron J-. C., 2018 (1970), La reproduction : éléments pour une théorie du système d’enseignement, Paris, Éditions de Minuit, 284 p.
Chevalier D. et Leininger-Frézal, C., 2020a, « Des lieux pour apprendre et des espaces à vivre : l’école et ses périphéries. Des places et des agencements », Géocarrefour, (94)1, en ligne.
Chevalier D. et Leininger-Frézal C., 2020b, « Des lieux pour apprendre et des espaces à vivre : l’école et ses périphéries. Les dehors et les ailleurs », Géocarrefour, (94)2, en ligne.
Clerc P., 2020, « La salle de classe : un objet géographique », Géocarrefour, 94(1), en ligne.
Escafré-Dublet A. et Simon P., 2011, « Ethnic statistics in Europe: The paradox of colorblindness », in European multiculturalisms: Cultural, religious, and ethnic challenges, Edinbourg, Edinburgh University Press, 213-237.
Felouzis G., Maroy C. et Van Zanten A., 2013, Les marchés scolaires : sociologie d’une politique publique d’éducation. Paris, Presses universitaires de France.
Frouillou L., 2020, « Déconstruire le « territoire » : prendre en compte les échelles dans l’analyse des inégalités scolaires », in Education et Territoire : inégalités ou diversité ?, 13-20.
Harari-Kermadec H., 2019, Le classement de Shanghai. L’université marchandisée, Lormont, Le Bord de l’eau, 168 p.
Jarvis D. S., 2014, « Regulating higher education: Quality assurance and neo-liberal managerialism in higher education—A critical introduction ». Policy and Society, vol. 33 n°3, 155-166
King R., 2009, Governing universities globally: Organizations, regulation and rankings, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 256 p.
Merle P., 2010 (2002), La démocratisation de l’enseignement, Paris, La Découverte, 125 p.
Musselin C., 2008, « Vers un marché international de l’enseignement supérieur ? », Critique internationale, n° 39(2), 13‑24.
Simon P., 2008, « Les statistiques, les sciences sociales françaises et les rapports sociaux ethniques et de “race” », Revue française de sociologie, vol. 49, n°1, 153-162.
Vergnaud C., à paraître, « L’excellence contre la science : quand la mise en compétition et la bureaucratisation éloignent l’université de ses missions », Métropolitiques.
–
Pour citer cet édito : Duc M. et Vergnaud C., 2022, « Edito #16 / À l’école de la ville », Urbanités, #16 / À l’école de la ville, septembre 2022, en ligne.
–
- Dans la pratique, il faut reconnaître qu’il existe plusieurs moyens de contourner cette absence dans les nomenclatures statistiques, comme le recours à un proxy, s’appuyant par exemple sur l’ascendance migratoire. [↩]